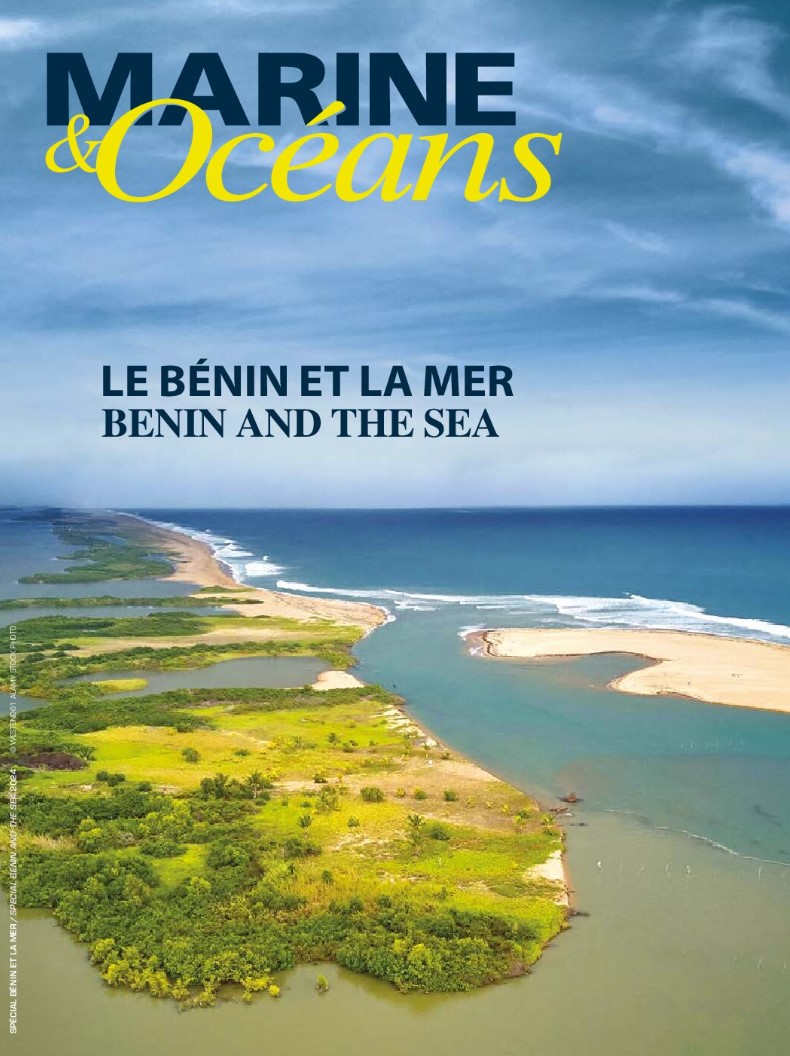Une augmentation massive de l’effort de défense pèserait à court terme sur les dépenses publiques, mais générerait dans un délai appréciable des retours sur investissements qui feront davantage que « rentabiliser » l’effort consenti. Explications.
L’équation semble insoluble. La nécessité d’augmenter les dépenses militaires au-delà de ce qui était déjà prévu fait consensus, mais la situation catastrophique de nos finances publiques nous en empêche à première vue. À défaut d’augmenter ses déficits et niveaux d’imposition qui sont déjà parmi les plus élevés d’Europe, la France pourrait réaliser des économies sur d’autres postes budgétaires mais l’absence de majorité à l’Assemblée compromet toute réforme ambitieuse de l’action publique.
Or face à ceux qui voient dans l’augmentation des dépenses militaires un insoutenable fardeau, d’aucuns, à l’instar du ministre des Armées Sébastien Lecornu, affirment que « l’investissement dans notre effort de défense, privé comme public, est vertueux et doit être considéré comme tel ». Qu’en est-il vraiment ? Dans quelle mesure une hausse massive de notre effort de défense constituerait-il un fardeau, ou une opportunité pour notre économie et nos finances publiques ?
La première question est celle de ce que les économistes appellent un multiplicateur keynésien : les dépenses militaires génèrent-elles des externalités économiques positives, qui peuvent donc profiter à terme aux finances publiques ? Selon divers travaux d’économistes ces dernières années, la réponse est oui. Ainsi notamment des études de Julien Malizard, l’un des principaux spécialistes des enjeux économiques de la défense, qui attestent du rôle positif pour l’économie des dépenses d’équipement et d’investissement(1).
Ces dépenses en matériel ont une forte intensité capitalistique, en plus de concerner tout un cycle de production : leur impact économique se mesure plus rapidement que pour les autres dépenses publiques « classiques », au point qu’il faut les considérer comme de l’investissement industriel. Mais concrètement, combien rapportent-elles ?
Comme le rappelait l’ancienne présidente de la Commission de la défense nationale et des forces armées, Françoise Dumas, « le « multiplicateur keynésien » est plus élevé dans le secteur de la défense que dans la plupart des autres champs d’investissement de l’État(2) ». Lorsqu’il était ministre de la Défense, Jean-Yves Le Drian avançait que « un seul euro investi dans l’industrie de défense représente en retombée économique 2 euros, 3 euros, peut-être davantage(3) ». S’il est difficile de quantifier le niveau du multiplicateur lié aux dépenses de défense, les spécialistes l’estiment généralement autour de 50 % au bout de deux ans, et de 100 % en quelques années. Le professeur émérite Christian de Boissieu, vice-président du Cercle des économistes, affirme par exemple que le multiplicateur pour les dépenses de défense serait de 2 au bout de dix ans(4).
L’effet multiplicateur des dépenses militaires se vérifie aussi au niveau local ; dans le domaine maritime, c’est par exemple le cas pour le département du Var(5). Et si l’efficacité des dépenses en personnel ou en infrastructures est plus discutable que celle des dépenses d’équipement, la présence d’un régiment rapporterait 20 à 30 millions d’euros par an à la ville où il est implanté, profitant aux commerces, aux services locaux et au marché immobilier(6).
À une échelle plus large, plusieurs études ont été réalisées à l’étranger sur l’impact économique de la hausse massive des dépenses militaires qui se profile dans toute l’Europe. Ainsi d’une étude du think tank allemand Kiel Institute, selon laquelle porter les dépenses militaires européennes de 2 à 3,5 % du PIB européen ferait croître celui-ci de 0,9 voire 1,5 %, avec à la clé des gains conséquents à long terme pour l’activité économique(7).
Or, tout indique que la France est le pays européen qui pourrait le mieux profiter du réarmement du continent, puisqu’elle possède l’industrie de défense la plus autonome et diversifiée, ce qui lui permet de produire la quasi-totalité de son armement et d’être depuis deux ans le second exportateur d’armement au monde.
Notre base industrielle et technologique de défense (BITD), qui regroupe 4 500 entreprises et 220 000 emplois difficilement délocalisables, nourrit tout un écosystème bien plus large. Dans le domaine naval, un géant comme Naval Group travaille avec quantité de sous-traitants allant d’entreprises logistiques à des start-up tournées vers la haute technologie.
Au-delà des sites de Lorient, Saint-Tropez ou Saint-Nazaire, l’industrie navale militaire fait vivre des entreprises jusque dans les départements les plus éloignés du littoral. La conception et la production du futur porte-avions et des SNLE nouvelle génération profitera sur des décennies à des filières réparties sur tout le territoire, comme l’industrie nucléaire.
Notons aussi que l’impact positif des dépenses de défense est bien plus important aujourd’hui qu’au temps de la guerre froide, où l’effort de défense était proportionnellement plus élevé : les nouveaux matériels exigent davantage de complexité technologique, de personnels qualifiés, d’entreprises ou sites spécialisés.
Outre les dépenses d’équipement, les dépenses militaires en recherche et développement (R&D) se distinguent par leur efficacité économique. Antonin Bergeaud, professeur à HEC Paris et Arnaud Dyèvre, chercheur au MIT de Boston, avancent ainsi que plus de la moitié des retombées générées par les dépenses de R&D militaire bénéficient à d’autres acteurs que l’investisseur initial(8). Dans une publication pour le site spécialisé Telos, les deux économistes soulignent cependant l’importance de paramètres tels que la concurrence dans l’industrie, ou d’un soutien cohérent à l’innovation civile(9).
Enfin, nombre d’études montrent que les dépenses d’équipement militaire ou de recherche dans la défense sont complémentaires des investissements privés(10), là où l’on pourrait craindre un effet d’éviction. Si les dépenses militaires peuvent induire des coûts d’opportunité (c’est-à-dire au détriment d’autres activités économiques), c’est moins le cas que dans d’autres domaines(11).
S’ajoute un dernier élément d’importance pour les finances publiques : les réductions de commandes d’armement ces trente dernières années ont souvent conduit à payer plus pour avoir moins, du fait du renchérissement des coûts unitaires.
« Les opportunités économiques sont immenses, notamment dans le domaine naval, où la France dispose des meilleures cartes en Europe. »
Dans le domaine maritime, le chercheur Olivier Schmitt souligne que « pour 8 milliards d’euros, soit le prix de 17 frégates FREMM à prix 2008, la marine nationale en disposera de 9 de moins(12) ». À l’inverse, revoir à la hausse les grands programmes – le ministre Lecornu ayant justement évoqué les frégates de premier rang – pourrait diminuer les coûts unitaires.
Reste une ombre au tableau, et pas des moindres : la capacité d’une industrie de défense française, diminuée par les « dividendes de la paix », à engranger les « dividendes du réàarmement ». Selon une récente étude du groupe SCET (Services, conseil, expertises et territoires), filiale de la Caisse des Dépôts & Consignations, la France n’aurait pas la capacité de répondre à la hausse massive de la demande en armement que générerait une augmentation des dépenses militaires de l’OTAN à 5 % du PIB d’ici 2025.
La BITD française ne dispose pas des outils de production pour une montée en puissance aussi forte et rapide : fonctionnant aujourd’hui à plus de 90 % de ses capacités (10 points de plus que ses homologues civiles), elle fait face à des contraintes techniques bien connues, mais aussi à des difficultés d’approvisionnement. Elle ne semble pas non plus capable de former et recruter suffisamment de main-d’œuvre qualifie : alors qu’il lui faudrait 575 000 à 800 000 personnels supplémentaires(13), l’industrie de défense tricolore se heurte à ses propres limites (formation, attractivité), et à celles du marché du travail français.
Ce qui fait courir un véritable danger de déclassement à l’industrie de défense française : selon l’étude de la SCET, « sans stratégie ambitieuse, la France risque de perdre des parts de marché face à d’autres pays plus réactifs, mettant en danger sa deuxième place mondiale à l’export, ainsi que les plus de 200 000 emplois (directs et indirects) de sa BITD répartis au sein des 4 000+ entreprises(14) ». Outre la concurrence américaine au sein de l’OTAN, la BITD française fera face à une concurrence allemande d’autant plus forte que l’Allemagne dispose à la fois de marges de manœuvre budgétaire bien plus grandes, avec des centaines de milliards d’euros d’investissement prévus dans le réarmement et les infrastructures d’utilité militaire, et d’un potentiel industriel très supérieur qui permettra aussi à des industries civiles de réorienter une partie de leurs activités.
Mais à défaut de pouvoir absorber le choc de demande que représenterait une hausse des dépenses militaires des pays de l’OTAN à 5 % de leur PIB – laquelle ne sera vraisemblablement pas atteinte par la plupart des membres de l’Alliance, dont la France –, l’industrie de défense française reste en mesure de répondre à une augmentation massive des dépenses militaires françaises et à de nouvelles commandes de la part de ses alliés.
À défaut d’être entrée en « économie de guerre », expression déconnectée de la réalité du secteur de la défense français, la BITD tricolore est déjà parvenue à augmenter significativement son rythme de production dans des segments allant de l’artillerie et des obus aux avions de combat, à relocaliser des capacités, notamment pour la production de poudres, et à en développer de nouvelles notamment dans le domaine des drones.
Si la France n’est pas en mesure de répondre à une hausse aussi massive des dépenses militaires – dont elle n’a du reste pas les moyens budgétaires –, elle peut donc relever le défi d’un réarmement d’ampleur qui aurait des retombées économiques substantielles dans ses territoires.
Au total, l’on peut affirmer qu’une augmentation massive de l’effort de défense pèserait à court terme sur les dépenses publiques, mais elle générerait dans un délai appréciable des retours sur investissements qui feront davantage que « rentabiliser » l’effort consenti. Le recul d’années de recherches universitaires et de retours d’expérience, entre autres dans l’industrie navale de défense, permet d’affirmer avec certitude qu’une hausse soutenue de l’effort de défense profiterait à l’activité économique, et serait soutenable pour les finances publiques.
Les opportunités économiques sont immenses, notamment pour le secteur naval où la France dispose des meilleures cartes en Europe et où elle peut préparer les défis de demain, de l’action dans les grands fonds marins pour laquelle la loi de programmation militaire 2024-2030 prévoit des investissements salutaires, jusqu’à la révolution des drones où notre marine nationale risque de décrocher sans un effort massif d’innovation et de production.
Aurélien Duchêne
Consultant géopolitique et défense, chercheur à Euro Créative et auteur dernièrement de La Russie de Poutine contre l’Occident (Eyrolles, 2024). Il analyse régulièrement l’actualité internationale dans les médias, notamment comme chroniqueur pour la chaîne LCI.
NOTES
- Julien Malizard, « Dépenses militaires et croissance économique dans un contexte non linéaire », Revue économique. 28 avril 2014, Vol. 65 n°3. p 601-618.
- Portant restitution des travaux de la commission de la défense nationale et des forces armées sur l’impact, la gestion et les conséquences de la pandémie Covid-19. Rapport d’information n°3088, déposé en application de l’article 145 du Règlement par la Commission de la défense nationale et des forces armées, 03/06/2020, p. 45-46.
- Déclaration de M. Jean-Yves Le Drian, ministre de la défense, sur l’industrie de défense, à Clermont-en-Argonne le 23 février 2016.
- Christian de Boissieu, « Un plan de relance pour la défense », Les Échos, 20 mai 2020.
- Maurice Catin et Véronique Nicolini, « Les effets multiplicateurs des dépenses militaires de la DCN. Toulon sur l’économie varoise », Revue d’Économie Régionale & Urbaine, 2005/4 (octobre), p. 451-480.
- Laurent Lagneau, « Quel est le poids économique de la Défense en France ? », Blog Zone Militaire (Opex 360), 03 septembre 2016.
- Ethan Ilzetzki, « Guns and Growth: The Economic Consequences of Defense Buildups », Kiel Institute for the World Economy, Kiel Report N°2, février 2025.
- Antonin Bergeaud et Arnaud Dyèvre, « Les dépenses militaires sont bénéfiques à l’économie », Les Echos, 31 mars 2025.
- Antonin Bergeaud et Arnaud Dyèvre, « Les externalités économiques des dépenses militaires », Telos, 16 avril 2025.
- Christian de Boissieu, « Un plan de relance pour la défense », op. cit.
- Julien Malizard, « Opportunity cost of defense : an evaluation in the case of France », Defence and Peace Economics, 2013, vol. 24, n° 3, p. 247-259.
- Olivier Schmitt, « 2. Rendre la guerre possible : budgets de défense et justifications politiques », Histoire militaire de la France, II : De 1870 à nos jours. Paris : Perrin. 2018, p. 613.
- SCET, « Les dividendes du réarmement Quel impact de la hausse des dépenses de défense sur les économies territoriales ? », Juin 2025.
- Ibid.