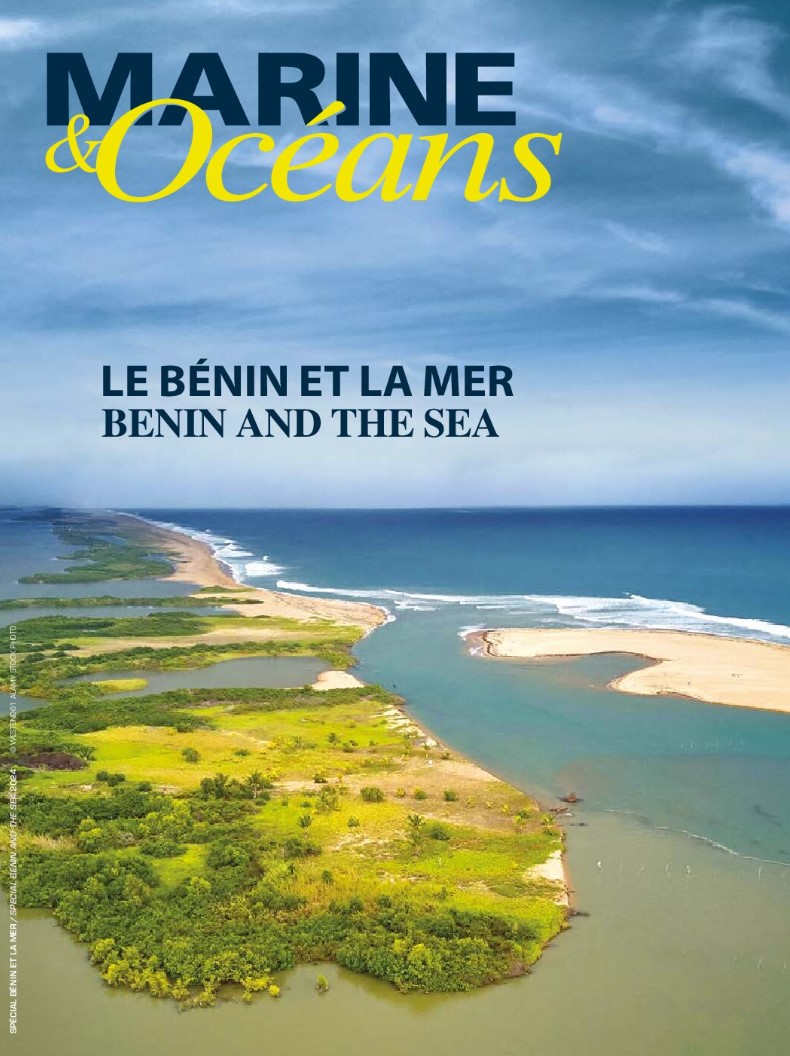Ingénieur et astronaute à l’Agence spatiale européenne, Jean-François Clervoy a effectué trois missions spatiales avec la NASA. Il est expert auprès du programme de vols habités, du département de la communication et du bureau du développement durable de l’agence spatiale européenne (ESA).
Interview publiée dans la revue Marine & Océans (1er trimestre 2018). Propos recueillis par Erwan Sterenn.
———–
Que vous inspirent ces deux environnements que sont la mer et l’espace?
Tous deux ont des points en commun. Ce sont des environnements immenses, naturellement hostiles à l’être humain. Y vivre et travailler exige donc le recours à des systèmes qui compensent cette hostilité, accompagnés de procédures de sécurité poussées. Il faut toujours y être vigilant et opérationnel. Pour un astronaute, les océans sont ce qui frappe le plus lorsque l’on observe la planète à partir de l’espace. Les continents semblent presque petits par rapport à la place qu’ils occupent.
Dans quels domaines ces deux environnements interagissent-ils et que s’apportent-ils ?
Pour s’entrainer aux conditions d’impesanteur ou de pesanteur réduite comme celle de la lune ou de mars, les astronautes, qui sont obligatoirement diplômés en plongée, utilisent de grands bassins et parfois même la mer. Ils revêtent des scaphandres spécialement étudiés, comme celui crée par la compagnie d’expertise maritime Comex. Il m’est ainsi arrivé de passer de longues heures sous l’eau, dans une crique des îles du Frioul, pour simuler l’exploration de la Lune. Par ailleurs, pour l’entraînement aux conditions sévères de vie et de travail dans l’espace, on utilise régulièrement des milieux terrestres appelés « analogues ». Le plus utilisé est un habitat sous-marin au large de la Floride. L’océan n’a pas fini de servir à préparer des missions dans l’espace. Il est utile à l’espace mais l’inverse est encore plus vrai. Les satellites de navigation comme ceux du système Galileo européen sont devenus incontournables pour le positionnement des navires. Ce sont aussi des outils spatiaux qui permettent de gérer le trafic maritime, de repérer rapidement un bateau en détresse, de guider les secours, de communiquer en haute mer loin de toutes stations radio terrestres. Les instruments scientifiques sophistiqués embarqués sur les satellites informent précisément sur l’état de l’océan – hauteur des vagues, force du courant, température et salinité de l’eau -, et tout cela à l’échelle de la planète. Ils donnent aussi des informations sur l’atmosphère pour une prédiction météo à la fois précise et globale. Plus de la moitié des paramètres décrivant le climat sont issus exclusivement de données satellitaires.
L’espace et les océans sont-ils aujourd’hui confrontés aux mêmes problématiques en matière de gouvernance ?
Au-dessus de 100 kilomètres d’altitude, la notion d’espace aérien disparait et l’espace appartient alors à tout le monde. Quelque soit son propriétaire, un satellite fait seize fois le tour de la terre par jour. Il passe donc en toute impunité au-dessus de bien des espaces aériens. Depuis 1967, l’espace bénéficie d’un traité qui lui octroie un statut pacifique. D’un point de vue purement économique, pour ce qui concerne les applications spatiales, on sait bien que les industriels se livrent à une concurrence féroce. Mais là-haut, quand il s’agit d’exploration et donc de quête de connaissances par les humains comme par des robots, c’est au contraire une complète collaboration qui prévaut entre les Etats. Cela a commencé après le premier vol Apollo-Soyouz en juillet 1975, lors du réchauffement des relations Est-Ouest. Depuis dix-sept ans, on trouve dans la Station spatiale internationale (SSI) des astronautes de différentes nationalités : américains, russes, japonais, européens, canadiens… Aujourd’hui, les nations se rendent mutuellement service dans l’espace, en dépit de toutes les dissensions diplomatiques qu’elles pourraient avoir sur terre : l’une va assurer un ravitaillement quand l’autre effectuera, en retour, une réparation.
On a coutume de dire que l’on connaît moins bien l’océan profond que l’espace. Qu’en pensez-vous?
C’est à la fois vrai et faux. Vrai, car aucun satellite ne peut explorer les océans en profondeur. On ne sait véritablement du contenu des océans que ce que l’on est allé observer in situ. On sait que l’océan recèle de très grandes richesses biologiques et minérales et qu’il reste encore beaucoup à explorer. Alors que l’espace immédiat, le plus proche de la terre, est lui composé essentiellement de vide et de quelques corps célestes sans aucune mer. La Lune et Mars exposent l’intégralité de leur surface aux instruments d’observation placés sur leur orbite. On les connait donc mieux visuellement que les océans. C’est faux ensuite parce qu’il reste encore une immense part de mystère dans l’espace plus lointain, et donc certainement davantage à y découvrir qu’au fond des océans. En particulier, on a identifié à ce jour avec certitude l’existence d’océans d’eau sous la croûte gelée de plusieurs lunes de Jupiter et de Saturne. Ce qui en fait des cibles très prisées des scientifiques pour de futures sondes interplanétaires dont les technologies pourront apprendre de l’exploration de nos océans terrestres.
Certains observateurs estiment qu’investir dans la connaissance et l’exploitation des océans aurait été et serait encore plus utile et profitable que dans l’espace?
Le deux ne doivent pas être opposés. Mais il faut garder à l’esprit que l’économie de la mer pèse bien plus lourd que celle de l’espace, et que ce sont des budgets qui ne fonctionnent pas en vases communiquant, qui ne se transposent pas de l’un à l’autre d’un claquement de doigt. Pour vous donner une idée, le programme européen de vols habités spatiaux coûte seulement un euro par an et par habitant des pays qui participent au programme.
Quel est l’avenir de l’homme dans l’espace, et quelle est la prochaine grande aventure spatiale ?
Entre les années 2020 et 2030, on peut tabler sur l’installation d’une station habitée en orbite autour de la lune, appelée Deep Space Gateway (DSG). En 1969, la conquête de la lune était le résultat d’une course. Aujourd’hui, c’est un enjeu de recherche et d’exploration en coopération. Cette station DSG sera complétée par une infrastructure sur la lune promue par l’ESA sous le nom de Moon village. Le but est non seulement d’explorer la lune mais également de l’exploiter et de voir si on peut y récupérer des ressources (eau, carburant, oxygène) en vue de partir encore plus loin, par exemple vers Mars. A ce jour, les estimations calendaires les plus réalistes prévoient des humains en orbite autour de Mars à l’horizon 2035, et une exploration humaine de surface dans les années 2040. Entre temps, on pourra y envoyer des usines automatiques qui auront pour rôle de préparer les ressources nécessaires aux humains qui viendront s’installer lors de séjours d’explorations habitées. Tout cela rentre finalement dans le discours d’Elon Muskqui théorise sur le fait que l’homme est appelé à devenir une espèce multi planétaire.
N’y aura-t-il pas quelques similitudes entre un voyage vers Mars et les expéditions des premiers grands navigateurs, coupés du monde dès le port perdu de vue ?
Si bien sûr ! On retrouvera de la même façon les notions d’isolement dans un environnement hostile à l’humain, le secours improbable, voire impossible, la communication impossible ou difficile et très différée et enfin, le confinement. Au temps des grands explorateurs, les navigateurs étaient confinés dans un navire. Aujourd’hui, ils le sont dans un engin spatial. On retrouve l’esprit d’audace, la prise de risque et le goût pour la confrontation à un environnement extrême. Dans l’espace le plus proche de la terre, les choses sont plus simples… Il faut savoir qu’à l’heure actuelle, un retour d’urgence de la Station spatiale internationale (SSI) est possible en trois heures. Alors que pour un marin du Vendée globeen détresse dans une tempête au milieu du Pacifique, un retour aussi rapide est impossible !
Comment la France se situe-t-elle dans le domaine spatial ?
Bien ! Elle est en tête du peloton européen, même avec des moyens bien moindres que ceux des américains ou des russes. En France, nous avons les moyens de construire un satellite de A à Z. Les Russes ont une expérience des vols habités plus approfondie que la nôtre. Mais nous avons des compétences techniques très affinées. Nous l’avons démontré lors de la mission Rosetta, où nous sommes parvenus à faire atterrir une sonde, du nom de Philae, sur une comète à 500 millions de kilomètres de la terre, au terme d’un voyage de dix ans. Une petite prouesse technologique, que tout le monde a saluée.
L’homme commence à vouloir prendre soin de sa planète. Qu’en est-il de l’espace que l’on sait pollué d’innombrables débris ? De quoi s’agit-il précisément, quels effets et quelles solutions?
En effet, en plus de cailloux naturels que l’on trouve dans l’espace, il y a beaucoup de débris issus de l’activité humaine. De nombreuses études portent sur les différentes façons de les récupérer. On imagine des filets, des bras articulés… Mais ce sont encore des opérations trop onéreuses. Lorsque les débris sont à moins de 400 kilomètres de la terre, ils finissent rapidement par se désintégrer naturellement dans la haute atmosphère. C’est lorsqu’ils sont plus haut qu’ils sont problématiques. Parfois, ils se percutent entre eux et s’explosent mutuellement, ce qui ne les rend pas moins dangereux ! Un petit débris est aussi nuisible qu’un gros. On estime qu’un test d’arme anti-satellite effectué il y a quelques années par les Chinois à trop haute altitude a augmenté d’un facteur 30 le risque de collisions sur notre flotte de satellites européens. C’était une erreur. Bien sûr, l’espace étant vide de vie biologique, ces débris n’ont aucun impact écologique majeur, contrairement à la pollution que l’on retrouve dans l’océan qui pèse sur tout l’éco-système. Aujourd’hui les satellites modernes sont conçus pour ne plus générer aucun débris, et même mieux, ils contribuent, pour certains, de façon indéniable, au développement durable grâce aux multiples services qu’ils rendent pour mieux comprendre et gérer la planète. Plus de 50% des paramètres utilisés par le GIEC (Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat) tirent leur valeur de données exclusivement satellitaires. Enfin, lors des voyages habités, les astronautes sont les champions du recyclage et de l’anti gaspillage ! Un engin spatial est en lui-même une petite reproduction de l’éco-système terrestre.
Quel lien entretenez-vous avec le monde des océans ?
Je pense que chez beaucoup d’astronautes, le goût de l’aventure et de l’exploration est né sous l’influence de grands explorateurs et navigateurs. Les techniques et les défis communs ont rapproché les deux domaines. Pour les mises au point des combinaisons de tests en mer et des scaphandres, j’ai travaillé, navigué et plongé avec Henri Delauze, ingénieur et créateur de la compagnie d’expertise maritime COMEX, décédé en 2012. Un homme visionnaire et audacieux que je porte en grande estime. Mon premier équipage a par ailleurs emporté dans la navette spatiale américaine le fameux bonnet rouge du Commandant Cousteau pour le lui rendre ensuite ! Depuis une quinzaine d’années, j’échange régulièrement avec Jacques Rougerie, océanographe et architecte, qui a créé le concept de la station de recherche océanique dérivante Sea Orbiter où s’entraîneront les astronautes avant les vols futurs de très longue durée. Ces liens décrits plus haut entre la mer et l’espace m’ont naturellement amené à m’engager pour l’océan auprès d’acteurs très actifs comme Francis Vallat, Philippe Vallette, Cécile Gaspar. Je parraine l’association « Te mana o te moana » de protection de l’océan en Polynésie française, et soutiens aussi le Réseau océan mondial. Je me sens aujourd’hui autant océanaute qu’astronaute.
En savoir + : L’espace exo-atmosphérique dans la Revue stratégique 2017 (1)
Peu régulé, l’espace exo-atmosphérique est en profonde mutation et investi, lui aussi, par les logiques de compétition stratégique et militaire. La multiplication des acteurs étatiques et privés entraîne une banalisation de l’accès à l’espace. De plus en plus d’Etats ont en effet acquis des capacités industrielles leur permettant de réaliser des lanceurs spatiaux et des satellites.
L’évolution technologique sans précédent qui sous-tend cette expansion permet l’émergence d’une nouvelle manière de concevoir et d’exploiter les systèmes spatiaux (New Space) mais aussi une banalisation des usages, un risque dangereux de prolifération, une compétition accrue entre Etats et une intense concurrence industrielle. Fournisseur de services aujourd’hui indispensables de navigation, de communication, de météorologie ou d’imagerie, le domaine spatial est aussi un espace de confrontation où certains Etats peuvent être tentés d’user de la force pour en dénier l’accès ou menacer l’intégrité de ses composants.
Les progrès des techniques de rendez-vous dans l’espace, les capacités de robotique et de propulsion électrique permettent de réparer, de ravitailler en carburant voire de désorbiter des engins spatiaux. Sous couvert d’objectifs civils, des Etats peuvent donc financer ouvertement des technologies potentiellement antisatellites. Celles-ci permettraient la mise en service d’outils dont les actions seraient beaucoup plus difficiles à détecter, à suivre, à attribuer et à contrer que des actions exo-atmosphériques plus classiques (missiles, lasers, brouilleurs…)
Les activités liées à ce nouveau paradigme posent également de nombreuses questions juridiques (contrôle à l’exportation, réglementation de la diffusion de données et sécurité de l’espace en lien avec la multiplication des satellites ou les débris…). Le problème de l’arsenalisation de l’espace se pose donc dans des termes renouvelés.
(1) Revue stratégique de défense et de sécurité nationale 2017.