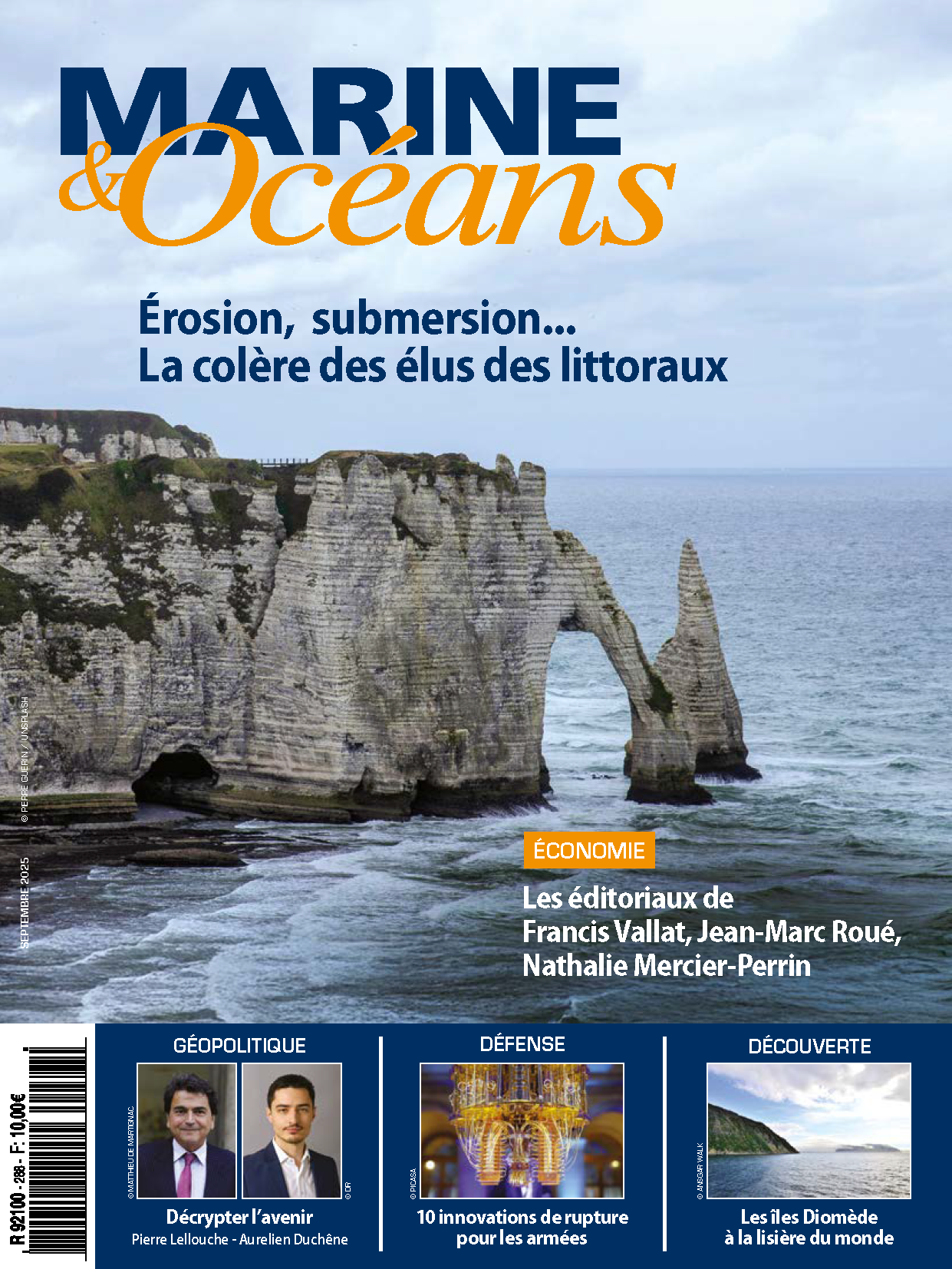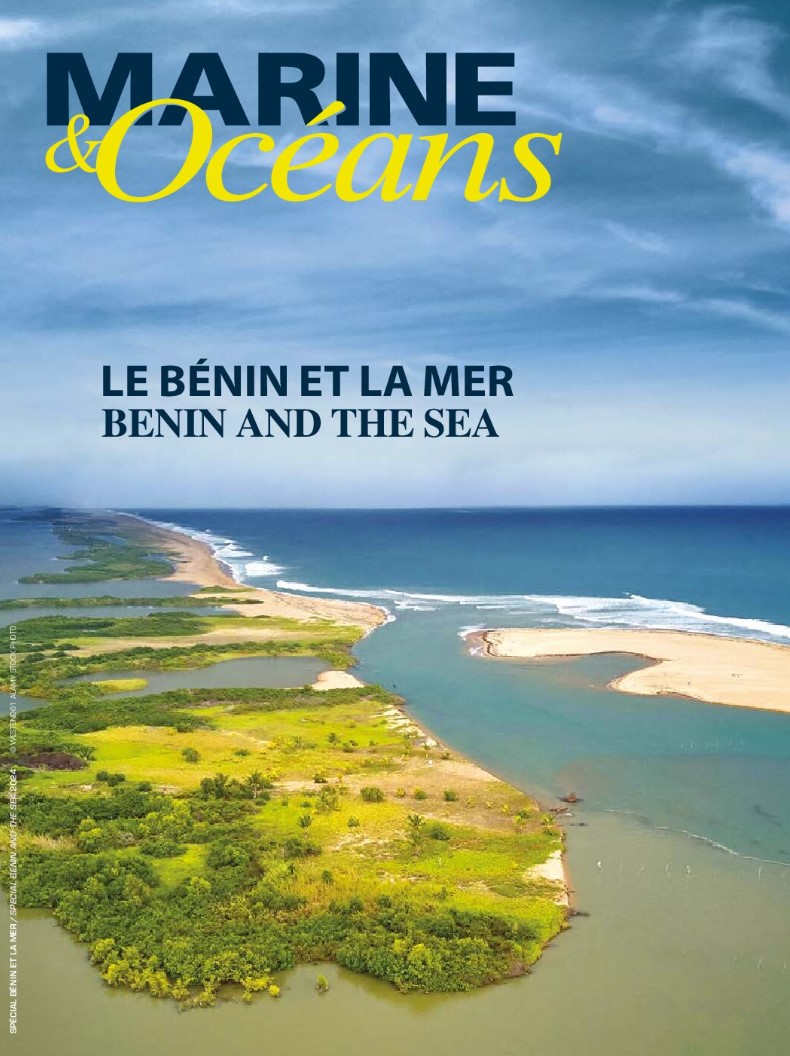Pour Dominique Clain, planteur de canne et président du syndicat Unis pour nos agriculteurs (UPNA), la campagne sucrière 2025 qui s’étend de juillet à décembre à La Réunion ressemble déjà à un nouveau coup sur la tête. « La campagne 2024 était la pire que nous avions connue, mais celle-ci sera encore plus catastrophique », confie-t-il.
En cause : le cyclone Garance, qui a dévasté les cultures en début d’année. Alors que les deux usines de l’île sont calibrées pour deux millions de tonnes de canne, les planteurs n’en livreront pas plus de 900.000 cette année.
Mais ceci arrive après une récolte déjà « historiquement basse » en 2024 (1,13 million tonnes), selon la chambre d’agriculture réunionnaise.
La filière canne-sucre-rhum, coeur battant de l’économie locale, emploie encore quelque 10.500 personnes, dont 6.700 de manière permanente, selon les services de l’Etat. Mais sa rentabilité s’érode depuis des années.
« On voit de plus en plus de canniers se diversifier », observe Stéphane Sarnon, président de la FDSEA, syndicat majoritaire à la chambre d’agriculture.
« La filière n’est pas rentable mais nous voulons tout faire pour la maintenir », plaide-t-il, estimant qu’il faudrait « mieux valoriser les produits comme la mélasse ou la bagasse », la fibre de canne brûlée pour produire de l’électricité.
Selon le syndicat du sucre, représentant du groupe Tereos (marque Béghin Say), deuxième acteur mondial et seul industriel de l’île, la filière fait face à « une concurrence accrue des pays non européens » depuis les accords UE-Amérique centrale et avec la Communauté andine, entrés en vigueur en 2013.
Pour éviter le naufrage, Tereos bénéficie de 44 millions d’euros d’aides publiques, afin de maintenir les emplois et soutenir la transformation. Les producteurs, eux, bénéficient d’aides issues du POSEI, qui décline la politique agricole commune (PAC) dans les régions ultrapériphériques, et de subventions compensant les surcoûts de transport ou de production.
« Au total, la filière bénéficie d’un soutien public à hauteur de 148 millions d’euros par an, dont 70% à destination des producteurs », détaille le syndicat du sucre.
Résultat: pour une tonne vendue environ 100 euros, 70 à 80 proviennent de fonds publics. « La filière ne survit que grâce aux aides de l’État et de l’Europe », concède Dominique Clain: « Nous vivons à 75% des aides ».
– Doutes et dépendance –
Cette dépendance interroge le modèle agricole de l’île. La canne couvre 22.600 hectares, soit 53% de la surface agricole utilisée. Mais cette emprise diminue: entre 2019 et 2023, les surfaces déclarées en canne à sucre ont reculé de près de 1.900 hectares, selon la direction de l’agriculture (DAAF) réunionnaise.
« Si on veut aller vers l’autonomie, consacrer autant d’hectares à la canne n’est pas une bonne chose », reconnait Laurent Boulanger, le secrétaire général de la Coordination rurale de La Réunion.
Pour lui, l’enjeu n’est pas de « tuer » la canne, mais de repenser son rôle. « Elle fait partie de la culture réunionnaise, et la filière est essentielle au maintien des emplois. Mais il faut diversifier davantage les exploitations », plaide-t-il.
Environ 70% des besoins en fruits et légumes frais de La Réunion sont couverts par la production locale, ce qui fait de l’île un bon élève ultramarin en matière d’autonomie. La production maraîchère tend à augmenter « mais pour que cette tendance se confirme, nous aimerions que les aides de l’État soient mieux réparties », ajoute Laurent Boulanger.
Au nom d’une agriculture plus écologique, le collectif Oasis Réunion défend la même idée. « Nous serons bientôt un million, il faut à tout prix consacrer une plus grande partie de la surface agricole à l’agriculture vivrière », insiste sa porte-parole, Yvette Duchemann, dénonçant au passage « l’usage de pesticides, comme le glyphosate, pour la canne à sucre ».
Un rapport de l’Office de l’eau publié en 2023 signalait la présence de glyphosate à « des concentrations relativement importantes » dans les rivières réunionnaises. Et selon la DAAF, le glyphosate « reste la substance la plus vendue sur l’île, avec près de 25% des ventes totales » de pesticides.
dje/tbm/mat/nth