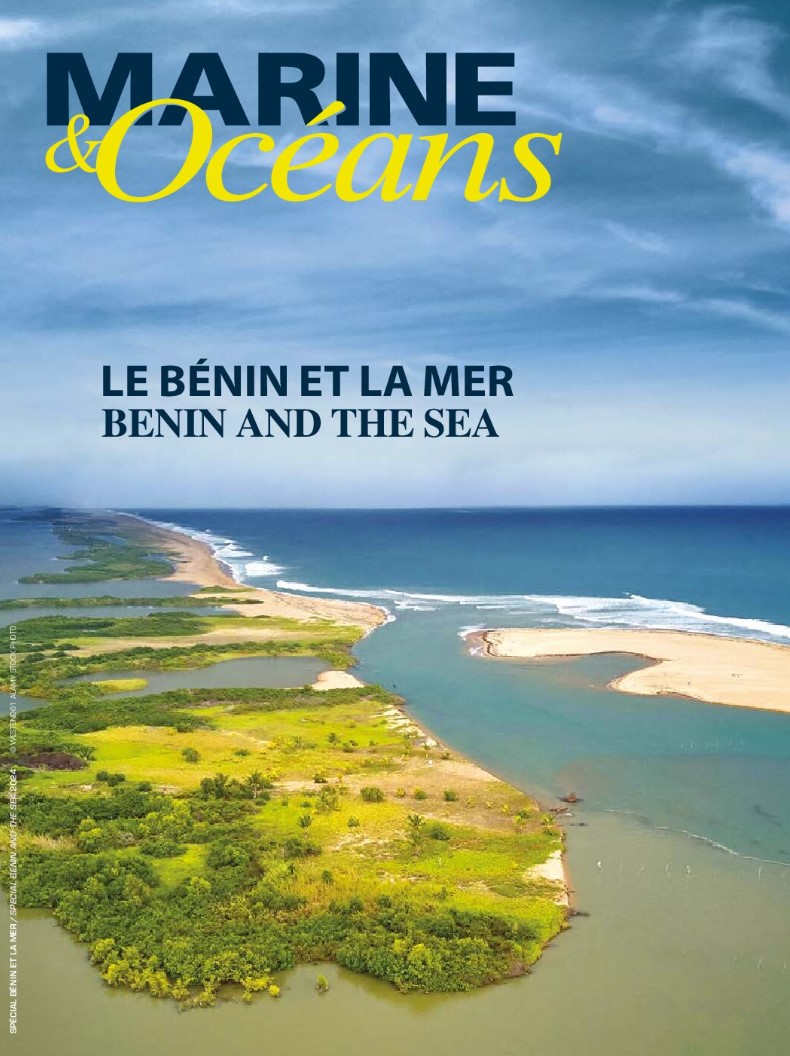Depuis le premier cas de chikungunya détecté début mars à Mayotte, importé de La Réunion où l’épidémie a explosé, 158 personnes ont été déclarées malades, selon l’Agence régionale de santé de ce territoire de l’océan Indien. Six patients atteints de cette maladie, qui se transmet via le moustique tigre et provoque fièvre et douleurs articulaires sévères, sont actuellement hospitalisés, indique l’ARS.
« Nous craignons une propagation rapide des cas sur l’ensemble du territoire, nous en avons déjà détecté dans 15 des 17 communes » de l’archipel, alerte Mohamed Zoubert, directeur de cabinet du centre hospitalier de Mayotte (CHM), situé à Mamoudzou, le chef-lieu.
« A La Réunion, plus de 160.000 cas ont été recensés selon les consultations de médecine de ville. A Mayotte, il est impossible d’absorber autant de consultations, nous n’avons que 35 médecins généralistes », s’inquiète Tanguy Cholin, chef du département de la sécurité et des urgences sanitaires au sein de l’ARS.
Sur l’île voisine de La Réunion, où les capacités hospitalières sont trois fois plus importantes pour 2,7 fois plus d’habitants selon l’Insee, l’épidémie, qui a fait 12 morts, semble ralentir, sans nouveau décès signalé ces derniers jours.
Le « plan blanc », qui permet notamment de rappeler des personnels médicaux en congés, a été déclenché par le CHU le 4 avril.
Quelques jours plus tôt, une trentaine de médecins urgentistes alertaient leur direction sur la saturation du service, dans un courrier consulté par l’AFP.
– ARS « pas en alerte » –
Mais à Mayotte, où seulement quelques médecins urgentistes sont en poste sur les 37 nécessaires pour faire fonctionner le service, ce risque est plus élevé, et les effectifs pourraient diminuer davantage.
« A partir du 26 mai, il n’y aura quasiment plus de médecins au SMUR » (structure mobile d’urgence et de réanimation), assure une soignante, souhaitant rester anonyme. « On va être en déficit médical sévère », s’inquiète un autre.
Pour Tanguy Cholin, de l’ARS, il y a « un enjeu de freinage de la maladie encore plus important qu’à La Réunion ». « On risque de voir de nombreux malades arriver directement à l’hôpital car on n’a pas suffisamment de médecins de ville », souligne-t-il.
Avec 89 médecins généralistes et spécialistes pour 100.000 habitants contre plus de 330 dans l’Hexagone en 2023 selon l’Insee, l’archipel est le plus grand désert médical de France et connaît des problèmes d’attractivité.
L’ARS se veut toutefois rassurante. « La maladie circule localement, surtout en Petite-Terre, dans la ville de Pamandzi et à Mamoudzou. Mais au vu du nombre de cas et du nombre de passages aux urgences, nous ne sommes pas en alerte », souligne Maxime Ransay-Colle, médecin de santé publique et conseiller médical du directeur général de l’ARS de Mayotte.
Par ailleurs, environ « 20% de la population est immunisée », renchérit Tanguy Cholin. Lors d’une précédente épidémie de chikungunya en 2005-2006, 40.000 personnes avaient été atteintes, soit 30% de la population de Mayotte, selon un rapport de l’Assemblée nationale.
Pour tenter de contenir la maladie, l’ARS intensifie sa lutte anti-vectorielle, en démoustiquant ou en vidant les réceptacles d’eau stagnante dès qu’un cas est déclaré.
Mais à Mayotte, l’eau stagnante est partout, chaque foyer faisant des réserves pour parer aux fréquentes coupures d’eau.
Cinq mois après le passage dévastateur du cyclone Chido, de nombreux déchets s’amoncellent encore dans les rues, or ils favorisent la prolifération de gîtes larvaires, souligne Julie Durand, directrice adjointe de la santé publique au sein de l’ARS. « On sensibilise la population pour que les bassines et les poubelles de stockage d’eau soient couvertes », et ainsi diminuer le risque, indique-t-elle.