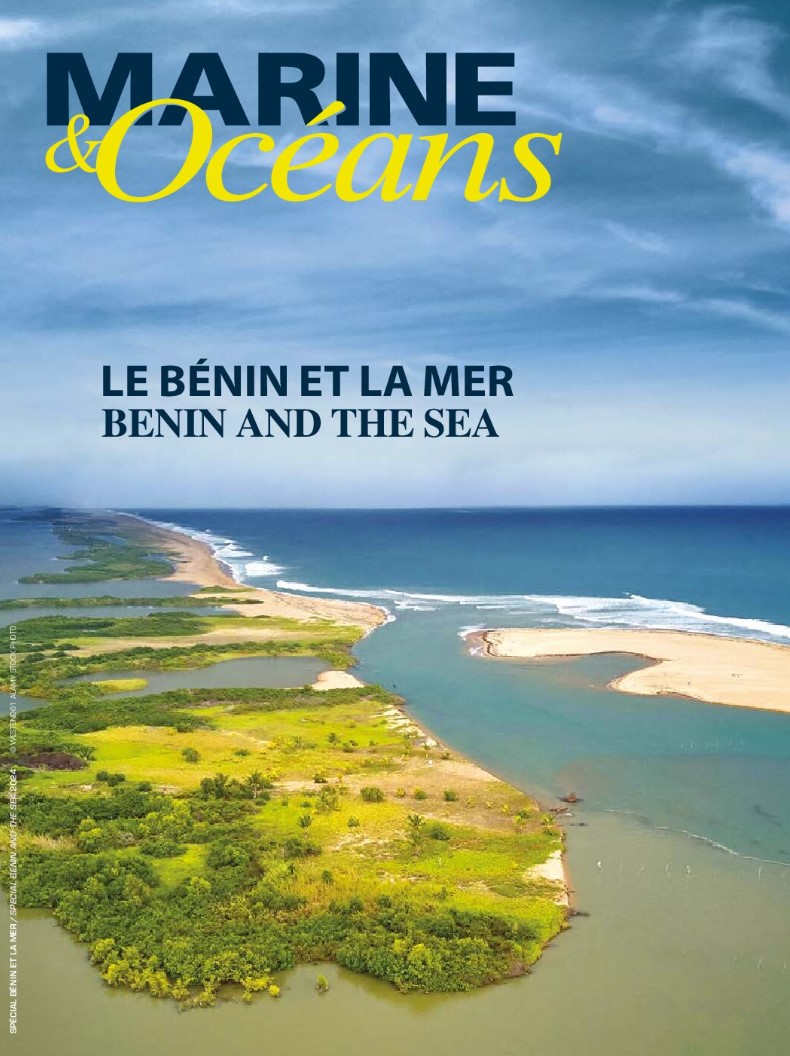A la mi-juillet, un chargement de 200.000 larves d’huîtres accrochées à des matériaux biodégradables a été déposé à 30 mètres de fond au niveau de cette épave, dans une zone protégée interdite de pêche et de dragage.
Ce projet environnemental, baptisé « Belreefs », contraction de Belgique avec le mot anglais signifiant récif, a pour objectif de créer à partir de ce dépôt un sanctuaire de biodiversité, qui profiterait des vertus bienfaisantes des récifs d’huîtres, expliquent ses promoteurs.
« Jusqu’à la fin du 19e siècle, la mer du Nord et les eaux européennes étaient pleines de ces récifs d’huîtres plates, mais la surpêche, le changement climatique et une maladie due à un parasite les ont fait disparaître », explique à l’AFP Vicky Stratigaki, une ingénieure qui a travaillé sur le projet pour le groupe de construction maritime Jan De Nul.
L’idée est de les faire lentement revenir, de manière naturelle et spontanée. En tirant les enseignements de cette expérience-test.
« Si l’on démarre avec 200.000 huîtres à l’état de larves, qui est un chiffre élevé, c’est que seulement 30.000 d’entre elles devraient être capables d’atteindre l’âge adulte et de pouvoir ensuite se reproduire ».
« Il y a beaucoup de prédation en mer, c’est un environnement sauvage », poursuit l’experte.
L’objectif ici n’est pas de les récolter ni de les commercialiser. Mais le postulat de base est que les huîtres sont des éléments essentiels de l’écosystème marin.
« Recréer ces récifs est une priorité car ils offrent des abris et de la nourriture à toutes sortes d’espèces qui pourront s’y développer, des poissons, des algues, etc. », fait valoir Merel Oeyen, experte du milieu marin au ministère belge de la Santé et de l’Environnement.
Le coup d’envoi de « Belreefs », projet du gouvernement belge soutenu par des financements européens, est l’aboutissement de deux ans de travail, au cours desquels il a fallu sélectionner le meilleur endroit où larguer les larves d’huîtres.
Le lieu choisi est celui qui a vu un cargo couler en 1906, à environ 30 km au large d’Ostende, devenu au fil du temps une sorte de musée sous-marin.
« En Belgique, chaque épave présente depuis plus de 100 ans dans les fonds marins devient automatiquement classée au patrimoine culturel. Elles égaient la curiosité des plongeurs et ce sont aussi des +hot spots+ pour la biodiversité », souligne Merel Oeyen.