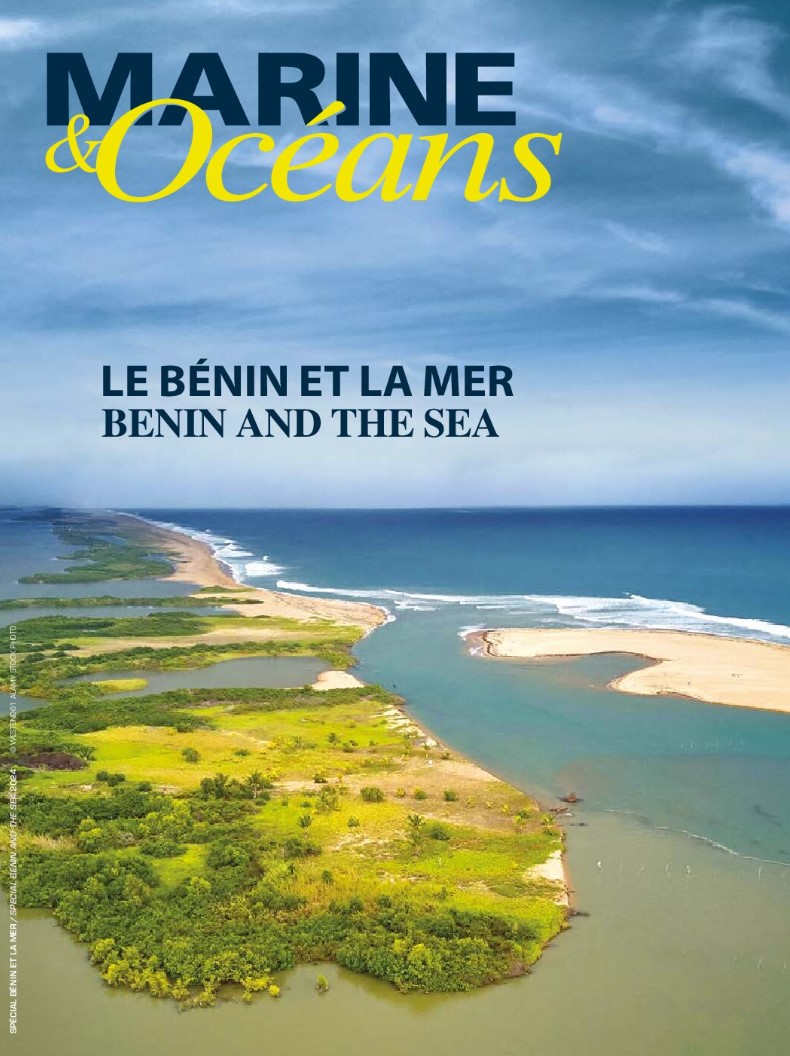« En principe, le manioc met un an pour arriver à maturation, mais on le coupe à six mois pour être sûr d’avoir quelque chose. On récolte forcément moins, alors que c’est le manioc qui nourrit les familles ». Debout à côté d’un tas de tubercules déterrés, Estever Martin, chef du village amérindien de Trois-Palétuviers à la frontière guyano-brésilienne, décrit ce qu’il nomme « la maladie du manioc ».
Elle rend « la tige noire, les feuilles flétries » et résiste « au brûlis et aux produits phytosanitaires, comme si la terre elle aussi (était) contaminée », raconte-t-il.
Cette maladie non identifiée qui ravage les cultures a été découverte dans la région du Haut-Maroni (sud), en 2022.
Depuis, le pathogène s’est étendu à toute la Guyane et dans l’Etat brésilien voisin de l’Amapa avant que ne soit lancée, en juin 2023, une alerte phytosanitaire par la Fédération régionale de défense contre les organismes nuisibles (Fredon), en charge de la surveillance biologique du territoire.
« Nous n’étions plus au stade de début de l’épidémie mais déjà à celui de la catastrophe », détaille Antoine Chourrot, ingénieur agronome à la Fredon.
Dans certaines zones du Haut-Maroni, la perte de production est « de l’ordre de 60 à 90% », estime Nathan Astar, de la chambre d’agriculture de Maripasoula. « Mais tout quantifier est difficile car la majorité de l’agriculture est faite de manière familiale et informelle en abattis », des parcelles agricoles en forêt, poursuit-il.
Conséquence: le prix du couac, farine de manioc très consommée, a été multiplié par deux en quelques mois. « C’est pourtant le féculent de base en Guyane, l’équivalent du pain. Il coûte aujourd’hui plus cher que le poulet », se désole Antoine Chourrot.
– « Un business » –
Jusqu’ici, les pistes explorées par la Fredon – chancre du manioc, piste entomologique – pour comprendre l’origine de la maladie n’ont rien donné. « Il reste la piste des virus, des phytoplasmes, des champignons et de toutes les bactéries que l’on n’a pas cherchés. Cela peut prendre des années », résume l’ingénieur agronome.
En attendant, « trouver des boutures saines est de plus en plus difficile », regrette Jacob Jutte, animateur de l’association Panakuh, le principal groupement d’agriculteurs de l’est guyanais. Selon lui, « un vrai marché des boutures » (le manioc se duplique par bouturage, ndlr) a remplacé le troc qui jusqu’alors prédominait.
« Tout ce système traditionnel est en train de se modifier et de se monétiser », explique-t-il.
Attirés par les perspectives économiques, de nombreux agriculteurs ont ainsi relancé des parcelles de manioc dans le bassin d’Iracoubo, sur le littoral guyanais, moins touché par la maladie.
« C’est devenu un business », confirme Thierry Gardeux, le président de l’Association des agriculteurs des Savanes à Iracoubo, qui voit des agriculteurs d’autres régions venir acheter des « bâtons de manioc sains ».
– Diversité biologique –
C’est sur cette problématique du bouturage que se concentre le groupe de travail sur le manioc, créé spontanément au début de l’épidémie et au sein duquel coopère notamment la Collectivité territoriale de Guyane et le Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement (Cirad).
« Il faut poursuivre l’effort sur la recherche mais ne pas tout concentrer dessus. Produire des boutures saines pour pouvoir replanter des parcelles et améliorer les pratiques est la principale problématique », estime Margaux Llamas, chercheuse au Cirad et animatrice du groupe de travail.
Avec un budget de 200.000 euros, le Cirad va installer des petites serres dans les bassins de production qui permettront d’assainir des boutures par procédé thermique.
D’après Margaux Llamas, le Cirad va aussi « créer une collection agronomique du manioc pour sauvegarder cette diversité biologique ».
Cette crise fait émerger une réflexion à plus long terme sur la nécessité de préserver cette plante du bassin amazonien. Car l’abattis – parcelle cultivée via l’agriculture itinérante sur brûlis – « est une part de l’identité culturelle des gens et le manioc est la plante phare de ce système », résume Jacob Jutte.