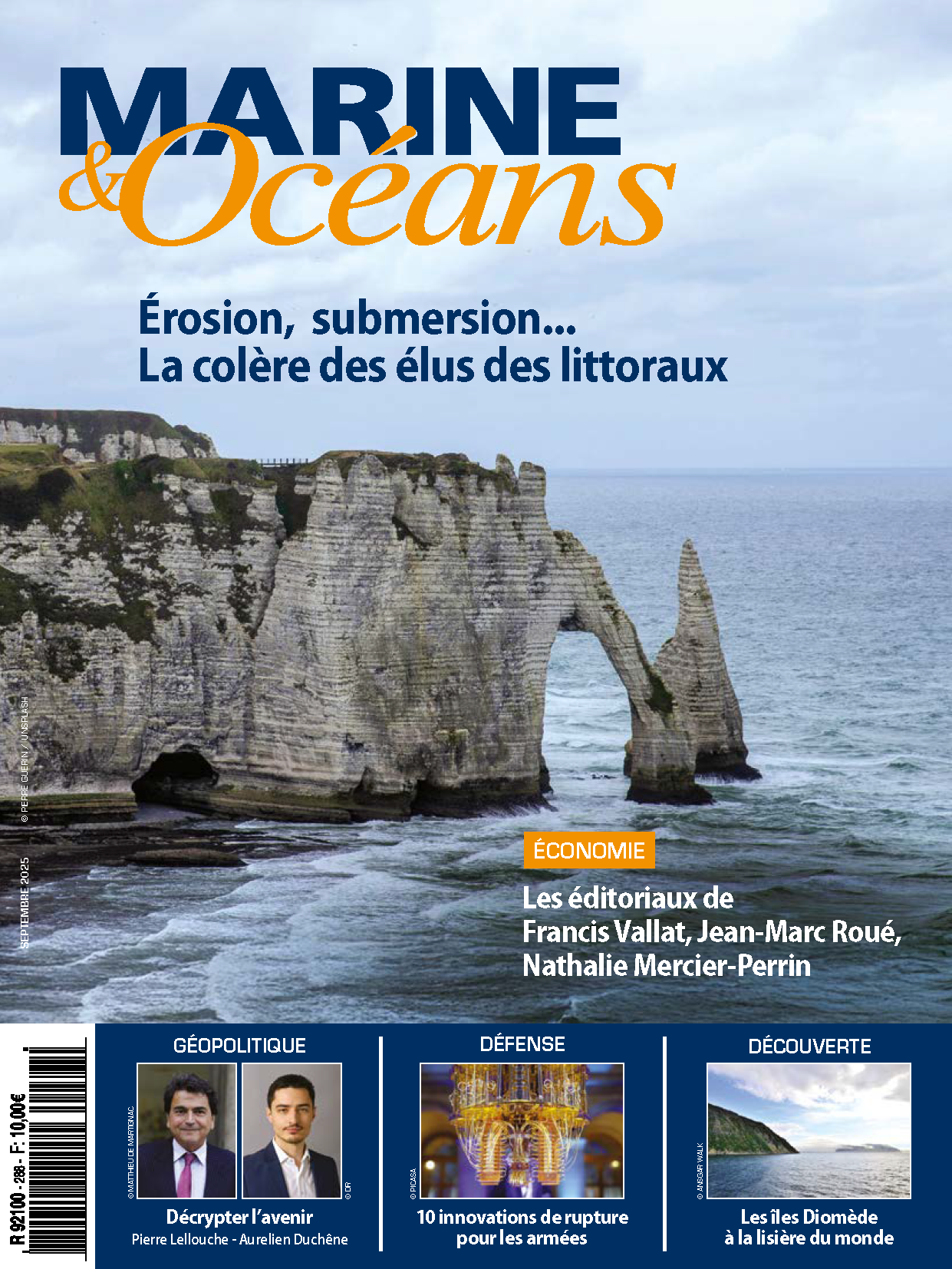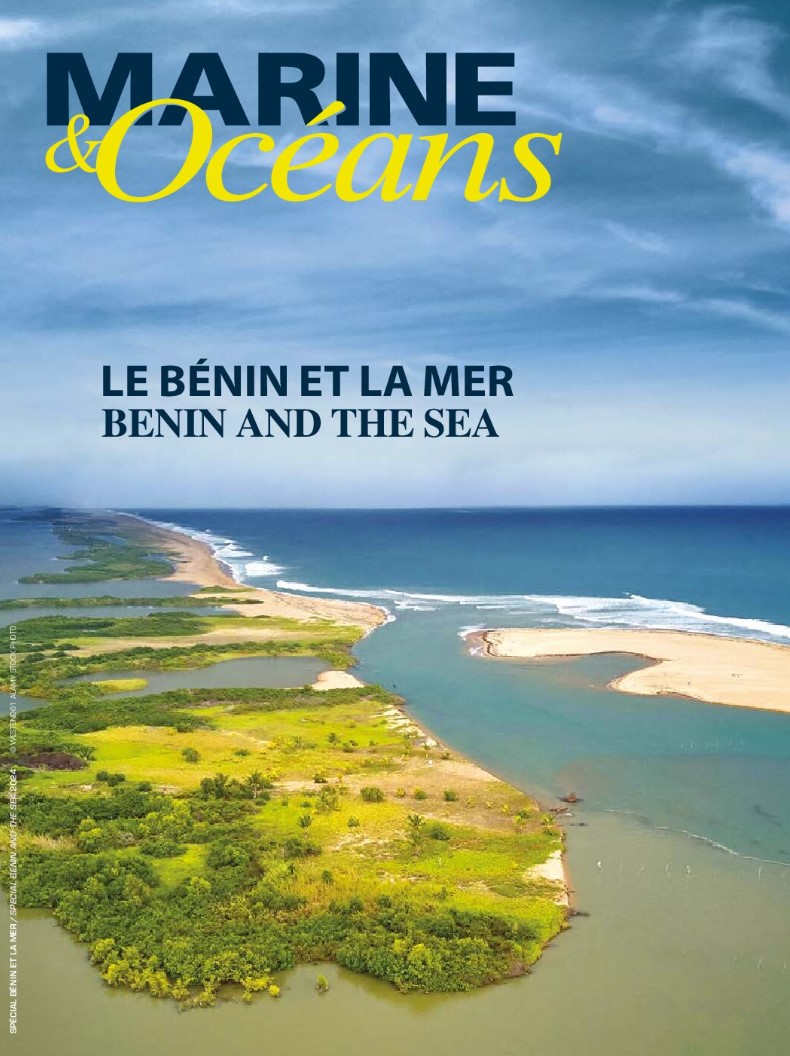« On est clairement dans un cas d’école de l’exemple à ne pas suivre », estime Edouard Le Bart, directeur Europe du Sud de l’association Marine Stewardship Council (MSC).
Car le tableau est sombre: la population de maquereaux de l’Atlantique Nord-Est est tombée dans une zone de danger où sa reproduction n’est plus assurée. De près de 13 millions de tonnes en 2014, la biomasse des maquereaux en âge de se reproduire s’est écroulée à moins de 3 millions de tonnes en 2025, d’après les estimations du Conseil International pour l’Exploration de la Mer (Ciem).
« Depuis de très nombreuses années, on prélève trop par rapport à ce qui est préconisé. Et en prélevant trop, on met la biomasse dans une situation où elle a du mal à se régénérer », explique Youen Vermard, chercheur en halieutique à l’Ifremer.
En 2024, les captures de ce poisson, qui se pêche de Gibraltar au Groenland, ont avoisiné les 900.000 tonnes, soit l’équivalent de plus de deux fois l’ensemble de la pêche française, toutes espèces confondues.
Pour que le stock ait une chance de se rétablir en 2026, les scientifiques estiment qu’il faudrait diviser les quotas par… quatre.
– « J’en dors mal »-
Une telle baisse de quotas représenterait une catastrophe pour des milliers de pêcheurs européens, du petit ligneur au navire-usine, qui dépendent du maquereau tout ou partie de l’année. « J’en dors mal la nuit », lâche Philippe Perrot, ligneur brestois de 56 ans. Dans le Pas-de-Calais, Étienne Dachicourt, directeur de la coopérative maritime étaploise (CME) s’attend à avoir une trentaine de bateaux à quai, en mai prochain, en pleine saison du maquereau.
« Si je n’ai pas de solution de pêche, on envoie les bateaux faire quoi? », s’interroge-t-il.
La mauvaise santé de la population de maquereaux risque aussi d’affecter oiseaux, mammifères marins et grands thons, car « c’est une espèce fourrage qui nourrit tous les maillons supérieurs de la chaîne alimentaire », souligne Didier Gascuel, professeur en écologie marine à l’Institut Agro de Rennes.
A l’origine de ce désastre annoncé: le réchauffement climatique. En quête d’eaux plus froides, le maquereau a migré vers le Nord au début des années 2000, entrant dans les eaux islandaises, où il était jusque-là pratiquement inconnu.
Les pêcheurs islandais ont commencé à le cibler, augmentant leurs captures de 53 tonnes en 2002 à plus 150.000 tonnes/an dès 2011. Même scénario aux îles Féroé, un territoire autonome du Danemark, où la pêche au maquereau a décuplé au tournant des années 2010.
Face à cette nouvelle donne, les autres États côtiers (Norvège, Royaume-Uni, Russie, Union européenne) ne sont pas parvenus à s’accorder sur une nouvelle répartition des quotas, permettant de faire de la place aux nouveaux entrants. Chaque pays s’est mis à fixer ses quotas unilatéralement. Et, cumulés les uns aux autres, ils ont abouti à une surpêche massive.
-« Problème politique »-
Depuis 2010, le cumul des quotas unilatéraux a ainsi dépassé de 39% les recommandations scientifiques, selon le Ciem. « Le problème est beaucoup plus politique que biologique. Le stock s’est déplacé mais il aurait très bien pu rester encore abondant s’il avait été bien géré », souligne Clara Ulrich, coordinatrice des expertises halieutiques à l’Ifremer.
Cette mauvaise gestion est d’autant moins pardonnable que ces États européens « ont tous les moyens techniques et scientifiques » permettant de bien gérer cette ressource, ajoute Édouard Le Bart.
Le cas du maquereau est emblématique car il laisse présager de nouveaux conflits similaires sur d’autres poissons migrateurs. Ceux-ci, en se déplaçant, vont tester la capacité des systèmes de gouvernance des pêcheries à s’adapter au changement climatique.
« Ce qui se passe pour le maquereau va se passer sur de nombreuses autres espèces », prévient Clara Ulrich. « Mais le maquereau, c’est juste plus tôt, plus vite, plus fort. Et plus compliqué, parce qu’il y a plus d’acteurs. »