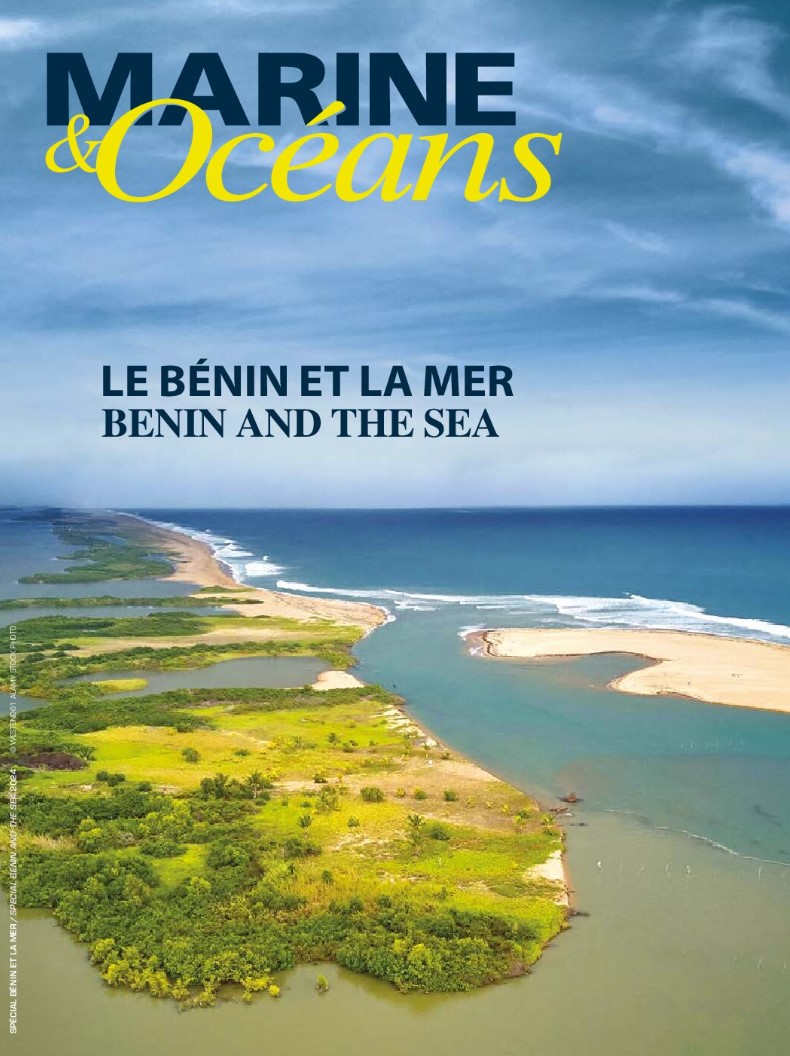La mondialisation est, somme toute, une notion mystérieuse, mais qu’on ne cesse d’utiliser dans la rhétorique politique la plus large. On a cru qu’elle relevait de l’économie, voire qu’elle était synonyme de libéralisme, voire d’ultra-libéralisme, alors qu’elle déborde de ce champ pour inclure toutes les dimensions de l’activité humaine.
On a pensé qu’elle pouvait désigner l’occidentalisation du monde et, partant, sceller la fin de l’Histoire, alors qu’elle conduit en fait à la contestation des modes hégémoniques et au retour du particularisme. On l’a imaginée comme unification, alors qu’elle implique de nouvelles fragmentations, jusqu’à consacrer souvent le retour du communautarisme…
Les historiens, de leur côté, parlent volontiers d’une « succession » de mondialisations, rythmant les changements depuis l’aube du XIXe siècle. Que le monde ne cesse de changer est une évidence, qu’il le fasse en s’ouvrant à des terrae incognitae en est une autre. Mais il faut pourtant être plus précis : il y a, dans la mondialisation d’aujourd’hui, quelque chose d’irréductible et qui tient d’abord à l’essor de la technologie. Nous sommes entrés dans un monde de la communication immédiate, celle qui s’effectue à l’échelle des individus, c’est-à-dire de 7 milliards d’acteurs, sans délai et presque sans contrôle. Nous sommes entrés dans un monde qui, avec le renfort de nouveaux moyens de transport, a aboli la distance, relativisé les territoires, amolli les frontières et démantelé la part la plus dure des souverainetés.