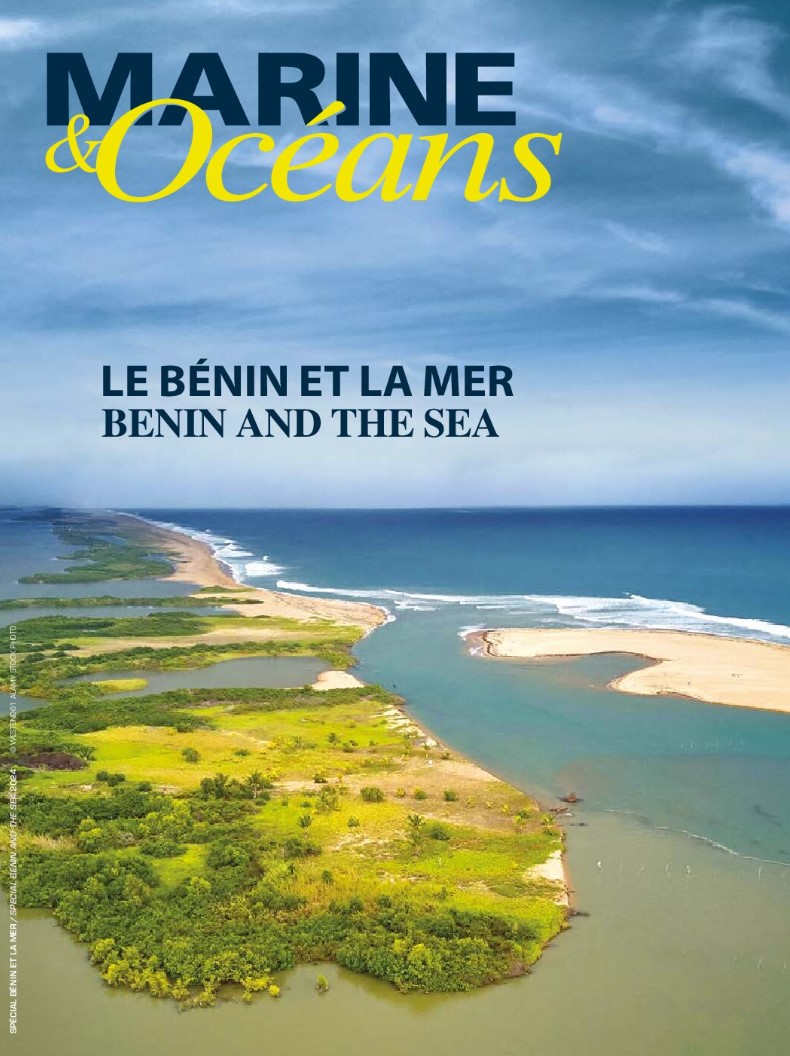Britanniques et Européens sont arrivés au terme d’une procédure de divorce sans consentement mutuel. Comment expliquer ce Brexit qui ébranle et interpelle le continent ?
Le 23 juin 2016, un coup de tonnerre ébranlait le vieux continent. Les Britanniques se prononçaient pour le Brexit et larguaient les amarres avec l’Union européenne (UE). Ils renouaient ainsi avec une constante de leur culture stratégique aussi hermétique aux Français que la sauce à la menthe ou l’ale (ndlr, bière) tiède. Londres n’a pas choisi de tirer son épingle du jeu bruxellois par hasard. L’appel du « Grand Large », selon les mots de Winston Churchill, est une fois encore le plus fort. Il répond à une vision du monde spécifique et à une culture du combat originale. Il nous rappelle aussi combien nos amis d’outre-Manche ne sont pas des européens comme les autres. Mais le sont-ils seulement ? Une culture stratégique ne constitue évidemment pas un modèle fermé mais un entrelacs de tendances et d’esquisses. Celle des Britanniques explique leur prise de distance avec le projet européen. Elle éclaire leurs réactions et leurs priorités et pourrait même enrichir nos propres approches dans un cadre mondialisé de « persistant competition », théorisée en 2020 par le chef d’état-major de l’Armée britannique, le général Nick Carter.
Les îles britanniques ont longtemps constitué un monde clos en périphérie du monde, aux marges de l’Europe. Avec quelques plaines à orge en Est-Anglie ou des pâturages à moutons dans le Devon, l’Angleterre avait plus d’ambition que de ressources. Sa fortune commence avec Elizabeth 1ère. Pavé d’or et d’argent, le nouveau monde espagnol excite sa jalousie et ses convoitises. Encouragé par la souveraine, Francis Drake se risque dans les Antilles qu’il désole, et ravage la côte Pacifique de l’Amérique. Parti vers l’Ouest, il revient par le Levant chargé d’un butin dépassant les revenus annuels de la Couronne, après avoir réalisé le second tour du monde de l’histoire. La mer était un espace. Elle est devenue une opportunité. Gentry, banquiers et armateurs anglais pensent dès lors commerce mondial et politique globale. Ils se croyaient excentrés, ils découvrent que le centre du monde n’est pas géographique mais financier et que leurs vaisseaux peuvent tracer de nouveaux circuits commerciaux. Ils redessinent alors à leur profit un système-monde dont ils sont la charnière.
Au commencement de la puissance anglaise étaient la mer et la banque. La prospérité et la puissance britanniques se constituent progressivement autour de l’Amérique, du Bengale, de l’Océanie. Vues de Londres, les politiques mondiales rivales françaises ou germaniques semblent euro-centrées et terriblement provinciales. A la maîtrise des mers s’ajoute celle des flux financiers dont Londres devient, dès le XVIIIe siècle, une place incontournable. Aujourd’hui encore, l’Angleterre base sa prospérité sur le crédit et une puissance financière que Paris n’a jamais su véritablement comprendre ni maîtriser. D’où un tropisme libéral difficilement compatible avec les velléités régulatrices européennes.
Préserver ses forces et sa liberté
On s’est beaucoup interrogé sur le génie stratégique de l’Angleterre. Il tient en quelques mots : réserver ses forces. Protégés par leur insularité, les Britanniques n’ont pas connu l’impératif de la garde aux frontières, qui consomme les ressources et les hommes. Pendant que leurs rivaux européens dilapidaient leur or en canons, décimaient leur jeunesse sous le feu, brûlaient des villes avec leurs habitants et leurs marchandises, Londres investissait dans de bons navires propres au commerce autant qu’à la guerre, et peuplait les espaces vierges ultramarins de colons prospères et travailleurs. Quand un rival prétendait lui en remontrer, on lui suscitait une guerre continentale où il s’épuisait. Il ne restait plus qu’à exercer une pression navale au bon moment pour s’en débarrasser. Les conquêtes de l’Amérique du Nord, de l’Inde, de l’Océanie ou de l’Afrique orientale n’ont quasiment rien coûté à la Couronne. Elle a avancé ses pions dans ces espaces lacunaires pendant que les grandes puissances européennes s’épuisaient mutuellement. Sa puissance ne s’est paradoxalement pas tant constituée par la force que par l’abstention. La puissance, justement, est une relation, un exercice. Elle est aussi un capital que l’on peut risquer ou placer pour le faire fructifier mécaniquement. Ce dernier choix résume la politique de l’Angleterre. Simultanément, elle a longtemps encouragé ses grands rivaux continentaux à jouer le leur sur le « tapis vert militaire », se réservant le rôle de la banque et raflant invariablement la mise. Aussi a-t-elle toujours refusé les systèmes contraignant sa liberté d’action. Même face à la menace allemande, au début du siècle dernier, elle se contente d’une Entente Cordiale avec la France qui la laisse libre de ses mouvements. Elle refuse pour les mêmes raisons de garantir militairement le Traité de Versailles. Si elle finit par intégrer la Communauté européenne, en 1973, ce n’est que pour accéder à un marché libre. Plus la Commission étendra son influence, plus Londres sera réticente jusqu’à se rebiffer, rompre et retrouver le rôle d’observateur extérieur qui l’a tant servi par le passé.
Des investissements judicieux
En hommes d’affaire avisés, les Britanniques se méfient des aventures. Ils n’aiment pas plus les aventuriers et ne croient pas tant au génie individuel qu’à une bonne planification et à des investissements judicieux. Leur grand homme est Nelson, personnage borné, tatillon comme un inspecteur des impôts. Courageux, méthodique et banal, il était le chef idoine pour diriger sans risque et avec professionnalisme une flotte sûre de sa force. La mort à Trafalgar de ce haut fonctionnaire du combat naval n’a d’ailleurs rien changé au cours d’une bataille que la Royal Navy devait gagner par la supériorité de son organisation et de ses moyens. L’Angleterre a l’incertitude en horreur et ne combat qu’avec de fortes probabilités de vaincre, ou se dérobe. Son grand art est de structurer l’environnement pour mettre en place les conditions de la victoire. Sa politique n’est pas celle du choc mais de la poussée progressive portant sur la cohérence de l’ennemi plutôt que sur ses forces vives. On ne trouve donc pas dans son histoire l’équivalent d’un Suffren rafistolant ses navires de bric et de broc, compensant le manque de moyens par l’art flamboyant de la bataille et de l’improvisation. Peu de peuples aiment autant l’ordre et l’organisation que les Britanniques. A ce titre, l’Union Européenne, avec ses institutions perfectibles et ses compromis a minima entre des partenaires trop nombreux tirant à hue et à dia, pouvait difficilement gagner leur confiance. Très attachés à leurs libertés et au double exercice de la souveraineté populaire et nationale, ils sont culturellement réticents aux délégations de souveraineté, à plus forte raison auprès d’un organisme comme l’Union européenne, réputé peu démocratique outre-Manche. Enfin, leur culture est pragmatique. Le messianisme à la française leur est étranger. Lors des débats sur le Brexit, le thème romantique d’une Europe à bâtir a été totalement absent : les deux camps se sont déchirés sur l’estimation des dividendes nationaux à escompter du départ ou du maintien dans l’UE. Un homme politique qui aurait déclaré « croire » ou « ne pas croire » en l’Europe serait passé pour un doux illuminé. L’Anglais aime les espèces et les faits. « I want my money back », assène-t-il aux vendeurs de lendemains qui chantent.
Le réseau du Commonwealth
La petite Angleterre a longtemps manqué d’hommes. Sa culture stratégique périphérique s’en ressent. Elle vise les centres nerveux de ses adversaires et tisse le filet dans lequel ils vont s’empêtrer. Stratégie des carrefours, elle se déploie en réseaux en s’appuyant sur le renseignement, la communication et l’information. Le développement impérial britannique s’est originellement appuyé sur des positions stratégiques clefs, comme Gibraltar. Pendant que Napoléon faisait l’Europe à coup de canon et de Code civil, l’Angleterre mettait la main sur Le Cap, l’île Maurice et Ceylan, chevilles de l’axe stratégique qui lui assurerait pour un siècle le contrôle de la route des Indes et des circuits commerciaux de Chine. La nostalgie carolingienne lui est étrangère. Que ses rivaux s’agitent dans le petit espace compris entre l’Atlantique et l’Oural si cela leur chante, elle voit pour sa part beaucoup plus loin. Si l’empire n’est plus qu’un souvenir glorieux, le réseau du Commonwealth en offre un large substitut, riche de promesses – mais peut-être aussi d’illusions. Géant démographique déchu au XIXe siècle, la France se souvient d’avoir été forte parce qu’elle était l’Etat le plus peuplé d’Europe. Elle en conserve une angoisse de la dégradation de son poids démographique. L’obsession de la taille critique a joué un rôle majeur dans son acceptation du projet européen. L’Angleterre, elle, n’a pas de ces complexes : elle a dominé à elle seule un quart de la population mondiale au temps de son apogée victorienne et en a retenu que la puissance n’est pas tant relative à la masse qu’à la liberté d’action.
L’Angleterre n’est pas seule
De surcroît, l’Angleterre n’est pas seule. Elle a, certes, laissé échapper un sceptre impérial devenu trop lourd pour elle après la Deuxième Guerre mondiale mais celui-ci, ramassé par les Américains, n’est pas sorti de la famille anglo-saxonne. La pilule du déclin est passée avec une gorgée de Coca. Les intérêts de Londres sont si indissolublement liés à ceux de Washington que la dissuasion nucléaire britannique elle-même n’est pas autonome, mais construite sur un modèle d’interdépendance avec les forces stratégiques américaines. Tout en éprouvant une légère condescendance à l’égard de leurs trop puissants cousins, les Anglais jouent d’une évidente parenté culturelle et d’intérêts partagés pour revendiquer une relation spéciale. Aussi ne se perçoivent-ils pas comme dépendants des Etats-Unis, à l’instar des autres peuples européens, mais comme leurs premiers alliés et partie prenante du condominium anglo-saxon dont les cinq nations (ndlr, États-Unis, Grande-Bretagne, Canada, Australie, Nouvelle-Zélande), partagent de fait une vision commune et entretiennent des rapports étroits, symbolisés par une collaboration sans équivalent dans le domaine souverain du renseignement : les Five Eyes. Cette dimension anglo-saxonne structure les rapports des Britanniques au monde et leur identité. En dépit des distances, ils sont généralement plus proches d’un Australien que de beaucoup d’Européens. L’autonomie stratégique de l’Europe, dont le leadership ne pourrait être que franco-allemand, n’est pas pour eux un projet mais une menace sur un ordre international qu’ils n’ont aucune raison de vouloir changer.
Keep calm and carry on
Enfin, les Anglais ignorent les sentiments d’infériorité et de culpabilité qui rongent leurs voisins continentaux. La Manche et une poignée d’aviateurs héroïques les ont préservés de l’humiliation connue par la France en 1940. En acceptant après-guerre la nécessité de la récession impériale, ils se sont épargnés les troubles qui ont déchiré l’Indochine et l’Algérie. Les Anglais ont à la fois confiance en leurs valeurs et en leur force, qualités qui se superposent à leur altérité îlienne. « Dieu et mon droit » dit leur devise, fort peu laïque, en français de surcroît. Quelles que soient les difficultés rencontrées sur la voie alternative à celle de l’Union Européenne qu’ils ont choisie, leur volonté collective et leur résilience historique leur permettront d’en venir à bout. Pour Gérard Chaliand, « la faiblesse majeure des vaincus réside dans leur conception du monde ; elles sont de l’ordre de l’esprit ». A ce titre, les Britanniques forment incontestablement un grand peuple, capable de figurer longtemps encore parmi les animateurs et les vainqueurs de la compétition mondiale. Leur fameux flegme n’est que l’expression individuelle d’une conscience collective stratégique privilégiant le temps long sur l’immédiateté, et d’une confiance justifiée en un destin national hors du commun. Keep calm and carry on…