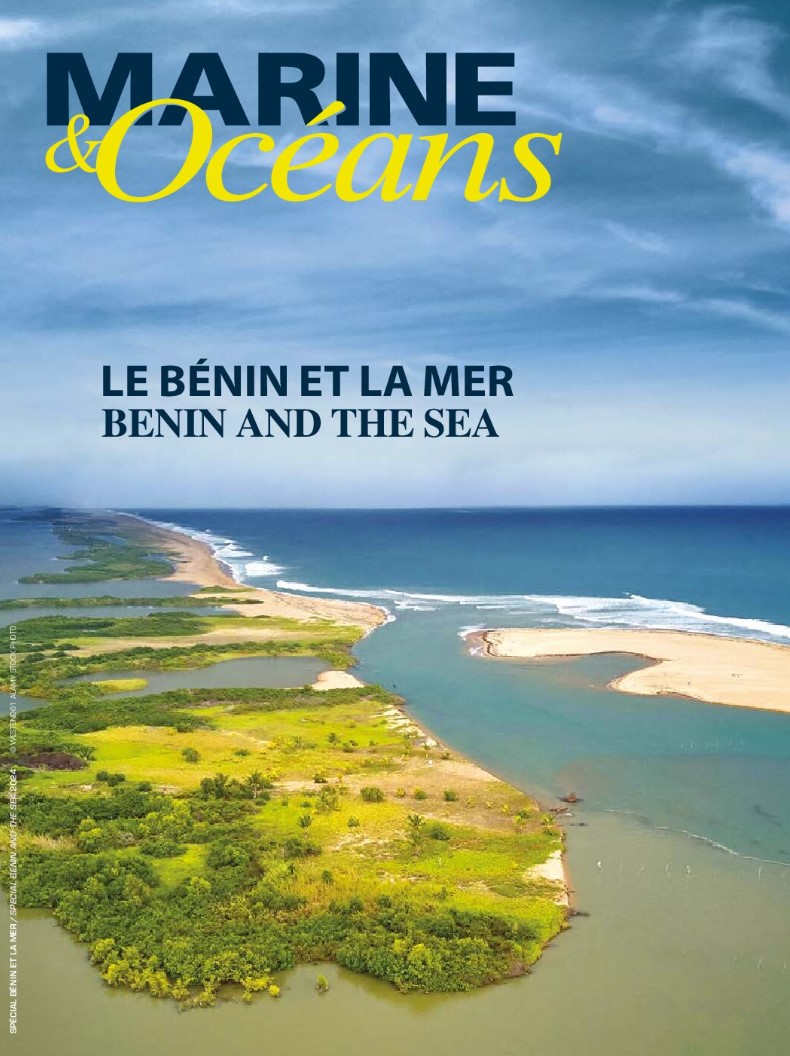En mars 2025, les acteurs du secteur financier et de l’industrie de défense se sont réunis à Bercy, soulignant l’importance cruciale du financement pour ce domaine stratégique. Cette rencontre reflète à la fois la priorité accordée par les pouvoirs publics à la compétitivité de la défense, et le rôle croissant du secteur privé dans un financement qui ne se limite plus aux dépenses régaliennes.
La défense est un secteur régalien structuré autour d’un monopsone, l’État étant l’unique acheteur. Cette configuration limite la demande et rend l’offre entièrement dépendante des commandes publiques. Pourtant, les frontières de ce secteur deviennent de plus en plus floues, notamment avec l’essor des technologies duales. L’innovation et l’outil de production nécessitent donc un recours accru à des financements privés. Face à la compétition technologique mondiale et à l’accélération des cycles d’innovation (numérique, intelligence artificielle, robotique, systèmes autonomes), une plus grande agilité financière est indispensable. Le seul financement public ne suffit plus à soutenir une innovation rapide et pérenne. Les PME et start-ups innovantes jouent un rôle clé dans la chaîne de valeur de défense. Les partenariats public-privé, ainsi que des dispositifs européens comme le Fonds européen de la défense (FED), illustrent l’importance d’une hybridation des financements. Le financement de l’innovation en matière de défense devient un levier central de souveraineté technologique et industrielle.
Aujourd’hui, une part significative de l’innovation militaire vient du secteur civil. L’État doit donc renforcer sa capacité à capter et intégrer ces innovations à usage dual, comme le fait l’Agence de l’innovation de défense (AID). La Loi de programmation militaire (LPM) 2024-2030 prévoit 10 milliards d’euros pour l’innovation, en nette hausse[1]. Mais ce budget reste cinq fois inférieur à celui des États-Unis. Des rapports récents alertent sur les difficultés d’accès au financement des PME de défense : 40 % d’entre elles rencontrent des obstacles majeurs[2]. L’étude de la direction générale du Trésor montre que ces entreprises sont souvent moins rentables, plus endettées, et donc plus dépendantes du financement extérieur[3]. Les besoins en R&D sont élevés, mais les risques associés, les cycles longs et la complexité des projets freinent les investissements privés. Cela justifie le recours à des dispositifs spécifiques, comme les fonds de capital-risque ou des garanties publiques ciblées. Dans un contexte budgétaire contraint, lever ces freins est essentiel pour transformer les hausses de dépenses militaires en avantages technologiques durables. Il s’agit de bâtir un écosystème de financement intégré, liant innovation, production et export, afin d’assurer la souveraineté économique et technologique des États européens.
Des freins persistants au financement
Plusieurs problèmes expliquent les difficultés de financement de l’innovation des entreprises de défense. Les points mentionnés ci-après ne sont pas exhaustifs. Tout d’abord l’incompréhension du secteur pour les entreprises du monde civil : les innovateurs du secteur civil rencontrent des obstacles pour accéder au marché de la défense en raison de sa complexité et de son cadre réglementaire rigide. Un des obstacles souvent cités par les entreprises civiles est le manque d’informations concernant le besoin des armées et donc les potentiels débouchés. De plus, la multiplication de dispositifs de soutien aux objectifs similaires et pas suffisamment coordonnés rend difficile la compréhension du paysage institutionnel pour les porteurs de projets innovants. Ce manque de clarté combiné à des processus d‘innovation de défense méconnus, nuisent à la qualité et à la quantité des interactions entre les acteurs mais complexifie également la mise en lien des innovateurs avec les forces militaires. Les critères ESG (Environnement, Social, Gouvernance) excluent les entreprises de défense des portefeuilles d’investissement leur rendant difficile l’accès à des financements. Les gestionnaires lorsqu’ils s’agit d’investissements dans le secteur de la défense semblent appliquer la stratégie de l’exclusion, option la plus sévère[4]. La longueur et la complexité de la procédure de passation de marché sont également des défis majeurs quand on étudie le financement de l’innovation de défense. Les PME n’ont pas forcément les ressources nécessaires permettant de supporter les cycles de développement prolongés. Ces deux facteurs créent un environnement où le financement de l’innovation de défense devient plus risqué et moins attractif.
Le contrôle à l’exportation, la procédure de mise en conformité pour les opérations à l’export et le filtrage des IDE (Ndlr, Investissements directs étrangers) sont également des éléments contraignant le financement de l’innovation : le caractère stratégique de certaines innovations si elles sont utilisées dans le secteur de la défense limite la possibilité à l’export mais également la possibilité d’avoir recours à des financements étrangers si jamais l’État le décide.
Structurer les outils de financement
Depuis 2021, l’Union européenne renforce ses instruments financiers pour soutenir l’innovation de défense. Le FED (Fonds européen de défense) et le programme EUDIS (EU Defence Innovation Scheme) jouent un rôle central en finançant la R&D. En 2024, le Fonds européen d’investissement et la Banque européenne d’investissement ont élargi leur action aux technologies duales[5]. En mars 2025, la levée des restrictions sur le financement d’équipements militaires et policiers a ouvert de nouvelles perspectives[6]. En France, plusieurs dispositifs soutiennent l’innovation[7] : DefInvest, le Fonds innovation de défense, France 2030, RAPID (pour les ETI) ou ASTRID, en lien avec l’AID. Les banques ont désigné, sous l’égide de la Direction Générale de l’Armement (DGA), un « référent défense » pour faciliter l’accès au crédit. Cependant, la multiplicité des dispositifs nuit à leur lisibilité et leur coordination. Parallèlement, les fonds d’investissement spécialisés progressent, avec la montée du private equity et de capital-risqueurs d’entreprise comme Safran, Thales ou Sopra Steria Ventures. Des initiatives comme Defense Angels, SouvTech Invest ou le fonds Bpifrance Défense favorisent l’investissement citoyen dans les PME de la BITD[8]. Ces efforts visent à mobiliser tous les leviers publics et privés pour renforcer l’écosystème d’innovation.
Financer l’IA de défense
Le développement de l’Intelligence artificielle (IA) appliquée à la défense est un enjeu stratégique majeur. Ce domaine exige des investissements massifs et des cycles de développement longs. En 2024, les investissements privés mondiaux ont atteint des sommets. Les États-Unis dominent largement, devançant la Chine, l’Union européenne et le Royaume-uni.
Le modèle Llama 3 (Meta) aurait coûté près de 500 millions de dollars, GPT-4 (OpenAI) entre 100 et 500 millions. Bien que le développement de DeepSeek ait coûté environ 5,6 millions de dollars[9], soit un montant 100 fois inférieur à celui des modèles précédemment cités, cette somme reste élevée comparée aux investissements actuels dans l’IA de défense. Ces montants excluent souvent les coûts de personnel, d’infrastructures, de données ou d’expérimentation. Néanmoins, la baisse progressive des coûts d’entraînement rend certains projets plus accessibles aux nouveaux entrants.
En avril 2025, OpenAI a levé 40 milliards de dollars[10]. En Europe, Comand AI a levé 8,5 millions d’euros fin 2024[11], Alta Ares 2 millions en mai 2025[12]. Ces chiffres reflètent la convergence croissante entre innovation civile et besoins militaires, mais aussi la dépendance européenne aux financements étrangers. L’IA de défense bénéficie d’effets de diffusion importants, notamment dans la santé, l’industrie, la cybersécurité ou la logistique. Cela favorise les montages hybrides de financement, mais pose des questions de souveraineté et de régulation.
La LPM 2024-2030 consacre 2 milliards d’euros à l’IA. Pourtant, les entreprises françaises peinent à accéder aux fonds de croissance. Le cas de Preligens est révélateur : faute d’investisseurs européens spécialisés, l’entreprise a dû se tourner, dans un premier temps, vers des capitaux étrangers[13]. L’équilibre entre recherche fondamentale – souvent peu rentable à court terme – et développement rapide reste difficile. Les partenariats public-privé, associant grands groupes, startups et laboratoires, sont essentiels pour mutualiser les risques et accélérer l’innovation.
À cela s’ajoutent les contraintes réglementaires liées à l’exportation de technologies sensibles, complexifiant encore les stratégies de financement. L’Union européenne tente d’y répondre via le FED ou l’EDIDP (Programme européen de développement industriel dans le domaine de la défense), pour stimuler un écosystème compétitif et souverain. En 2025, Mistral a signé un accord avec Nvidia pour développer un cloud européen autonome. Ce projet ambitieux implique une levée de fonds estimée à un milliard d’euros. Les 600 millions récemment obtenus par Mistral n’auraient pas été possibles sans fonds étrangers. Par ailleurs, l’accord franco-émirati pour construire un campus européen de l’IA, avec un data center de pointe, illustre les limites actuelles de l’autonomie technologique et financière. Le financement de l’innovation en IA de défense, mêlant investissements lourds, choix stratégiques et régulations, est un enjeu crucial. Pour garantir sa souveraineté technologique, l’Europe doit renforcer ses soutiens et son écosystème d’investissement afin de préserver sa maîtrise et sa compétitivité.
Améliorer le financement
Plusieurs leviers peuvent renforcer le financement de l’innovation de défense :
D’abord, mieux organiser les dispositifs existants pour faciliter l’accès aux ressources et coordonner les investissements publics et privés. Ensuite, garantir des contrats fermes aux entreprises innovantes. Ces engagements offrent une visibilité précieuse, essentielle pour investir sur le long terme. Il est également nécessaire de lever les freins liés à l’investissement responsable. Clarifier que les critères ESG ne sont pas incompatibles avec les activités de défense permettrait d’attirer davantage de capitaux durables. L’adaptation des pratiques d’achat public est un autre levier. En soutenant davantage les startups et en incitant les acheteurs à prendre des risques, l’État peut favoriser les innovations de rupture. Enfin, la création d’une incitation fiscale dédiée à l’innovation de défense encouragerait l’épargne privée à s’orienter vers ce secteur stratégique.
En combinant ces mesures, l’Europe pourrait significativement améliorer sa capacité à financer l’innovation et renforcer sa souveraineté technologique.
En conclusion, l’innovation de défense avance, et les signaux sont encourageants. Mais les dispositifs restent trop dispersés, peu lisibles, et difficiles à mobiliser pour les jeunes pousses. La France dispose pourtant d’atouts : un tissu de startups dynamiques, des laboratoires performants, une BITD solide. Ce qui manque, c’est une meilleure articulation des outils, plus de clarté, plus de réactivité. Il faut pouvoir accompagner les projets depuis leur genèse jusqu’à leur concrétisation, sans qu’ils se perdent dans les méandres administratifs ou entre les logiques civile et militaire.
Il faut aussi accepter davantage de risque. L’innovation, c’est accepter l’incertitude. Sans prise de risque, pas de rupture. Si les acteurs publics et privés parviennent à mieux coordonner leurs efforts, la France pourra porter une ambition technologique forte, souveraine et crédible dans un monde de plus en plus compétitif.
 Eva Szego
Eva Szego
- Docteure en sciences économiques
- Chercheuse à la Chaire Économie de Défense de l’IHEDN
En savoir + : www.ecodef-ihedn.fr
Notes :
- LOI n° 2023-703 du 1er août 2023 relative à la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense – Légifrance.
- Study results: Access to equity financing for European defence SMEs – European Commission.
- Quelle était la situation financière des entreprises de la BITD avant la guerre en Ukraine ? | Direction générale du Trésor.
- L’impact des normes ESG sur le financement de l’industrie de défense : entre contraintes éthiques et nécessité stratégique – Institut National des Affaires Stratégiques et Politiques.
- EIB to loosen rules to fund more defence-related projects | Reuters.
- La Banque européenne d’investissement renforce son financement de la défense, sauf dans les munitions et les armes.
- Financement de l’innovation de défense : état des lieux d’une dynamique à structurer durablement en France et en Europe – Institut National des Affaires Stratégiques et Politiques.
- Innovation de défense, des instruments à renforcer | Institut Montaigne.
- Here’s what the sellside is saying about DeepSeek.
- Pour OpenAI, une levée de fonds de 40 milliards de dollars, mais des défis.
- Comand AI lève 8,5 millions d’euros pour ses logiciels destinés aux opérations militaires.
- IA embarquée au service des forces armées : la start-up française Alta Ares lève 2 millions d’euros.
- La vente de Preligens illustre les difficultés de financer une start-up d’IA de défense en France.