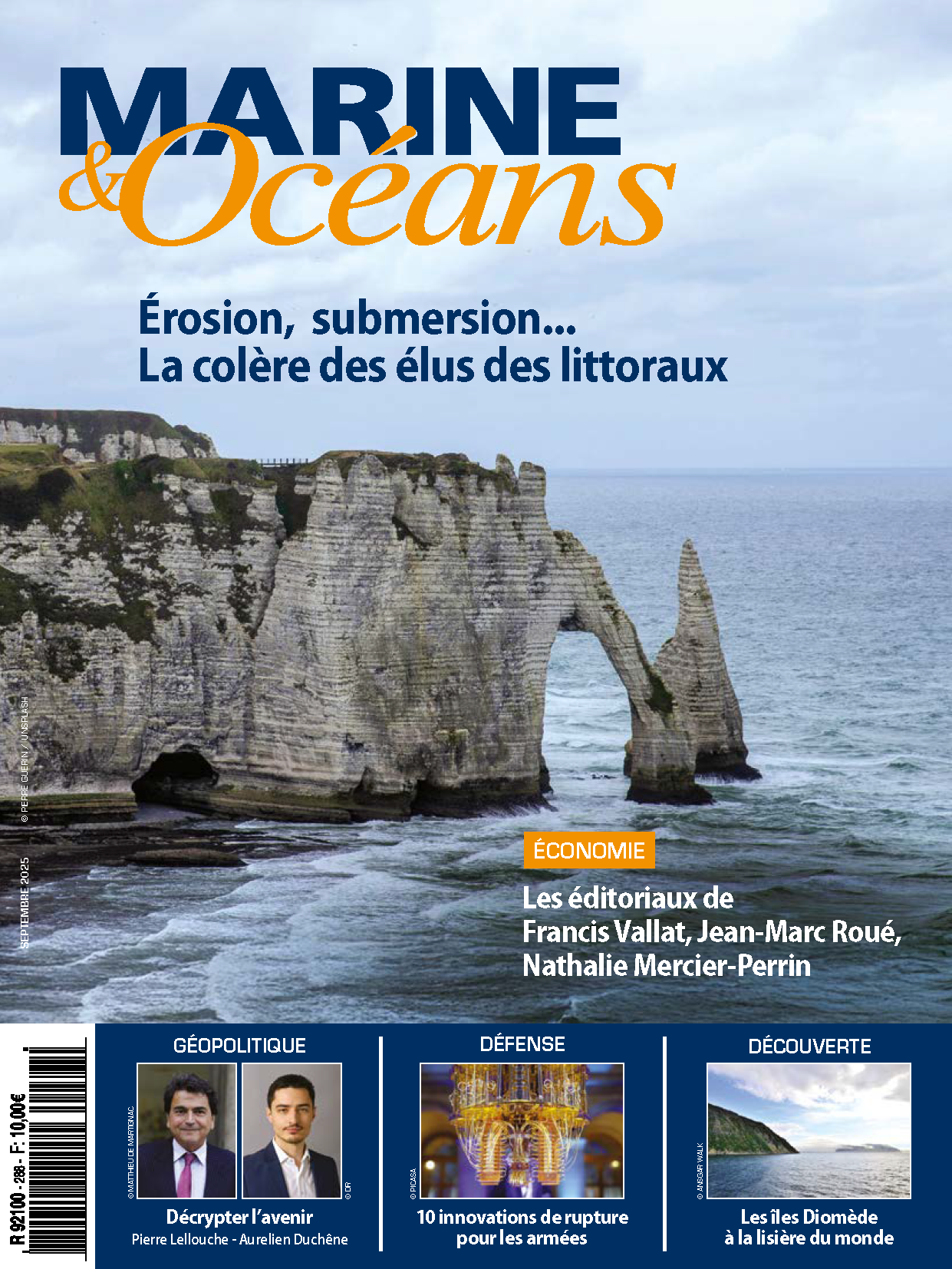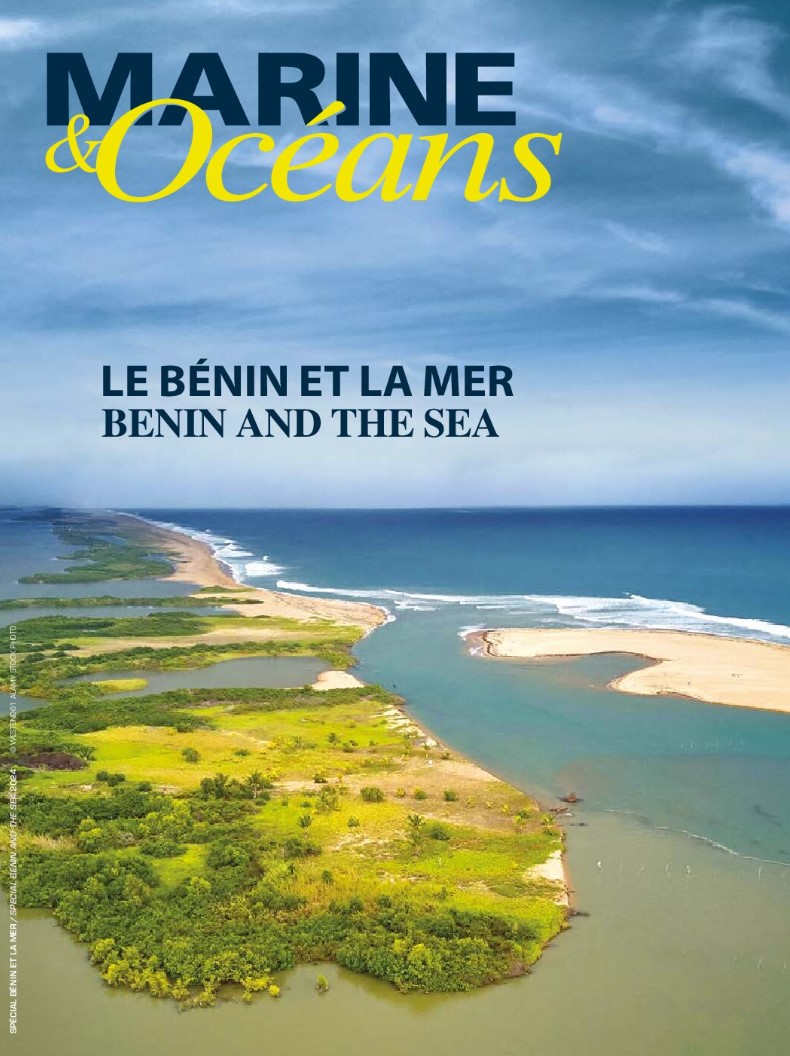La France aime rappeler qu’avec son deuxième espace maritime mondial, elle est présente sur toutes les mers du monde, et qu’elle dispose d’un secteur maritime particulièrement dynamique et diversifié lui donnant la capacite d’agir dans tous les domaines professionnels – industrie, transports, recherche, formation… –, tant au niveau national qu’international. Mais ce patrimoine exceptionnel est bride, sous-exploite, en partie parce que notre cadre fiscal, remis en cause ou toujours menace d’être modifie au gré des alternances politiques, décourage les investissements et pousse une partie de notre flotte et de nos projets stratégiques à se développer ailleurs. Dans un secteur ou les cycles d’investissement se comptent en décennies, la stabilité fiscale est une condition vitale.
Quels que soient les aléas politiques et les énormes incertitudes actuelles, les prochains mois seront decisifs1. Sauf blocage catastrophique de la situation du pays, il faudra bien qu’un gouvernement présente un projet de budget au Parlement, budget qui sera, quoi qu’il en soit, marque par une baisse de moyens par la seule nécessité de respecter nos engagements européens et de contenir la dette publique. Dans ce contexte contraint ou chaque secteur devra justifier sa place dans les priorités nationales, la mer ne peut plus rester à la marge. C’est maintenant qu’il faut inscrire clairement le maritime dans la trajectoire budgétaire de la Nation.
Car l’économie maritime n’est pas un secteur de niche. Elle représente au moins 119 milliards d’euros de valeur de production et des centaines de milliers d’emplois directs et indirects.
Elle irrigue la construction et la réparation navales, la pèche, l’aquaculture, le transport, la logistique portuaire, les énergies marines renouvelables… mais aussi la défense, la recherche, le commerce auxquels elle offre des outils et des supports indispensables.
Elle est au croisement de la souveraineté, de la transition écologique et de la réindustrialisation. Certes, des instruments fiscaux existent – par exemple, pour les transports, la taxe au tonnage, l’exonération de charges sociales pour les marins, le crédit d’impôt recherche, le registre international français et d’autres dispositions particulières –, mais ils sont insuffisants face à la concurrence agressive de nos voisins européens. Le Danemark, les Pays-Bas ou Malte, entre autres, offrent des régimes plus simples et plus compétitifs.
Certains d’entre eux sont même affectes de l’étiquette sourdement infamante de « niches fiscales » alors même que leur intérêt économique et stratégique, en plus des rentrées financières qu’ils rapportent directement et indirectement à la Nation, est a la fois significatif et indubitable. Résultat : ces instruments fiscaux n’étant pas sanctuarisés alors même qu’ils ont démontré leur efficacité, trop de navires s’apprêtent à quitter le pavillon français tandis que d’autres hésitent à le rejoindre, trop de projets sont freines, trop d’investissements se déploient ailleurs.
Dans le débat budgétaire, la question n’est pas de dépenser plus mais de dépenser mieux, même si c’est moins. Orienter intelligemment la fiscalité maritime, c’est créer un effet de levier puissant : attirer les capitaux, stimuler l’innovation, soutenir l’emploi, renforcer notre souveraineté. Chaque euro « accordé » sous forme d’allègement fiscal peut générer maintenant, comme cela fut le cas dans le passé, plusieurs euros de valeur ajoutée et de recettes indirectes pour l’État.
Sauf à accepter la chronique d’une catastrophe annoncée, les engagements, y compris internationaux, pris par le pays, les priorités affichées pour la Nation, et naturellement le calendrier politique nous obligent. D’ici 2027, la France devra avoir tenu ses engagements climatiques européens tout en améliorant ses équilibres financiers.
De leur côté, les professionnels du secteur maritime n’ont pas d’autre choix que d’engager la décarbonation de leurs flottes (pour les armateurs), de moderniser leurs infrastructures (pour les acteurs portuaires), de consolider le développement de nouvelles filières (pour l’éolien offshore par exemple). En clair, ne pas sanctuariser un cadre fiscal adapté, c’est prendre le risque d’un décrochage stratégique tous azimuts.
Cet automne, en espérant que ce ne soit pas plus tard, le gouvernement et le Parlement auront l’occasion de faire un choix clair : celui de traiter la mer comme une simple variable d’ajustement ou, au contraire, de la considérer enfin comme un puissant levier d’avenir, y compris pour les équilibres financiers du pays. Le débat budgétaire, parce que les priorités devront être définies, parce que des arbitrages clairs s’imposeront, sera un moment de vérité sur la réalité de la stratégie maritime nationale.
Car la fiscalité n’est pas seulement une question de taux et de dispositifs : elle dit où la Nation veut investir, où elle veut innover, où elle veut être leader.
On ne peut pas dire partout que la mer est l’avenir de la Terre, ou reconnaître qu’elle est l’un des vecteurs les plus cruciaux du développement de la France et de ses outre-mer (en plus de la nécessité d’aider à respecter ses écosystèmes), et dans le même temps ne pas sanctuariser les mesures permettant de saisir toutes les opportunités qu’elle offre.
C’est donc bien, entre autres, aux parlementaires de veiller à ce que lui soit donnée la place qu’elle mérite dans le budget national, pour que la puissance maritime française cesse d’être muselée et devienne enfin la réalité qu’elle peut être au service de l’économie de la France et de ses capacités stratégiques.
Il n’est pas question ici de nier la légitimité de tous les secteurs de l’économie française en général à se battre pour leur croissance et la reconnaissance de leurs mérites respectifs, ni bien entendu de contester la nécessité de réindustrialiser le pays sans faiblir ou de développer ses capacités dans quasiment tous les types de services. Mais il est de mon devoir et de mon rôle d’insister sur les atouts exceptionnels de notre communauté maritime française.
Au carrefour de tous les grands enjeux du présent et de l’avenir, le Cluster maritime français représente bien un secteur clé au moment où s’affirme, toujours plus et partout, la maritimisation du monde. Celle-là même qui donne, plus de trois siècles plus tard, tout son poids à la fameuse prédiction de Walter Raleigh² : « Qui tient la mer, tient le monde »…
Nathalie Mercier-Perrin
Présidente du Cluster maritime français
NOTES :
- Cet article a été rédigé début septembre 2025.
- Walter Raleigh (1552-1618), officier, explorateur, écrivain et poète anglais.