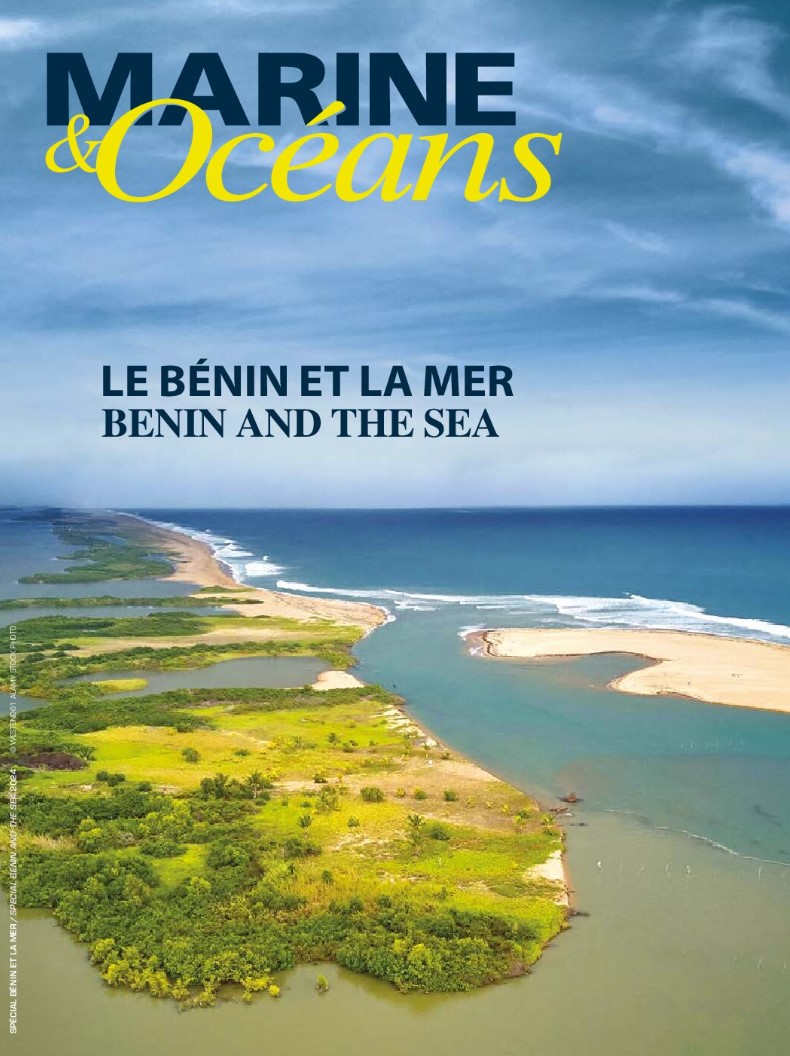« Dans les champs, il y a beaucoup de femmes. Mais c’est l’homme que l’on voit », regrette Maria Elena Guerra, caféicultrice sur les hauteurs de Santa Cruz, une des quatre îles habitées de cet archipel de l’océan Pacifique, à 1.000 km des côtes de l’Equateur.
Cette femme menue de 54 ans dirige Lava Java, l’une des 50 plantations des Galapagos qui, sur 15 hectares, produit environ 75 quintaux à l’année du seul café des Galapagos certifié à la fois biologique et d’origine contrôlée.
« Lorsque je cherche du personnel, il arrive encore qu’on se présente en demandant à parler à mon époux! », raconte-t-elle à l’AFP, rieuse et droite dans ses bottes en caoutchouc.
Mais « ça change » et « être femme est un enjeu dans n’importe quel milieu », souligne cette militante de l’égalité des droits pour laquelle, au quotidien, « le principal défi de l’agriculture ici aux Galapagos, c’est l’eau » tributaire des pluies, faute de sources ou de rivières.
« Les gens sont toujours très surpris qu’il y ait de l’agriculture parce qu’ils voient des documentaires (…) où tout est sec », ajoute Heinke Jäger de la Fondation Charles Darwin (FCD), précisant qu’il y a néanmoins quelque 755 exploitations, quasi la moitié sur Santa Cruz.
– Hommes plus visibles –
« Près de 75% des fermes sont au nom du mari, mais (…) la plupart du temps ce sont les femmes qui font le travail » sur un « sol très rocailleux », « qui rend la tâche très difficile », confirme cette écologue, en charge d’un programme de conservation d’espèces, impliquant 40 agriculteurs.
Le soleil à peine levé, Maria Elena parcourt ses caféiers. Entre des allées bordées des roches noires retirées de la terre, les fleurs blanches embaument l’air d’effluves rappelant le jasmin.
Alors qu’au loin scintillent les eaux turquoises du Pacifique, elle va vérifier le réservoir artificiel qui arrose la serre où, à l’ombre des scalesias, arbres endémiques de l’archipel, poussent 2.000 plants à repiquer.
« Etre bio (…) sans produit chimique » implique de les renouveler sans cesse afin d’enrayer les maladies, explique-t-elle, avant d’inspecter salades, blettes et autres légumes qu’elle vend aussi, soucieuse d’éviter la monoculture.
Les Galapagos, dont 85% de l’économie repose sur un tourisme ruiné par la pandémie, comptent environ 25.000 hectares de terres arables, dont seulement 14.000 exploités.
Il ne s’y produit chaque mois que 600 tonnes d’aliments quand il en faudrait plus du double pour assurer l’autosuffisance des quelque 30.000 habitants, précisent des chiffres officiels.
Les insulaires complètent avec des produits venant du continent, plus chers. « Le temps qu’une laitue arrive jusqu’ici, elle n’a plus rien d’une laitue », se désole Maria Elena, par ailleurs comptable pour boucler les fins de mois.
Plus bas dans l’île, près du quai où sont amarrées les chaloupes bleues et blanches des pêcheurs, d’autres femmes s’activent dès l’aube au marché aux poissons de Pelican Bay.
– Les cerveaux de la pêche –
Parmi les otaries, pélicans et iguanes qui se disputent les déchets sous son étal, Maria Sabando apprête thon blanc et espadon qui feront de délicieux ceviches ou grillades.
« J’adore mon travail, que les clients soient contents », dit à l’AFP cette femme de 52 ans aux yeux pétillants.
Mais la vente n’est qu’une facette de la pêche artisanale, seule autorisée dans la réserve marine des Galapagos, autour de laquelle rôdent les chalutiers industriels.
Son mari Faustino, 61 ans, sort en mer une fois par semaine pour trois jours. Il ne saurait se passer de Maria pour « faire son sac (…) acheter le carburant, préparer les appâts ». « Et j’administre car je sais où doit aller l’argent! », souligne-t-elle.
« Quand on pense pêche, on pense à l’acte de pêcher (…) pas à ce qui le rend possible (…) la nourriture, l’eau, la glace parce que ces bateaux ne sont pas réfrigérés », ajoute Nicolas Moity, en charge d’un programme de la FCD sur l’égalité des genres dans ce secteur.
Pour quelque 500 pêcheurs, 95 femmes sont affiliées aux coopératives, dont 50% en sont les gérantes. « Mais nous estimons que cela représente environ 10% » de la réalité, souligne-t-il, estimant qu’il faut « rendre visible » le travail des femmes.
Par le passé, elles affrontaient même l’océan. Certaines reprendront peut-être la mer, comme d’autres dirigent des fermes. Car, selon le biologiste, « les femmes sont les cerveaux qu’il y a derrière toute la chaine de valeur associée à la pêche ».
« Mon rôle est primordial, renchérit Maria, parce que mon mari est le chef de famille, mais j’en suis un pilier fondamental! »