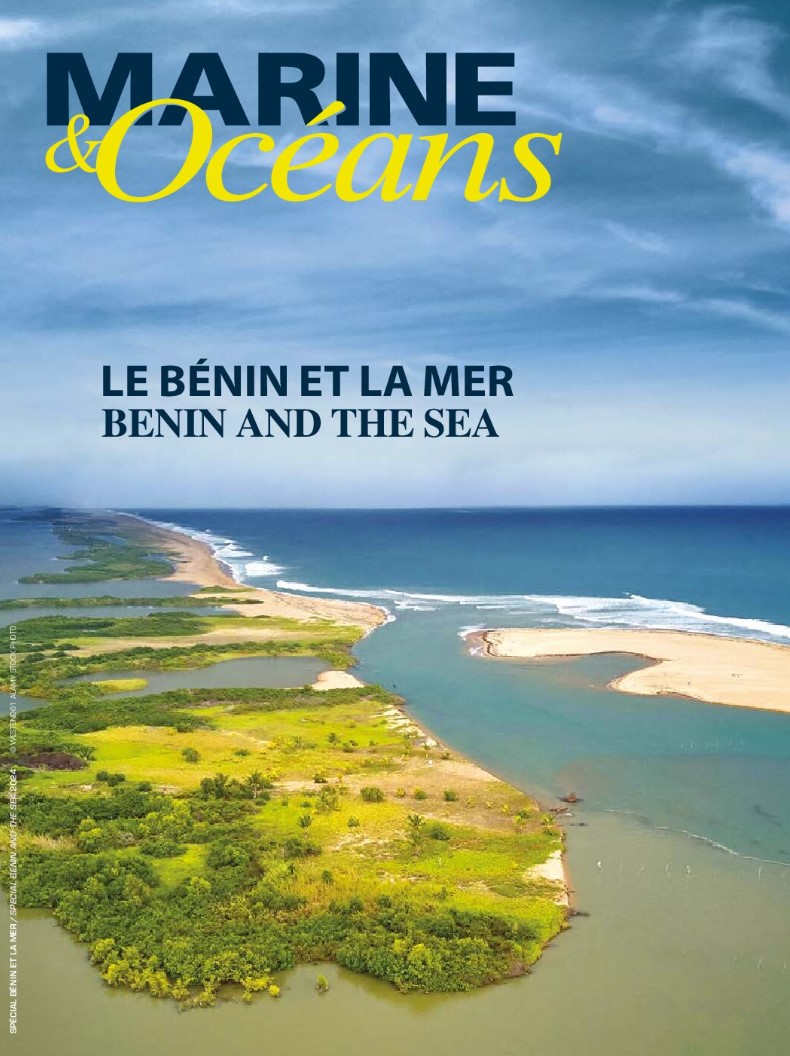Les sujets qui fâchent sont nombreux et épineux, en voici une sélection.
– La pêche, nouvelle vague
En 2022, un premier accord avait été arraché après plus de vingt ans de discussions pour interdire les subventions à la pêche INN (illicite, non déclarée et non réglementée), à la pêche des stocks surexploités et à la pêche en haute mer non réglementée, tout en incluant des flexibilités pour les pays en développement.
L’accord n’est pas encore entré en vigueur car un nombre insuffisant de pays l’ont ratifié. Mais c’est un résultat historique pour l’OMC car il s’agit du premier accord axé sur l’environnement et du deuxième accord seulement ayant été conclu par l’ensemble de ses pays membres depuis sa création en 1995.
A Abou Dhabi, les pays espèrent conclure une « deuxième vague » de négociations interdisant les subventions contribuant à la surpêche et la surcapacité.
Mais les discussions s’annoncent difficiles car le projet de texte inclut une « approche à deux niveaux » qui prévoit que les plus grands pourvoyeurs de subventions soient davantage surveillés. Autre sujet majeur de discorde: l’Inde réclame une période de transition de 25 ans.
– Piqûre de rappel Covid ?
En dépit des grincements de dents de l’industrie pharmaceutique et des pays qui l’héberge, l’OMC a adopté en 2022 une dérogation temporaire aux règles de propriété intellectuelle pour la production des vaccins contre le Covid-19.
Les pays devaient décider en décembre 2022 au plus tard de l’extension ou non de la dérogation à la production d’outils de diagnostic et de traitements contre le virus.
La date butoir a été depuis repoussée mais les désaccords persistent. L’Inde et l’Afrique du Sud seraient sur le point d’acter que les discussions n’ont pas abouti, mais laissent encore planer le doute.
-L’agriculture dans tous ses états
Sujet hautement sensible comme l’ont montré les récentes manifestations d’agriculteurs dans toute l’Europe, l’agriculture est depuis toujours au coeur des discussions à l’OMC. En 2015, les pays ont pris l’engagement de supprimer les subventions à l’exportation de produits agricoles.
Sept grands sujets figurent sur un projet de programme de travail – soutien interne, accès aux marchés, mécanisme de sauvegarde spéciale, restrictions à l’exportation, concurrence à l’exportation, coton et détention de stocks publics à des fins de sécurité alimentaire – mais il est loin d’être garanti qu’il soit approuvé.
L’Inde devrait toutefois réclamer à grands cris une solution permanente à la question des stocks publics de denrées alimentaires, pour assurer la sécurité alimentaire.
Ils sont en règle général considérés comme faussant les échanges lorsqu’ils impliquent des achats auprès d’agriculteurs à des prix supérieurs à ceux du marché. Mais grâce à un accord trouvé en 2013 à la demande de New Delhi, certains pays en développement bénéficient d’un traitement de faveur provisoire pour divers produits de base dont le riz et les céréales.
L’Inde, au nom de dizaines d’autres pays en développement, souhaite une solution permanente élargissant l’accord à l’ensemble des pays en développement et à d’autres produits.
– La réforme, le joyau de la couronne
Après avoir accompagné la mondialisation en fluidifiant les échanges, l’OMC, héritière de règles établies après la guerre froide, peine à sortir de son obsolescence, même si son actuelle patronne, la Nigériane Ngozi Okonjo-Iweala, lui a insufflé une nouvelle énergie.
En 2022, les pays ont acté la nécessité de réforme, avec pour mission d’établir un plan de route. Mais les discussions ont surtout avancé sur des questions techniques, plutôt que sur l’organisation elle-même et ses règles, comme par exemple le fait que ce sont les pays qui s’autodéclarent en développement.
La préoccupation majeure reste la remise en état de marche du système de règlement des litiges commerciaux, dont les Etats-Unis, depuis l’ère Obama, bloquent la nomination des juges, aboutissant fin 2019 – sous l’administration Trump – à la paralysie du système.
L’objectif était qu’il soit à nouveau pleinement opérationnel pour 2024. Mais les discussions restent bloquées, les Etats-Unis insistant notamment sur l’importance que les décisions des juges n’aillent pas à l’encontre de la « sécurité » nationale.