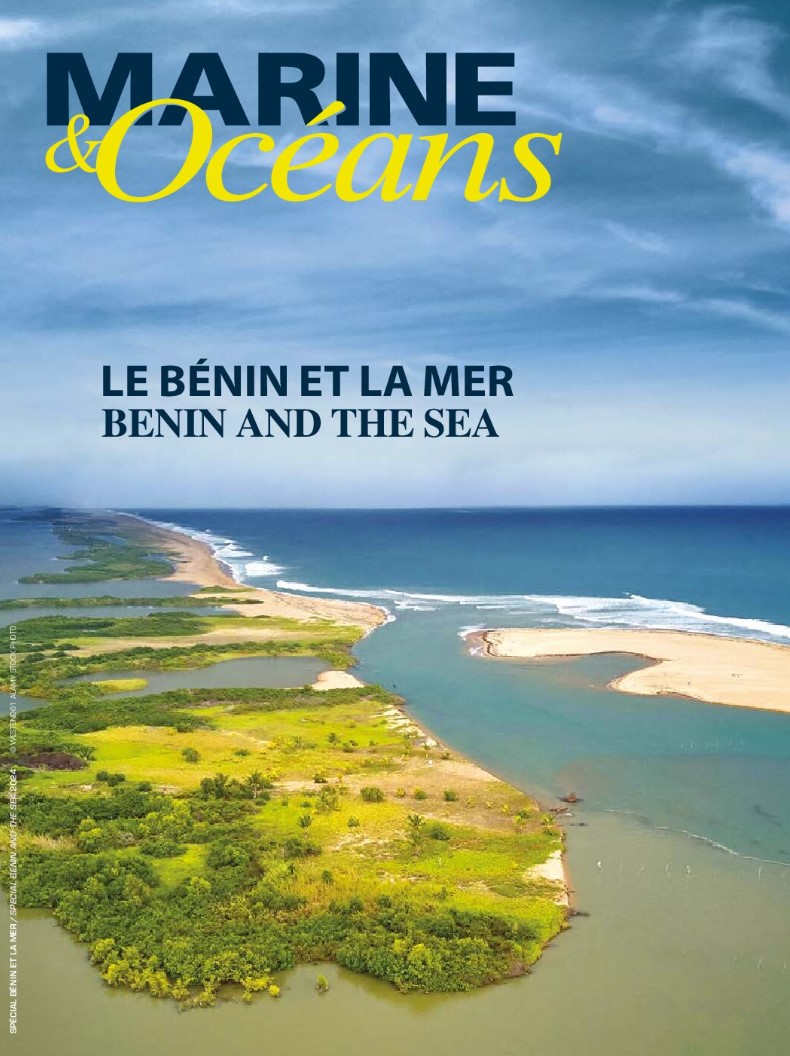Lovée sur les berges du fleuve Maroni, Saint-Laurent affronte une pauvreté et une délinquance chroniques. En 1986, cette bourgade de 5.000 habitants au passé bagnard a vu son destin changer avec la guerre civile chez le voisin surinamais, générant des milliers de réfugiés.
Aujourd’hui, la ville compte officiellement 50.000 habitants « mais tout le monde sait que l’on est plus près de 80.000 », souligne Sophie Charles, maire sans étiquette depuis 2018.
Forte natalité, immigration importante: la ville a enregistré 3.300 naissances l’année dernière et d’après l’Agence française de développement, deviendra en 2030 la commune la plus peuplée de Guyane.
Une force, au vu du potentiel de développement. Et une faiblesse, tant la population croit plus vite que les emplois et les infrastructures.
Seuls 40% des logements sont considérés comme « formels » par la mairie. Dans les rues, chacun vend ce qu’il peut pour suvenir à ses besoins, tandis que les offres d’emplois ou de formation sont limitées. La moitié des habitants est sans travail.
En avril, des tensions ont éclaté suite au meurtre crapuleux d’une pharmacienne très investie dans la commune. Les habitants ont exprimé leur colère par des manifestations, jour et nuit, devant la sous-préfecture, puis des barrages verrouillant la ville pendant deux jours.
L’opération « Place nette » déclenchée dans la foulée n’a pas suffi à rassurer. Des mesures structurelles sont attendues.
« Création d’un commissariat, contrôle fluvial 24h/24 création d’un centre éducatif fermé pour mineurs… », énumère Gilbert Dolloue, porte-parole de l’association Positif Solaan Pikin (PSP) créée en 2022 suite au meurtre d’un lycéen, tué d’une balle dans la tête à la sortie des cours.
– 14 gangs –
Les gendarmes, pourtant, tentent d’ancrer leur présence. Au carrefour Margot, qui indique aux visiteurs leur arrivée dans la capitale de l’ouest guyanais après avoir avalé les 250 km d’asphalte la séparant de Cayenne, un barrage fixe inspecte 24h/24 des milliers de véhicules.
Les opérations de contrôle, notamment dans les bidonvilles, sont régulières. Dans l’un d’eux, nommé Village Chinois, les hommes sont fouillés et interrogés au milieu d’habitations de fortune construites en bois et en tôles.
Dalida Doye, 34 ans, regarde la scène depuis une chaise en plastique avec une certaine satisfaction pendant qu’une enceinte crache du dance-hall à plein tube.
« Ça nous rassure de voir les gendarmes car nous aussi, on est victime de violence. Les femmes sont souvent agressées, violées et comme elles n’ont pas de papiers, elles ne vont pas porter plainte par peur d’être expulsées », explique-t-elle.
Les forces de l’ordre luttent contre la multiplication des gangs. Quatorze dans la ville « organisés par quartier », selon le major Pascal Thomas, chef de la police municipale depuis dix ans.
« Les violences avec arme, il y en a beaucoup plus qu’en métropole, mais pas tous les jours non plus », veut rassurer le lieutenant-colonel Stéphane Babel, à la tête de la compagnie départementale de gendarmerie.
Cette compagnie de 133 hommes, épaulée par un escadron de gendarmes mobiles et la police aux frontières (PAF), doit assurer la sécurité d’un territoire « grand comme la Belgique ».
La circulation des armes depuis le Suriname est régulièrement pointée du doigt par les autorités. Elles peinent à contrôler cette frontière qui n’en est pas une. Sur le fleuve, les pirogues vont et viennent inlassablement.
« Il faudrait un gendarme tous les 50 mètres, c’est impossible », reconnaît le lieutenant-colonel Babel. Il dispose néanmoins de nouveaux moyens. Une brigade fluviale a été créée le 1er mars et depuis janvier, des patrouilles conjointes avec la police surinamaise sont menées.
Ces efforts ont fait baisser le pic de violence d’octobre à décembre 2023, marquée par de nombreux vols à main armée commis souvent « par opportunisme ». A l’image de cette ville où l’âge médian est de 17 ans, les braqueurs sont souvent très jeunes, parfois mineurs.
– « Plus dangereux » –
Reste que pour Gilbert Dolloue, « la violence ne vient pas de nulle part, il faut travailler sur les causes. Beaucoup de gens vivent dans des conditions qui ne sont pas celles de la France et de l’Europe ».
Cela a permis à la délinquance de s’installer. « Et elle est en train de muter vers quelque chose de plus dangereux ».
Crépin Kezza, chef des urgences de l’hôpital et président du Cosma, le club sportif phare de la ville, pense lui aussi qu’il faut « occuper cette jeunesse et trouver un emploi aux 20.000 jeunes de Saint-Laurent ».
La municipalité en est consciente, mais l’argent manque. « On aurait besoin de 10 à 25 millions d’euros de plus dans notre budget pour assumer toutes nos prérogatives. Nos moyens ne sont pas adaptés, car la population réelle n’est pas retranscrite dans la dotation globale de fonctionnement », déplore l’édile Sophie Charles.
En Guyane, où 53% de la population vit sous le seuil de pauvreté, la précarité s’est exacerbée à Saint-Laurent depuis « la crise Covid et la crise économique au Suriname », selon la maire. En témoigne l’explosion du centre communal d’action sociale, passé de 3.000 bénéficiaires en 2022 à plus de 10.000 en 2023.
La maire ne craint plus d’être assise sur une bombe sociale à retardement: « On est conscient que l’on est dessus ».
Malgré elle, la ville est engagée dans une perpétuelle course au rattrapage en infrastructures. Elle doit construire une école tous les huit mois pour répondre à l’obligation de scolarisation. Huit cent logements sortent de terre chaque année mais les besoins sont évalués à 1.500, dans une ville où le parc locatif est composé à 80% de logements sociaux.
– Jeunes désoeuvrés –
Quant à la jeunesse, elle s' »ennuie tout le temps », lâche Terrence Abienso, un lycéen de 16 ans qui « déstresse » en pêchant, loin des grands ensembles de son quartier du Lac Bleu. « Il n’y a pas grand-chose pour nous. Même les maisons de quartier sont squattées par les voyous ».
Un lieu de rassemblement semble émerger, le soir, en centre-ville: le stade Oriane Jean-François, du nom d’une Saint-laurentaise, milieu du PSG et de l’équipe de France.
« C’est le seul endroit calme et protégé par un agent de sécurité », raconte Yves Forster, 24 ans, travailleur social dans l’insertion.
« Il y a un manque d’infrastructures, d’accompagnement et de perspectives pour les jeunes. Beaucoup arrêtent l’école avant le lycée, manquent de modèles, de cadre. Et quand on n’a rien à faire, on glisse vers l’argent facile ».
« C’est difficile de se projeter », abonde son ami Henri Mambë, 24 ans également. « On se sent pris en étau entre la frontière et le PCR (point de contrôle routier des gendarmes) ». Lui a choisi l’armée, pour « s’émanciper et passer mon permis gratuitement ».
Il y a urgence, selon Wender Karam, professeur et homme politique local. Associations, politiques et adultes ont laissé une place vacante. « La nature a horreur du vide. Aujourd’hui, des tournois de foot sont organisés par les gangs pour recruter. On doit se retrousser les manches, parler avec les jeunes, s’occuper d’eux ».