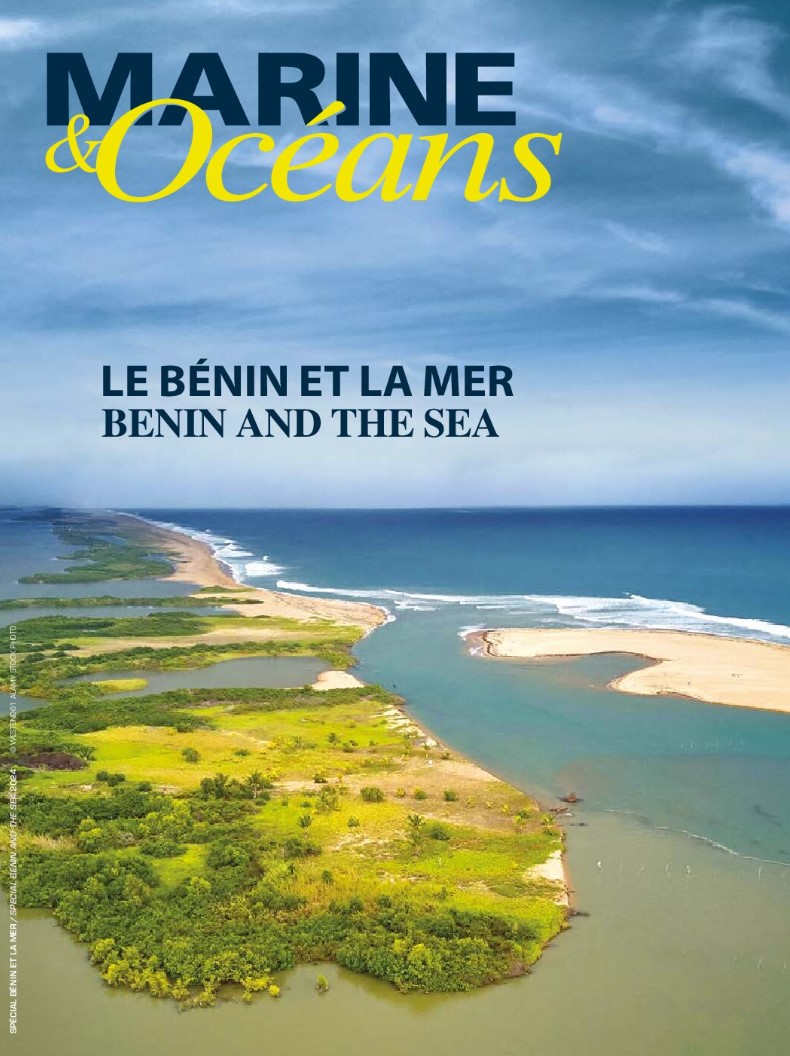29 mars 1631 : acte de naissance de la Marine militaire française.
Richelieu fait publier le « Règlement sur le fait de la Marine » qui vise à donner les premiers fondements d’une organisation administrative de la Marine française.
Dès que la capitulation de la Rochelle, en 1628, eut délivré le cardinal de Richelieu de son principal souci, il résolut de créer sans retard la flotte militaire dont an siège mémorable venait de lui démontrer l’impérieuse nécessité. Mais, pour atteindre ce but, il lui fallait concentrer dans sa main puissante tous les pouvoirs, tous les droits, toutes les attributions des personnages qui présidaient à l’administration des affaires maritimes. À cet égard, Richelieu avait déjà pourvu au plus pressé : en 1626 et 1627, il avait acquis du duc Henri de Montmorency la charge d’amiral de France, supprimé du même coup celle de vice-amiral, et ajouté aux droits dont il héritait ainsi ceux qui appartenaient encore à la couronne sur le littoral maritime du royaume ; enfin, il s’était fait nommer Grand-maître, chef et surintendant général de la navigation et du commerce.
Possédant, dès lors, pour la direction des affaires navales de la France, toute l’autorité qu’il pouvait ambitionner, le cardinal se mit à l’œuvre. Il voulut d’abord connaître l’exacte vérité en ce qui concernait la vaste administration dont la charge venait de s’ajouter à ses autres attributions. Une inspection détaillée, qu’il fit passer sur le littoral de l’Océan et, l’lus tard, sur celui de la Méditerranée par deux fonctionnaires ayant son entière confiance, lui révéla d’étranges choses : partout des ruines, des conflits, des abus de pouvoir, des dénis de justice, et absence totale de protection pour les faibles ; finalement, nos populations maritimes fuyant les ports et les côtes du royaume pour échapper à tant de maux : telle était, au vrai, la situation. Par des ordonnances et des règlements précis, par la réorganisation de la justice et la répression des abus les plus criants, enfin par la création de compagnies jouissant du privilège de commercer avec les échelles du Levant, les Indes, le Sénégal, Madagascar, etc., Richelieu pourvut aux premières nécessités en ce qui regardait la sécurité, les besoins et, par suite l’accroissement si désirable de nos populations maritimes. Il put ensuite consacrer ses soins à cette flotte militaire qui lui tenait tant à cœur. Une commission composée du surintendant des finances, de deux conseillers et d’un secrétaire d’État, se trouvait déjà chargée d’étudier et de résoudre, sous la présidence du grand-maître, les principales questions relatives à la marine. Mais ce fut à des gens du métier, à des marins, que Richelieu confia la tâche d’établir un règlement détaillé pour administration et la discipline de la flotte. Un de ses parents, le commandeur de la Porte, intendant général de la navigation, et le chef d’escadre de Mantin furent les principaux rédacteurs de la très remarquable ordonnance de 1634. Ce nouveau code maritime emprunta une bonne partie de ses dispositions à la législation hollandaise ; complété par d’autres édits que Richelieu fit rendre à diverses époques sur l’organisation des arsenaux, il servit de base aux célèbres ordonnances de Colbert et de Seignelay. Ce fait augmente singulièrement l’intérêt des principales mesures qu’il édictait, concernant l’établissement de notre nouvelle marine.
Sur les côtes-de la Manche et-de l’Océan, le Havre, Brest et Brouage étaient alors les trois ports que l’on regardait comme les plus propres à recevoir des escadres de guerre. Le premier était en assez bon état d’entretien ; on se contenta d’accroître ses fortifications. A Brest, tout ou presque tout était à créer : magasins, ateliers, chantiers de construction. Richelieu y fit travailler sans retard, et l’on achemina peu à peu vers cet arsenal de grands approvisionnements. Brouage offrait encore un abri commode pour des navires de dimensions modérées ; mais son port se comblait, et déjà c’était sur une rivière voisine, la Seudre, que l’on armait les vaisseaux de fort tonnage.
Sur la Méditerranée, Marseille, seul arsenal des galères du roi, possédait depuis longtemps la plupart des établissements nécessaires à leur entretien. Toulon n’était encore qu’un point de relâche pour nos bâtiments. Sous la puissante impulsion du cardinal, un arsenal très complet pour l’époque y fut créé en quelques années, et spécialement destiné à l’entretien des vaisseaux ronds.
Richelieu, en effet, voulait doter la France, à bref délai, d’une flotte de 50 vaisseaux à voiles et de 30 galères. Ce n’était point une tâche aisée. Nous possédions seulement quelques vieux navires de 150 à 500 tonneaux, et nos constructeurs étaient presque tous d’une désolante médiocrité. Dans un considérant de l’ordonnance de 1634 on constatait que, « faute d’avoir été bien liés, plusieurs navires de Sa Majesté s’étaient ouverts par leur propre poids, dans le port ou à la mer ». Hâtons-nous d’ajouter que, vers cette époque, le Français Charles Morieu construisit, cependant, un vaisseau de 1 200 tonneaux et de 72 canons, la Couronne, dont la force, les excellentes qualités et la belle apparence firent l’admiration de tous les marins. Richelieu, du reste, qui cherchait dans une étroite alliance avec les Provinces-Unies un contrepoids à la prépondérance maritime de la Grande-Bretagne, Richelieu fit venir de Hollande d’habiles maîtres et ouvriers charpentiers, institua un conseil de surveillance composé d’officiers et de constructeurs entendus, enfin, par de sages prescriptions, réglementa la coupe des bois propres à la charpente des navires.
Pour assurer la prompte construction des vaisseaux ainsi que leur armement dans des conditions acceptables, une sérieuse organisation de nos arsenaux maritimes était le premier but qu’il s’agissait d’atteindre. A côté et au-dessus d’un commissaire général de la marine envoyé dans chaque port de guerre dès l’année 1631, l’ordonnance de 1634 plaça un officier militaire, un chef d’escadre, qui eut dans ses attributions non seulement le commandement des troupes, des vaisseaux et la garde de l’arsenal, mais encore la haute main sur l’administration. Il fut décidé, en effet, que « tous les marchés se feraient en présence du chef d’escadre responsable de tous les manquements des officiers en leurs charges,…et que cet officier ferait enregistrer tout ce qui serait dépense ou consommation du magasin ». Une prépondérance aussi complète de l’élément militaire sur l’élément administratif, dans les arsenaux maritimes du roi Louis XIII, est utile à constater, car elle montre qu’à cet égard, les idées de Richelieu ne concordaient nullement avec celles qu’un ministre moins illustre, le grand Colbert, mit plus tard systématiquement en pratique.
L’organisation de nos arsenaux maritimes telle que l’établissait l’ordonnance de 1634, était simple et logique. Il y avait, un magasin général, où les divers objets étaient soigneusement rangés suivant leur nature et leur emploi ; en outre, — détail fort remarquable, — chaque vaisseau possédait un magasin particulier, où, quand il était dans le port, l’on conservait tout ce qui était nécessaire à son armement. Trois grands registres suffisaient pour tenir la comptabilité de tout le matériel de l’arsenal : l’un pour les marchés et les dépenses considérés dans leur ensemble, un autre, pour les entrées et les sorties du magasin général, le troisième, enfin, pour les consommations de chaque navire. Plusieurs commissaires de la marine secondaient le commissaire général, afin d’assurer le service purement administratif dans tous ses détails. Un prévôt était spécialement chargé de la police de l’arsenal.
Un capitaine et plusieurs lieutenants de port, ayant sous leurs ordres des gardiens, veillaient aux mouvements, à la sécurité et à l’entretien des bâtiments désarmés. Des maîtres de diverses professions, — un maître d’équipage, un gréeur, un voilier et un canonnier, — présidaient, chacun en ce qui concernait sa partie, aux détails de l’armement et du désarmement des navires. Au départ comme à l’arrivée d’un vaisseau, son rôle d’équipage était contrôlé, et l’état de son matériel constaté par l’un des commissaires et par le maître d’équipage du port. En revenant de campagne, tout capitaine de navire était tenu de remettre entre les mains du chef d’escadre un journal relatant ce qui s’était passé d’important dans le cours de sa navigation.
Tel était l’ensemble des dispositions destinées à substituer l’action directe, uniforme et contrôlée de l’État à celle des maîtres charpentiers et des capitaines, qui jusqu’alors avaient été chargés, presque sans aucune surveillance, de la construction, de l’armement et de l’approvisionnement des vaisseaux ronds. Malheureusement, une aussi vaste organisation ne peut, — ni ne pouvait à cette époque surtout,— s’établir sur des bases solides en quelques mois. Les négligences, les gaspillages, les escroqueries des gardes-magasins et autres agents à qui était confié le matériel devinrent tels, qu’à certains moments on fut obligé de revenir au système, suranné et vicieux à tous égards, de l’achat par le capitaine des objets nécessaires à l’armement. « En quoi », écrivait crûment le savant père Fournier, aumônier sur les flottes de Louis XIII, « en quoi on ne remédie pas au mal, mais on se délivre seulement des plaintes importunes qu’un capitaine fait contre un garde-magasin, et le capitaine vole, ce que ferait le garde-magasin. »
Après avoir montré ce qu’étaient nos arsenaux maritimes sous le ministère de Richelieu, nous allons essayer de décrire l’état du personnel et l’organisation de nos vaisseaux de guerre à la même époque.
En arrivant au pouvoir, Richelieu avait trouvé un certain nombre d’officiers pourvus d’un brevet de capitaine entretenu du roi en sa marine. Pendant le siège de la Rochelle, d’autres marins, provenant des anciennes amirautés de province, de notre flotte marchande ou de l’ordre des chevaliers de Malte, s’étaient fait remarquer par leur vaillance, leur habileté pratique et leurs aptitudes militaires. Richelieu en fit des chefs d’escadre, des capitaines, des lieutenants et des enseignes dans la nouvelle marine de guerre créée par lui. Mais, pour assurer à l’avenir le recrutement de ces mêmes officiers, il décida qu’il y aurait continuellement seize jeunes gentilshommes entretenus aux frais du roi et instruits de tout ce qui concernait la marine militaire. Au-dessus du grade de chef d’escadre, celui de lieutenant-général fut tout d’abord une l’onction temporaire, attribuée le plus souvent à des personnages qui n’étaient marins que de nom. Quant au titre d’amiral et à ses dérivés, ils s’appliquaient à des fonctions indépendantes du grade : l’amiral était, l’officier qui exerçait le commandement en chef d’une réunion quelconque de navires de guerre ; dans le combat, il prenait la direction spéciale du corps de bataille de sa flotte ; le vice-amiral venait après lui et commandait généralement l’avant-garde ; le contre-amiral conduisait l’arrière-garde.
Au commencement de l’ère moderne, nous l’avons déjà dit, le capitaine d’un navire de guerre n’avait généralement aucune expérience de la profession maritime ; il était simplement le représentant du roi et le chef des soldats embarqués. Mais dès les premières années du XVIIIe siècle, les progrès de la science navale exigèrent qu’il en fut autrement : aussi la plupart des chefs d’escadre et des capitaines que nous verrons figurer dans les guerres maritimes du règne de Louis XIII furent-ils de véritables et, même, de très habiles marins.
Le lieutenant et l’enseigne composaient, avec le capitaine, le haut état-major du navire de guerre ; ils veillaient sous ses ordres, de concert avec lui et à tour de rôle, à la direction générale de l’équipage et à la sûreté du navire ; ni l’un ni l’autre n’entraient dans les détails du service, comme le font aujourd’hui les officiers d’un bâtiment de l’État ; ce soin incombait aux maîtres qui formaient le bas état-major. En tête de celui-ci figurait le maître d’équipage, qui avait autorité sur tous les hommes concourant spécialement à la manœuvre des voiles et à l’entretien de la coque, sur les mariniers, les voiliers, les charpentiers, les calfats, etc. ; c’était lui qui, muni du sifflet et secondé ou suppléé par un contremaître et plusieurs quartiers-maîtres, commandait la manœuvre en toute circonstance ; le capitaine se contentait de donner ses ordres d’une manière générale, soit au maître lui-même, soit au quartier-maître de quart, sans intervenir presque jamais dans leur exécution. Après le maître d’équipage, le chef des pilotes, — le pilote hauturier, — était le plus important des officiers du bas état-major. Chargé de déterminer la position du navire, d’indiquer la route à suivre et de veiller qu’on ne s’en écartât point, il avait une très grande responsabilité. Il était généralement secondé par deux autres pilotes qui, à la mer, partageaient avec lui le service des quarts. C’étaient sur ces hommes que reposait le plus souvent la sécurité du navire. Tons, malheureusement, n’étaient pas à la hauteur de leur tâche : tel pilote, tout gonflé de la science qu’on lui supposait, mais qu’il ne possédait point, n’était en réalité, nous apprend le P. Fournier, « qu’une franche bête, un ignorant et un méchant homme ».
Complètement indépendant dans sa sphère, le maître canonnier avait naturellement la charge de tout ce qui concernait l’artillerie, hommes et choses. Il ne recevait d’ordres que du capitaine ou, en l’absence de celui-ci, du lieutenant. Là manœuvre des câbles fixés aux ancres du navire était aussi dans ses attributions.
Le sergent était le chef direct des soldats embarqués, et un prévôt, chargé de la police, remplissait les fonctions de l’officier marinier appelé de nos jours capitaine d’armes.
Du bas état-major faisait encore partie un personnage très important, l’écrivain du roi, autrement dit l’officier d’administration. Chargé de toute la comptabilité du bord, il avait sous ses ordres le maître-valet, — aujourd’hui le maître-commis, — à qui incombait le soin de l’embarquement, de la conservation et de la distribution des vivres.
Enfin, sur chaque navire de quelque importance, on embarquait un chirurgien et, sur chaque navire amiral ; peut-être même sur tout grand vaisseau de guerre, un aumônier.
De l’état-major passons à l’équipage.
Dès les premières années du ministère de Richelieu, on s’était occupé de dresser des listes de tous les gens de mer du royaume. Telle fut l’origine de l’enrôlement, première base de tout le système de recrutement si laborieusement édifié plus tard par Colbert. Malheureusement, sous le ministère de Richelieu, ce fut à peine si l’on trouva dix mille marins à inscrire sur les rôles. Or, l’engagement volontaire avait été jusqu’alors le seul mode de recrutement usité pour armer les quelques navires à voiles que possédait la couronne ; mais, quand il fallut former les équipages d’une flotte de quarante navires, le nombre des matelots qui se présentèrent devint tout à fait insuffisant, et l’on dut recourir à la presse, c’est-à-dire aux embarquements forcés dans toute leur rigueur. Frappé de l’avantage qu’il y aurait eu, au point de vue de la cohésion, de la discipline et de l’instruction militaire, à conserver le plus longtemps possible les mêmes hommes sur nos bâtiments de guerre, Richelieu alla plus loin : il voulut contraindre les matelots entrés une première fois au service de l’État à y rester tant qu’on aurait besoin d’eux. A côté de cette mesure presque inapplicable tant elle était inique, Richelieu en adopta une autre qui était extrêmement sage et qui montrait avec quelle sagacité ce grand ministre avait apprécié de prime abord, et l’excellence du principe de la fixité des équipages, et l’importance du rôle de l’artillerie dans les combats de mer : il prescrivit d’entretenir continuellement dans nos ports cent matelots-canonniers et cent apprentis-canonniers, pour les besoins éventuels des bâtiments du roi.
La discipline que l’ordonnance de 1634 établissait sur ces bâtiments était sévère et dure. A côté de punitions qui sont encore appliquées de nos jours, telles que la mise aux fers, figuraient dans ce code des peines humiliantes ou cruelles, comme les coups de corde et la cale, et jusqu’à des supplices où l’étrangeté se mêlait à la barbarie. Que penser, par exemple, de celui-ci emprunté aux vieilles coutumes de notre marine marchande : quand un marin tuait un de ses camarades, « on attachait le coupable dos à dos avec le cadavre de sa victime, puis l’on jetait à la mer, en cet état, le mort et le vivant » ?
Inutile de dire que, pendant les manœuvres de voiles, le maître d’équipage et ses quartiers-maîtres étaient pleinement autorisés à user des coups de garcettes pour activer le travail de leurs hommes. Et les pauvres mousses, — les pages, — comme on les appelait alors ! C’est encore le P. Fournier qui va nous apprendre de quelle manière on les traitait : « Il ne faut pas imiter ce gros rustaud », écrit le bon aumônier, « qui naguère, se plaignant de ces pauvres enfants, disait que la discipline se perdait, que de son temps tous les mousses allaient réglementairement chaque semaine au cabestan, pour y être châtiés », — à coups de corde, — « où à présent on n’envoyait que ceux qui avaient mal fait. » Singulière justice distributive, en effet ! « Un tel zèle est indiscret », ajoute naïvement le P. Fournier, « jamais il n’est permis de châtier les innocents avec les coupables. »
Très grande, du reste, serait l’erreur commise si l’on se figurait que, sous le régime de l’ordonnance de 1634, la discipline et l’organisation ne se traduisaient à bord de nos vaisseaux que par des peines barbares, des coups de corde et des brutalités de tout genre. Dès cette époque, l’équipage, pour prendre ses repas, était partagé en un certain nombre de plats de sept à huit personnes ; le capitaine lui-même, qui recevait à sa table les officiers du haut état-major, n’avait à l’origine d’autre cuisinier que celui de l’équipage, le maître-coq ; mais, de très simple d’abord, puis de largement confortable, le service de la table des officiers généraux et des capitaines ne tarda pas à devenir tellement luxueux qu’il en fut véritablement encombrant et nuisible.
La division de l’équipage par plats et par bordées de quart n’était pas la seule mesure d’ordre prévue par les règlements : si l’on ne connaissait point alors l’ingénieux système du numérotage, qui permet aujourd’hui, sur nos bâtiments, de retrouver partout et à chaque instant tel ou tel homme de l’équipage, il existait néanmoins des rôles de combat, de manœuvre, de couchage., etc ; des étiquettes en parchemin portant les noms des pointeurs et des servants des canons, d’autres portant les noms des gabiers chargés des plus importantes manœuvres, indiquaient le poste que chacun devait occuper. Enfin, les appels, le service des quarts, les exercices se faisaient avec presque autant de régularité qu’on en apporte de nos jours dans les mêmes travaux. Détail à noter : le plus absolu silence était, dès lors, considéré comme une indispensable condition de la bonne exécution de toutes les manœuvres.
Il est donc facile de se convaincre que, sous le ministère de Richelieu, nos vaisseaux ronds, tout comme les arsenaux nécessaires à leur entretien, jouissaient d’une organisation sagement conçue et véritablement forte pour l’époque. Mais le grand cardinal dut s’occuper aussi de cette vieille flotte des galères qui, depuis la mort de Jean de Vienne jusqu’à son propre ministère, avait été, en fait, la seule force navale organisée qu’eût possédée la France. Ici les règlements ne manquaient pas : la sage ordonnance de 1548, — résumé des idées et des prescriptions de Polin de la Garde, — régissait encore le corps des galères. D’après ses dispositions, les capitaines de notre flotte à rames, moyennant une redevance annuelle largement calculée, devaient entretenir leurs navires toujours prêts à prendre la mer. L’armement de ceux-ci avait donc un caractère de permanence, et la composition de leurs équipages, un caractère de fixité, qui faisaient presque complètement défaut à notre nouvelle flotte de vaisseaux ronds. Le corps des galères aurait dû trouver dans ce fait une précieuse garantie de force. Malheureusement, l’improbité, la négligence et l’incapacité avaient vicié cette solide institution, et Richelieu, eut toutes les peines du monde à triompher des résistances, des habitudes de désordre et d’indiscipline devenues, ici, de véritables traditions. A vrai dire, beaucoup de galères étaient pour leurs capitaines une sorte de propriété, tout au moins temporaire ; appartenant à de grandes familles, ayant à la cour de puissants protecteurs, ces officiers se croyaient tout permis, et Richelieu lui-même eut quelquefois pour eux de singulières faiblesses. Pour le recrutement des rameurs, on se heurtait, en outre, à des difficultés sans cesse croissantes : aux esclaves musulmans, qui devenaient de plus en plus rares, il fallut ajouter presque tous les criminels, sans compter les innocents, condamnés par nos tribunaux, et, chose triste à dire, jusqu’aux infortunés que la misère, aussi souvent que le vice, poussait au vagabondage et à la mendicité.
Nous avons essayé, de prouver que l’organisation donnée à la marine de Louis XIII fut très sérieuse et servit de base au magnifique établissement naval créé sous le règne suivant. Trop longtemps, peut-être, ce point d’histoire n’a pas été mis en pleine lumière : les brillants succès des vaisseaux commandés par du Quesne et Tourville ont fait oublier trop facilement les victoires dues à la valeur des Sourdis, des Brézé, et plus encore à l’habileté des marins presque inconnus qui les conseillaient; mais ce n’est point faire tort à la mémoire du grand Colbert que de rendre justice à celle du ministre de génie qui fixa les premières assises sur lesquelles reposa bientôt la puissance maritime de la France.
Charles-Marie Chabaud-Arnault
Charles-Marie Chabaud-Arnault entre élève à l’École navale en 1854. Il est aspirant de 2e classe en 1856, lieutenant de vaisseau en 1860. En 1876, il remet le commandement de l’aviso à roues le Casabianca se trouvant en Guyane et embarque pour revenir en France. Il est nommé inspecteur des électro-sémaphores au port de Brest en 1879 et nommé capitaine de frégate l’année suivante. Il est second sur le cuirassé de 2e rang la Victorieuse, lancé en 1875 à Toulon, qui porte le pavillon amiral, en 1881. Il est capitaine de frégate de réserve en 1886, il est admis à la retraite le 16 février 1885. Il a rédigé un grand nombre d’articles pour la Revue maritime et coloniale à partir de 1877 dont certains ont été réimprimés en tiré à part.