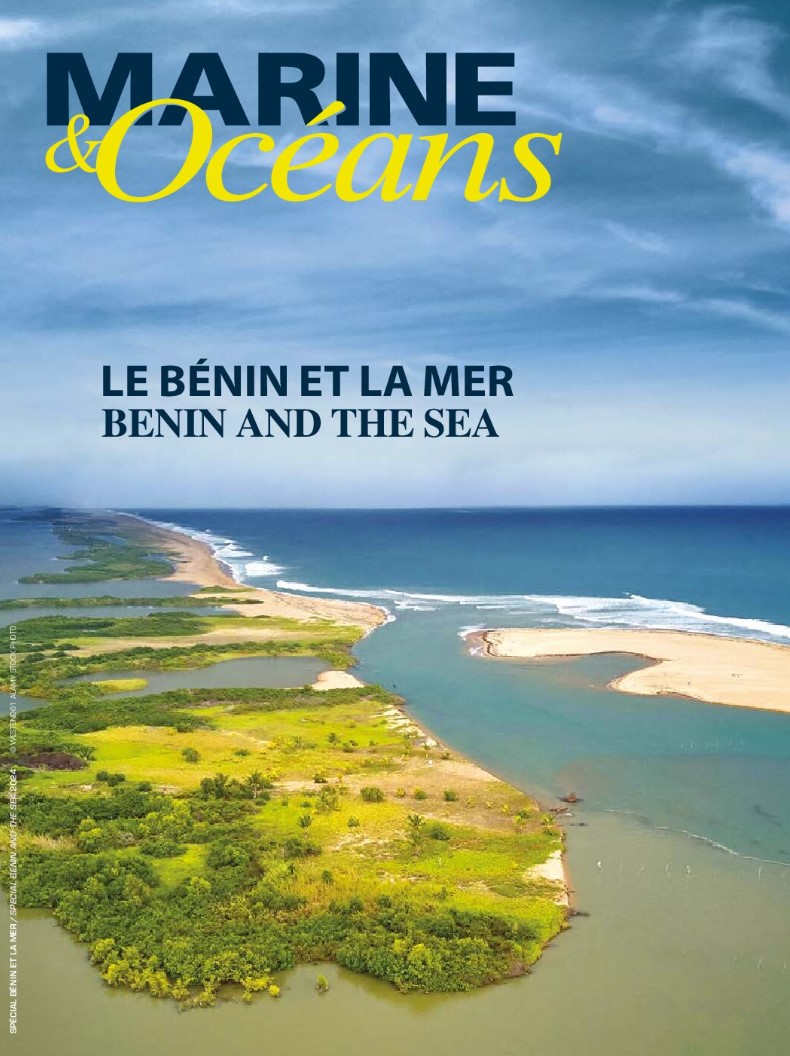Arnaud de La Grange, actuellement correspondant permanent du Figaro à Londres, publie son troisième roman, La promesse du large (Gallimard), l’histoire de la régénérescence d’un jeune homme orphelin par l’Océan. Ancien élève au Prytanée militaire de La Flèche (Sarthe), destiné à une carrière d’officier dans l’armée de Terre brisée par un grave accident, il est officier sous contrat dans la Marine à l’issue de ses études universitaires embarquant autour du monde à bord de l’Ouragan avant de rejoindre le Secrétariat général de la défense nationale puis le Figaro pour lequel il sera successivement grand reporter, correspondant permanent à Pékin et directeur-adjoint de la rédaction. Navigateur averti, Arnaud de La Grange est spécialement attiré par la mer dont il a fait le principal héros de ce nouveau roman.
Propos recueillis par Aurélien Duchêne
* * *
 Votre livre raconte les blessures intimes d’un jeune homme orphelin dont les parents sont morts dans un naufrage et qui, à 26 ans, décide de retrouver leurs traces. Pourquoi ce thème et quels principaux ressorts avez-vous voulu exploiter ?
Votre livre raconte les blessures intimes d’un jeune homme orphelin dont les parents sont morts dans un naufrage et qui, à 26 ans, décide de retrouver leurs traces. Pourquoi ce thème et quels principaux ressorts avez-vous voulu exploiter ?
Cela m’intéressait d’explorer ce thème des blessures familiales non-cicatrisées, qui empêchent d’avancer. En se mentant à lui-même et en refusant de voir son passé (le drame absolu qu’est la perte de ses deux parents sans même les avoir connus), en préférant occulter son histoire familiale et en se persuadant qu’il n’a pas d’origines et de lignée, ce jeune homme est un peu inapte à la relation aux autres. J’explore cela à ma façon, avec une histoire de naufrage, mais l’on sait que les traumatismes infantiles suivent les gens à l’âge adulte et sont une charge qu’ils portent toute leur vie. Les personnes abandonnées dans leur enfance ont tendance à être peu sûres d’elles et à développer une dépendance émotionnelle basée sur la peur d’être de nouveau abandonnées. Cela m’intéressait d’avoir un personnage fragile de ce point de vue-là. Beaucoup d’entre nous ont des blessures personnelles ou familiales qu’ils mettent sous le tapis et qui les empêchent d’avancer comme ils le voudraient. C’est un thème que je voulais relier à la mer, qui est le grand sujet du livre avec ce paradoxe que l’océan est la fois la cause du malheur de ce garçon, et le vecteur de sa rédemption.
Vous faîtes en effet renaître Aidan — c’est le nom de votre héros —, par la mer qui est au cœur, qui est le cœur, de votre roman. Quelle relation avez-vous avec la mer et quelles vertus lui trouvez-vous ainsi qu’à ceux qui la pratiquent (pêcheurs, sauveteurs…) dont vous décrivez si bien l’univers ?
La mer est le personnage principal du livre avec Aidan et Manon. C’est assez personnel, car je me suis rendu compte que l’on n’écrit jamais mieux que sur les choses qui nous parlent intimement. Si je n’ai pas eu une expérience de vie aussi tragique que celle de mon personnage, j’ai connu à l’âge de 18 ans un accident qui a changé la direction que j’avais choisie pour ma vie — une carrière dans l’armée de Terre en l’occurrence —, et la mer et la navigation m’ont beaucoup aidé à me sortir de cette phase sombre. Je ne prétends pas être un grand marin — je navigue à la voile et j’ai été officier de Marine —, mais la mer a toujours été pour moi le « lieu juste » dont je parle dans mon livre. En essayant modestement de faire un roman de mer, j’essaie de lui rendre ce qu’elle m’a donné. La mer a aussi une vertu qui rejoint ce que disait Tabarly, pour qui elle n’est pas faite pour les imposteurs, elle nous tend un miroir de vérité. Elle a une double dimension, de rêve et de concret, avec les problèmes que doivent affronter les navigateurs. Je parle aussi dans ce livre des pêcheurs, des sauveteurs en mer, qui montrent un autre aspect du monde de la mer, la fraternité humaine, sachant que ce sont des gens qui se mettent peu en avant.

Aidan ne serait pas parvenu à trouver le chemin de la renaissance sans l’aide d’une femme qui le guide, l’accompagne, l’épaule, l’aime… Ce personnage clé de votre roman devait-il être une femme ? Aurait-il pu être un homme, un « camarade de combat », un « camarade de renaissance » rappelant ce thème, qui vous est cher, de la fraternité humaine au cœur de l’un de vos précédents romans « Le huitième soir » ?
C’est une femme que j’ai voulu un peu à l’écart du courant principal — elle est vitrailliste —, mais qui a une très fine compréhension de l’âme humaine. Elle est navigatrice et est persuadée que la mer va pouvoir « déverrouiller » Aidan. Si la mer a été son malheur, c’est par elle qu’il va pouvoir se trouver. La jeune femme va aider l’orphelin à réapprivoiser la mer. Pour avancer, il nous faut plonger en nous-même, avec de la solitude, mais on a aussi parfois besoin d’un détour par autrui, et il passe ici par Manon. Dans mon livre précédent, qui se passait à Diên Biên Phu, ce chemin passait plutôt par la fraternité humaine.
Vous emmenez le lecteur dans le quotidien d’un petit village de pêcheur avec ses silences, ses non-dits, ses parts d’ombre et de lumière. Comment avez-vous travaillé cela ?
J’ai voulu créer une atmosphère où flotte une sorte de culpabilité collective à l’égard de cette tragédie maritime. Je montre des gens qui se sont détournés de cette tragédie par confort. Il est intéressant de voir qu’il y a souvent, dans l’inconscient d’une communauté comme celle que forme ce village, des phénomènes de culpabilité non-réglée qui peuvent durer longtemps. Et je montre aussi des gens lumineux, comme ces pêcheurs devenus sauveteurs en mer.
Pour revenir à la voile, vous nous emmenez avec le même réalisme dans la magie et la rudesse de longues navigations à bord du voilier de Manon qui amène le héros à la rédemption…
Je ne prétends pas être un immense marin. Je ne suis pas un régatier et je préfère naviguer pour rêver mais espère parler de la mer de manière assez juste et réaliste. J’essaie de retranscrire à la fois le rêve et la manivelle, de coller à la réalité de la navigation. Conrad, par exemple, écrit à la fois des pages magnifiques sur la mer mais aussi sur la dureté de la condition des forçats des océans. Il y a aussi ce rapport aux éléments, envers qui il faut être d’une grande humilité. Naviguer à la voile, c’est avant tout communier avec la nature. Plus encore qu’une vertu, la modestie est en mer un gage de survie. Et je trouve que les matelots que j’avais sous mes ordres dans la Marine ont des traits communs avec les marins pêcheurs : le monde de la mer est très divers, mais il y a une vraie communauté des gens de mer.