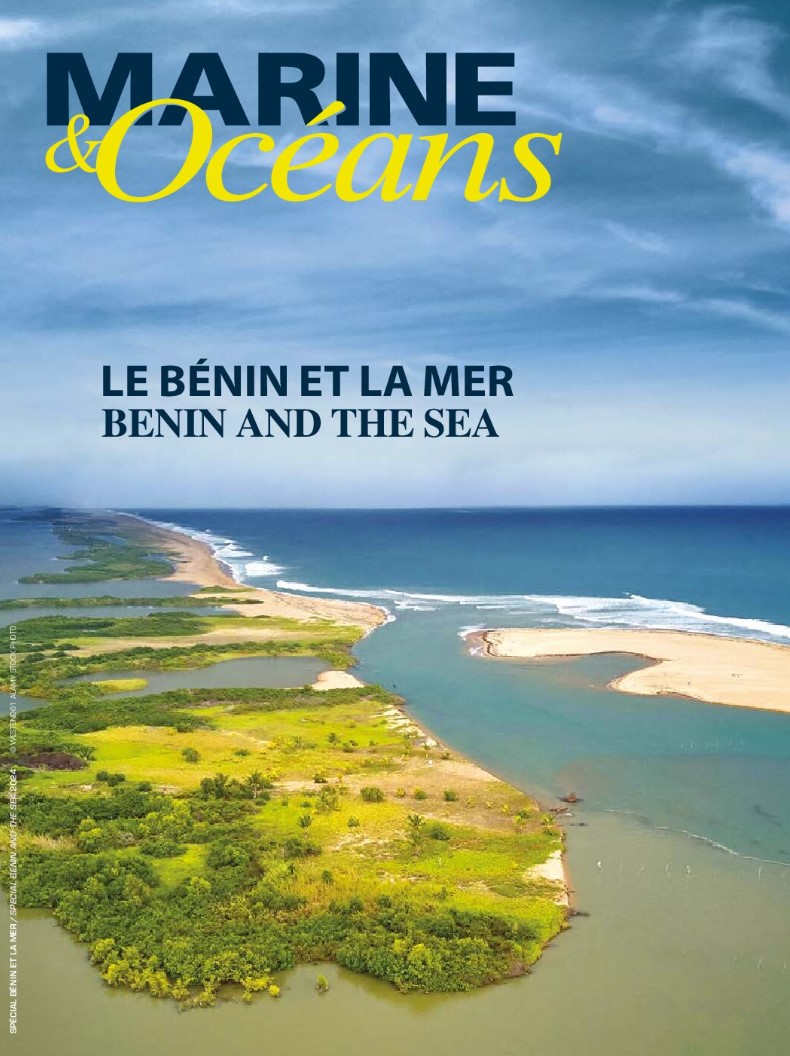En mars dernier, l’association Bloom a pris l’initiative de publier une liste de chalutiers accusés d’avoir pêché en 2024 dans les aires marines protégées. Cette « liste rouge » qui recense plus de 4 000 navires, dont des chalutiers français, vise à faire boycotter leur production par la grande distribution.
Pour le Cluster maritime français et l’Association nationale des élus des littoraux, qui soulignent l’importance de la pêche française pour la souveraineté alimentaire, cette initiative « affecte injustement des professionnels dans la dignité de leur travail quotidien et dans leur environnement social, et ne favorise pas l’établissement d’un dialogue constructif pour la protection des océans, dont tous les acteurs de l’économie bleue dépendent ». Explications.
Par Nathalie Mercier-Perrin, Présidente du Cluster maritime français (CMF)
et Yannick Moreau, Président de l’Association nationale des élus des littoraux (ANEL)
***
Les pêcheurs français constituent un maillon essentiel de notre écosystème économique et de notre souveraineté alimentaire, garantissant l’approvisionnement en produits de la mer, frais et de qualité, de l’ensemble de nos concitoyens.
La France possède le deuxième espace maritime mondial avec 11 millions de kilomètres carrés de zones sous juridiction française, une richesse exceptionnelle qui nous confère des responsabilités importantes en matière de gestion durable des ressources.
Nos pêcheurs sont les gardiens vigilants de ce patrimoine maritime, assurant une présence régulière sur ces vastes étendues et contribuant activement à la surveillance des activités qui s’y déroulent.
Malgré cette immense zone maritime, la production de la pêche française reste mesurée et responsable, estimée à environ 535 000 tonnes par an, témoignant d’une approche raisonnée de l’exploitation des ressources marines. Ce chiffre contraste fortement avec d’autres nations comme la Chine, dont la production atteint 11,8 millions de tonnes sur l’année 2022 selon la FAO.
Un contexte difficile pour la filière pêche française et les territoires littoraux
Le secteur de la pêche française fait face à des défis majeurs qui fragilisent notre capacité de production nationale : les conséquences du Brexit, les plans de sortie de flotte et les arrêts temporaires d’activité constituent autant d’obstacles qui pèsent sur une balance commerciale déjà déficitaire.
Pour les élus des territoires littoraux, ces difficultés se traduisent par des enjeux socio-économiques considérables : risque de dévitalisation des ports, menaces sur l’emploi local, diminution de l’attractivité touristique liée à l’authenticité des ports de pêche, et perte d’un patrimoine culturel irremplaçable. Fragiliser la situation des marins-pêcheurs, c’est fragiliser une filière entière où un emploi en mer génère entre 4 et 5 emplois à terre.
En outre, la pêche n’est pas qu’une activité économique, elle est l’âme de nombreuses communes littorales dont elle forge l’identité depuis des générations.
Face à ces contraintes, il apparaît plus que jamais nécessaire de valoriser et de soutenir nos pêcheurs pour préserver notre autonomie alimentaire dans le domaine des produits de la mer. Ce soutien représente également une reconnaissance légitime envers ces femmes et ces hommes qui, par leur travail quotidien, contribuent à nourrir la nation.
Des remises en cause préoccupantes et contestables
Les critiques récemment formulées à l’encontre de certains navires de pêche français soulèvent des préoccupations quant à leurs bases scientifique et juridique. Ces démarches, qui peuvent s’apparenter à une forme de lynchage médiatique, ne contribuent pas à un débat constructif sur l’avenir de la pêche et la protection des océans.
Il est important de souligner que les données utilisées pour étayer certaines de ces accusations présentent des limites méthodologiques importantes qui ont été identifiées par la communauté scientifique. De plus, l’inclusion dans ces listes contestées de navires qui ne sont ni des chalutiers, ni même des navires de pêche, révèle un manque de rigueur technique qui fragilise la crédibilité de telles initiatives.
Une pêche française réglementée et engagée dans la transition écologique
La pêche française figure parmi les plus encadrées au monde. Les pêcheurs exercent leur activité dans le strict respect des réglementations en vigueur, notamment dans les Aires marines protégées (AMP) qui se déclinent en 11 catégories différentes, chacune adaptée à des enjeux locaux spécifiques.
La filière est engagée depuis plus de 30 ans dans une démarche continue d’amélioration de ses pratiques, conciliant préservation des ressources halieutiques et maintien d’une activité économique vitale pour nos territoires littoraux. Les résultats de cet engagement sont tangibles : le secteur a déjà réduit de 52% ses émissions de gaz à effet de serre depuis 1990.
De plus, la réglementation européenne a déjà interdit certaines pratiques lorsque l’impact environnemental le justifiait. Depuis 2016, par exemple, la pêche en eau profonde est interdite au-delà de 800 mètres dans les eaux communautaires de l’Atlantique Nord-Est.
Pour une approche collaborative de la protection des océans
La protection efficace des océans nécessite une approche nuancée, fondée sur des données scientifiques robustes et élaborées en concertation avec l’ensemble des parties prenantes. La suppression des spécificités locales au profit d’une analyse globale accroît les incertitudes et peut nuire aux efforts de conservation.
Le recours à des méthodes de stigmatisation médiatique ne permet pas de construire les progrès nécessaires dans la protection des océans dont tous les acteurs de l’économie bleue dépendent. Seul un dialogue respectueux et informé, impliquant l’ensemble des parties concernées, peut conduire à des avancées durables en matière de protection environnementale.
Le Cluster maritime français est convaincu que c’est en accompagnant les filières françaises dans leur transition écologique et énergétique, sur la base de données scientifiques fiables et d’un dialogue constructif, que nous pourrons concilier efficacement protection des océans, souveraineté alimentaire et préservation d’un patrimoine culturel et économique essentiel pour nos territoires littoraux.
Préserver notre modèle de pêche diversifié et notre souveraineté alimentaire
La force de la filière pêche française réside précisément dans la diversité de ses pratiques, adaptées aux spécificités des territoires maritimes. Cette diversité est une richesse qu’il convient de préserver.
Remettre en cause l’une des pêches les plus encadrées et responsables au niveau international, comme le font certaines initiatives récentes, soulève des questions importantes quant à la préservation de notre souveraineté alimentaire. Réduire drastiquement l’activité de pêche française conduirait inévitablement à une dépendance accrue aux importations de produits de la mer, souvent pêchés dans des conditions moins respectueuses de l’environnement et des normes sociales.
Les élus des littoraux sont particulièrement attentifs aux conséquences sociales et économiques de telles évolutions. L’ANEL souligne l’importance de maintenir un équilibre entre préservation de l’environnement et maintien des activités économiques traditionnelles qui font vivre les territoires. La disparition progressive de la pêche française aurait des répercussions dévastatrices sur de nombreuses communes littorales déjà fragilisées par diverses pressions : érosion côtière, spéculation immobilière, transition énergétique, etc.
Pour toutes ces raisons, l’ANEL renouvelle sa proposition de placer la pêche au rang d’« intérêt fondamental de la nation », afin que l’activité des marins-pêcheurs français soient pleinement respectée et que leur action en faveur de la souveraineté alimentaire de notre pays soit mieux prise en compte et protégée.
Une approche permettant de concilier transition écologique et préservation des activités économiques littorales est non seulement possible mais nécessaire.
Elle passe par l’accompagnement des filières dans leur évolution plutôt que par leur stigmatisation.
Le Cluster maritime français et l’Association nationale des élus des littoraux appellent donc à privilégier une démarche collaborative associant tous les acteurs concernés, seule à même de permettre une protection efficace et durable de nos océans tout en garantissant notre souveraineté alimentaire et la vitalité de nos territoires côtiers. C’est par le dialogue constructif et le respect mutuel, et non par la violence des procédés de stigmatisation médiatique, que nous pourrons collectivement relever les défis de la préservation des océans et des ressources halieutiques.