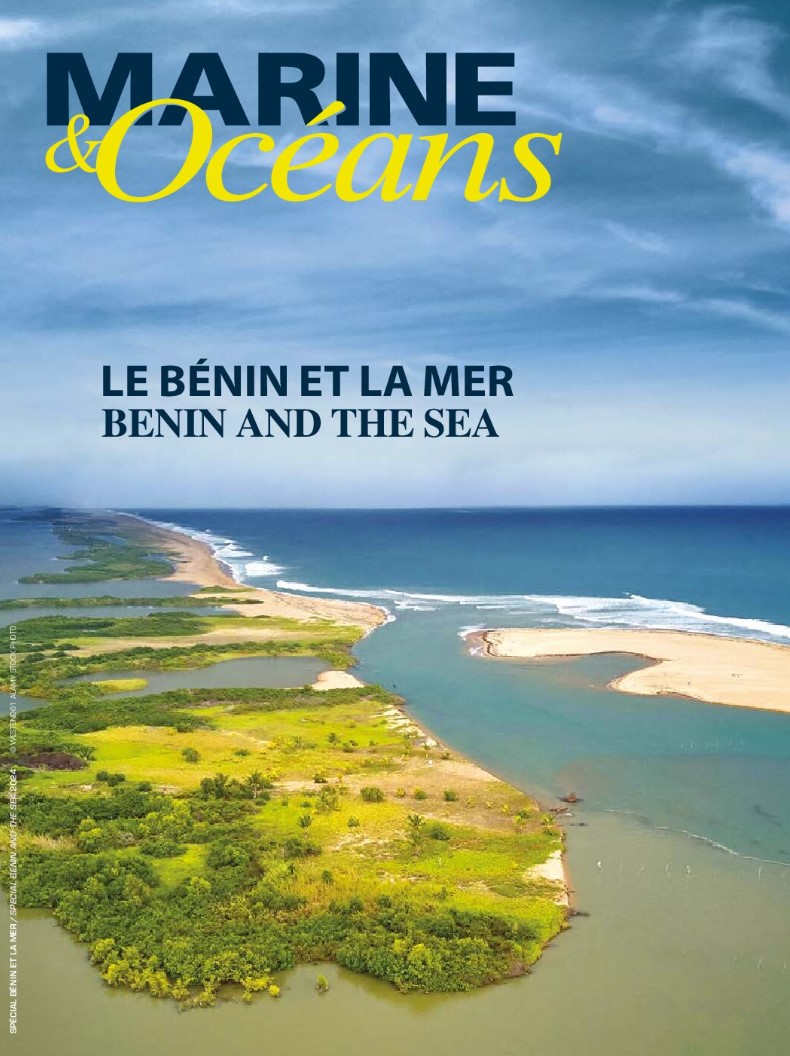Aksel Rousseau a fondé, avec Meckrya Mathouraparsad, « Manni Manniok », un projet visant à présenter des savoir-faire autour de ce tubercule, base de la nourriture d’une grande partie de la population vivant en zone tropicale.
L’un est accompagnateur de montagne, l’autre laborantin, mais tous deux sont passionnés par ce produit qui, disent-ils, compte plusieurs centaines de variétés différentes et autant de manières de l’utiliser.
Très utilisé par les Amérindiens, du Brésil aux plateaux de Guyane, puis sur le continent africain, le manioc a fini par être relégué au second plan au gré de l’évolution des habitudes alimentaires importées par les Européens. La racine a simplement été conservée dans les jardins familiaux.
« Le manioc n’a pas totalement disparu de nos assiettes: on le mange encore sous forme de cassaves, ces galettes moelleuses très amidonnées, qu’on peut agrémenter de légumes, de viande ou de confiture », rappellent les deux promoteurs du manioc.
– « Résistance alimentaire » –
En Guadeloupe, le manioc est encore cultivé, mais sans aucune structuration de filière.
Selon les chiffres publiés dans un document de la statistique agricole tenue par les services de l’Etat, en 2020 68 ha (sur 31.000 de surface agricole utilisée en Guadeloupe par des exploitations) étaient plantés en manioc sur l’archipel, produisant 509 tonnes annuelles.
Localement, le tubercule est exploité dans les kassaveries, des espaces d’agro-transformation très artisanaux. Une fois ramassée, il faut le laver, l’éplucher, le transformer en farine par grugeage (râpage, « grajé » en créole).
« On doit améliorer la transformation du manioc, car ce travail est très pénible », souligne, de son côté Widy Grego, un marathonien guadeloupéen de renom, « tombé » dans le manioc quand il était petit.
Lui a toujours profité de ses courses autour du monde pour s’informer sur cette racine qu’il a fini par adopter totalement lors de son adhésion au mouvement rastafari. Il a monté un « laboratoire » pour créer de nouveaux produits à base de manioc et imagine bien une forme d’industrialisation de la production guadeloupéenne.
« C’est un produit de résistance alimentaire à l’ultratransformé, un produit sain, nourricier, local et ancestral », affirme-t-il.
– Méconnaissance scientifique –
Aux Antilles françaises, « le surpoids et l’obésité sont bien plus fréquents (…) par rapport à l’Hexagone », écrit Caroline Méjean, directrice de recherches à l’Inrae, dans les Cahiers de nutrition et de diététique en 2022, pointant deux hypothèses: la génétique d’une part, mais également la « transition nutritionnelle épidémiologique qui a eu lieu au cours des dernières décennies dans les Caraïbes ».
En Guadeloupe, ils sont nombreux à avoir pris à bras le corps cette thématique, mélange subtil de locavorisme, promouvant la consommation de nourriture produite dans un rayon restreint autour de son habitation, et de militantisme écologiste et décolonial.
Le but? « Produire des denrées peu transformées, des produits locaux, adaptés aux contextes des pays tropicaux où les pouvoirs d’achats sont relativement faibles notamment », détaillent Terence Pierrot et Emilie Galbas, fondateurs d’une entreprise de fabrication de pâtes alimentaires à base de tubercules tropicaux.
Le hic: la méconnaissance scientifique autour de ces produits. Selon eux, tout est à réapprendre et surtout à se réapproprier. L’aventure culinaire est séduisante et les chefs locaux de la cuisine gastronomique s’allient avec les agriculteurs, les agro-transformateurs et rivalisent d’originalité pour redonner des lettres de noblesse aux racines locales.
« Devenir locavore, c’est aussi redécouvrir notre biodiversité comestible propre », souligne Charlotte Polifonte, cheffe afro-végan, animaliste et antispéciste, qui anime un compte Instagram dédié. « On ne parviendra pas à l’autonomie alimentaire si on ne sait pas ce qu’on a chez nous, si on ne se réapproprie pas la connaissance d’antan sur le sujet. C’est aussi ça, se décoloniser ».