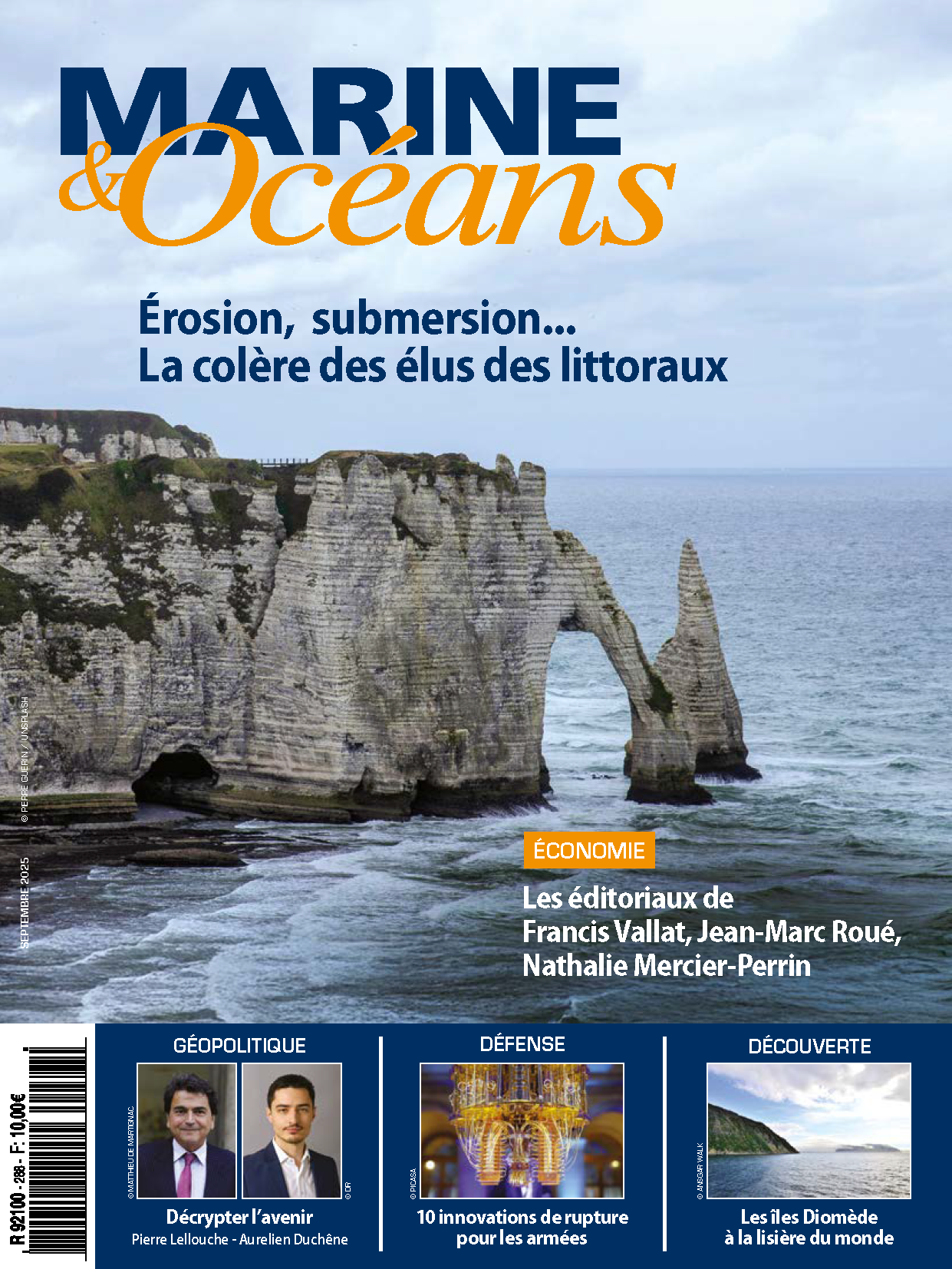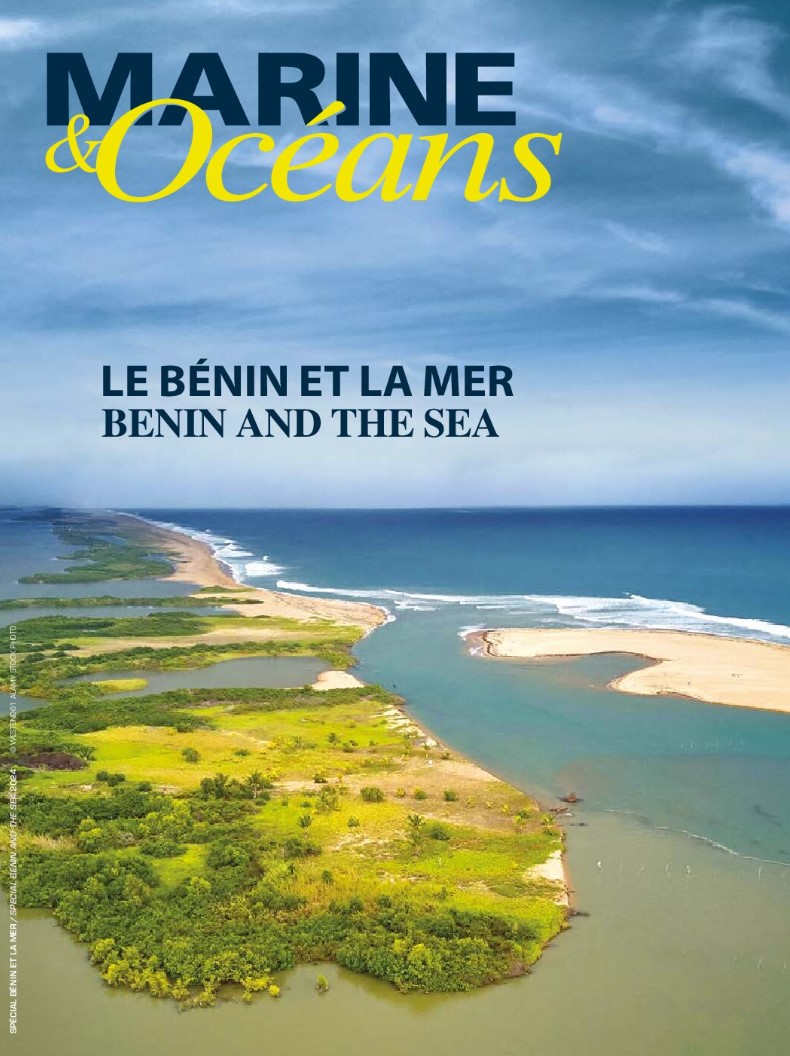Propos recueillis par Erwan Sterenn
***
En matière de défense, quels principaux enseignements la France doit-elle tirer du conflit en Ukraine ?
La première question que nous devrions nous poser est la suivante : est-il pertinent, précisément, de tirer enseignement de ce conflit pour dimensionner l’effort de défense français ? Avant de parler de format d’armées, de réserves, de stocks et de munitions, il convient de s’interroger sur les menaces actuelles et futures qui pèsent sur notre pays ainsi que sur le rôle que nous entendons jouer dans le monde, seuls ou aux côtés de nos alliés. La guerre que nous préparons n’est pas la défense d’un territoire national envahi par un régime autoritaire. Notre dissuasion nucléaire et nos alliances contribuent à nous en prémunir. Dès lors, méfions-nous des extrapolations hâtives.
Sous ce rapport, deux enseignements me semblent déjà incontournables. D’abord le niveau de réaction de l’Union européenne (UE) comme de l’OTAN en termes de cohésion, de soutien à l’Ukraine et de réarmement national, y compris en Allemagne, ont été satisfaisants dans l’ensemble. Nous devons activement travailler à renforcer nos alliances et notre résilience collective, en résorbant nos vulnérabilités, notamment au plan énergétique, et en « sincérisant » les relations entre partenaires. Des marges importantes de progression demeurent, comme le rappelle la mise à l’écart de la France dans le projet de bouclier antimissile européen.
Ensuite, cette guerre nous rappelle le caractère essentiel de la force morale et de la volonté. Les Ukrainiens n’auraient pas pu soutenir leur effort et contre-attaquer sans armement occidental mais ils n’auraient pas reçu cet armement s’ils n’avaient pas démontré une pugnacité exemplaire dans la défense de leur patrie et de leurs libertés. Ceci doit nous inspirer.
Les députés Jean-Louis Thieriot et Patricia Mirallès l’ont explicitement rapporté dans un récent rapport (n°5054) auquel vous avez contribué : l’armée française n’est pas prête pour tenir, dans la durée, une guerre de haute intensité. A-t-on vraiment pris la mesure de ce constat ? Quel doit être, selon vous, le niveau de la réponse ?
Nous ne sommes pas dans le contexte du livre blanc de 1972 qui prévoyait d’engager la première armée face aux divisions soviétiques, afin de tester les intentions de l’adversaire jusqu’au seuil nucléaire. Nous ne sommes pas plus en 1997, à l’époque où certains rêvaient d’intégrer la Russie dans l’architecture de sécurité euro-atlantique. Nous devons donc nous poser trois questions : « De quoi avons-nous besoin ? Avec qui ? Pour quoi faire ? ».
La dissuasion nucléaire protège nos intérêts vitaux. Nous devons être capables de répondre à des crises multiples et de continuer à projeter nos forces, mais aussi de pouvoir répondre, si besoin était, à un « engagement majeur » sous le seuil nucléaire. Je préfère ce terme à celui de « haute intensité », que nos armées connaissent dans la plupart des conflits de manière ponctuelle.
Dans un horizon de temps prévisible, un tel engagement majeur signifierait pour la France un engagement en coalition. Afin de décourager la Russie, une posture renforcée à l’Est aux côtés de nos alliés paraît s’imposer, au moins pour un certain temps. Dans ce contexte, nous avons besoin d’un format d’armées renforcé, d’efforts redoublés dans un grand nombre de milieux, comme le spatial, le cyberespace, ou encore les fonds marins, autant que d’assurer une continuité des grands programmes navals, aériens et terrestres. Mais ce n’est pas parce que la capacité de feu dans la profondeur est déterminante en Ukraine qu’il faudrait subitement tout miser sur l’artillerie. Ce n’est pas parce que l’aviation russe s’est révélée peu opérante que les stratégies de déni d’accès condamnent de manière générale un scénario d’entrée en premier par la voie aérienne.
Il serait en revanche souhaitable de remédier à notre manque chronique et ancien de munitions et si possible d’accroître notre stock, de réinvestir substantiellement dans la défense sol-air, comme de ne pas accumuler de retards supplémentaires dans le domaine des drones, par exemple.
Ceci nous amène à la question des choix budgétaires et capacitaires de la prochaine loi de programmation de militaire.
La France a-t-elle véritablement, en effet, les moyens budgétaires d’une remontée en puissance militaire suffisante pour tenir son rang dans un conflit de haute intensité ? Quelles sont les solutions ? Quelles sont les absolues priorités ?
Que veut dire « tenir son rang » quand on est une puissance moyenne flanquée de compétiteurs ou de partenaires stratégiques qui réarment avec des moyens 5 à 15 fois supérieurs aux nôtres ? Il faudrait d’abord se mettre d’accord sur ce point. Le Président de la République a raison d’insister sur notre capacité à résister à des tentatives de chantage dans le cadre d’une ou plusieurs crises internationales.
Depuis 2015, la France a mené un effort soutenu et crédible de remontée en puissance de ses budgets militaires, pour atteindre 44 milliards d’euros l’année prochaine. Les montants évoqués pour la prochaine loi de programmation militaire — de l’ordre de 410 milliards d’euros sur la période de 2024-2030, soit un budget annuel d’environ 58 milliards d’euros — s’inscrivent dans une continuité à la fois ambitieuse et réaliste.
Cela dit, même avec un budget supplémentaire de trois milliards d’euros par an, nos armées ne pourront pas tout faire. À moyen terme, l’inflation et des objectifs supplémentaires tels que le doublement de la Réserve et la généralisation du Service national universel (SNU) devraient consommer ces augmentations de crédits. Au regard du coût croissant des matériels modernes, de la nécessité de couvrir tous les milieux (la « servitude technologique » de l’Amiral Castex), d’être présent sur tous les théâtres du Groenland au Pacifique, mais aussi de faire pivoter notre armée de terre vers l’Est de l’Europe, il y a fort à parier qu’un nombre significatif de programmes vont connaître des décalages, alors même que nous n’aurons jamais connu des budgets aussi élevés. C’est le paradoxe dans lequel nous nous trouvons aujourd’hui.
Alors que faire ? Il y a deux options. Soit augmenter très significativement notre budget pour le porter à 80 milliards d’euros environ. Cette hypothèse paraît, sauf bouleversement géopolitique, peu probable au regard de la situation budgétaire dégradée de notre pays. Rappelons-le, bénéficier de finances publiques saines est un déterminant majeur de la puissance ! Soit opérer des choix et assumer des renoncements, le plus judicieusement possible.
De ce point de vue, force est de constater que la dernière Revue nationale stratégique, qui n’est pas le torchon décrit par certains, marque des inflexions mais ne renonce à rien. J’y vois un risque d’écart croissant entre les discours et les actes, qui pourrait à terme nuire à notre crédibilité ainsi qu’à la confiance que nos concitoyens placent dans les institutions de la République, un élément de résilience à ne jamais négliger.
La prochaine loi de programmation militaire devra poursuivre l’effort en direction de notre dissuasion nucléaire dont le renouvellement des trois composantes a débuté. Idéalement, il nous faudrait aussi regagner de la « masse » et donc densifier nos forces conventionnelles, notamment en améliorant les soutiens et en régénérant le potentiel de nos matériels, afin de pouvoir tenir des engagements majeurs dans la durée, malgré les dommages au combat. Parallèlement, nous devrons répondre aux défis industriels et technologiques dans plusieurs nouveaux champs et milieux, allant du cyberespace aux munitions hypersoniques.