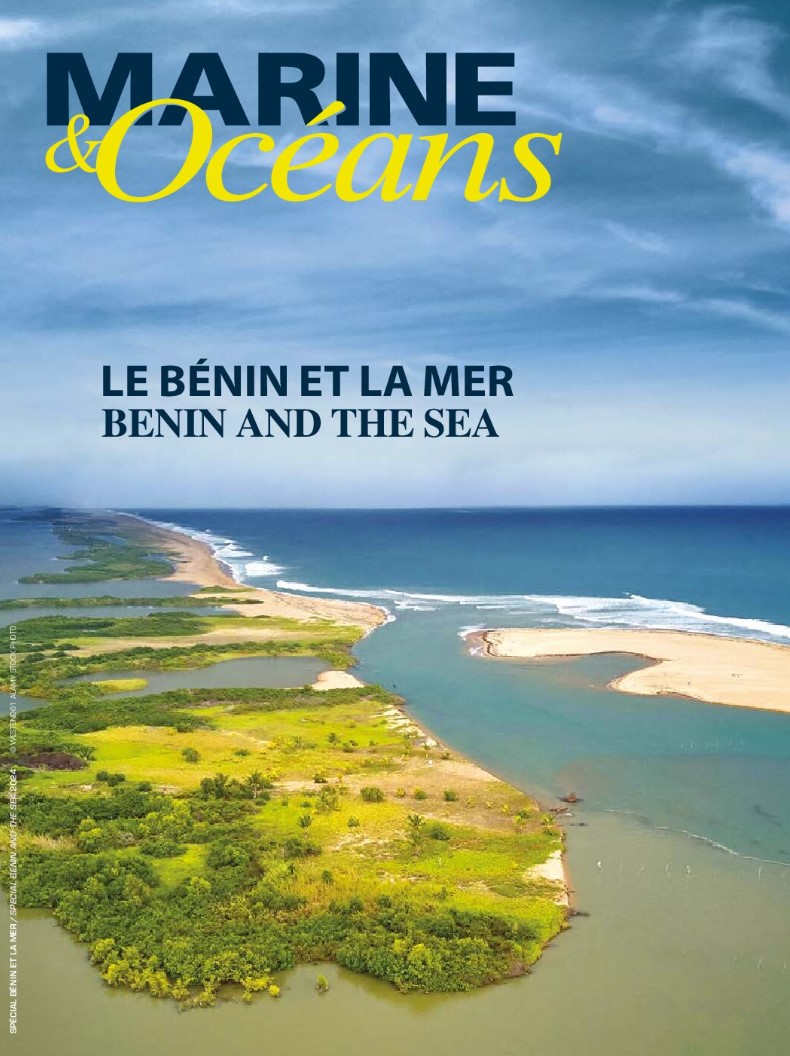Ambassadeur de France en Jamaïque, Olivier Guyonvarch est également Représentant permanent de la France auprès de l’Autorité internationale des fonds marins (AIFM) et l’un des meilleurs connaisseurs français des questions maritimes. Il revient pour Marine & Océans sur les enjeux liés à l’exploration et à l’exploitation des grands fonds marins.
Propos recueillis par Bertrand de Lesquen
***
L’on dit que vous avez accepté d’être ambassadeur de France en Jamaïque notamment parce ce que ce pays héberge l’AIFM, que vous connaissiez déjà bien pour y avoir été le représentant de la France, et que vous souhaitiez continuer à l’être. Est-ce exact ?
Je n’ai pas accepté d’être ambassadeur en Jamaïque, je l’ai demandé ! Après la crise Covid à Wuhan, où j’étais consul général, le ministère des Affaires étrangères a décidé de me confier une ambassade. J’ai postulé pour Kingston en raison du rôle de Représentant permanent auprès de l’AIFM. Passionné par les questions maritimes, je connaissais bien les problématiques de l’AIFM pour y avoir été chef de la délégation française de 2012 à 2016, alors que j’étais Sous-directeur du droit de la mer, du droit fluvial et des questions polaires au Quai d’Orsay. Traditionnellement l’ambassadeur de France en Jamaïque est peu impliqué dans le dossier « grands fonds marins » en raison de sa technicité, et le sujet est suivi depuis Paris. Aujourd’hui, en raison de l’accélération du travail de l’AIFM, et en lien étroit avec mes collègues parisiens, je m’implique beaucoup dans le dossier, qui revêt des enjeux globaux importants. Je suis donc très heureux d’avoir fait le choix de Kingston !
Les fonds marins sont aujourd’hui au cœur d’enjeux économiques, politiques, environnementaux et juridiques cruciaux. Qu’est-ce d’abord que l’AIFM et à quoi sert cette institution ?
L’AIFM est l’une des trois institutions créées par la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982 (dite « Convention de Montego Bay »). Contrairement à ce qu’on lit trop souvent dans la presse, ce n’est pas une instance de l’ONU, mais une organisation internationale à part entière, dotée d’un Secrétariat, d’une Assemblée qui regroupe ses 167 Etats parties
plus l’Union européenne, et d’un Conseil de 36 Etats-membres qui en constitue l’organe exécutif et décisionnel. Pour éclairer ses décisions, le Conseil élit deux commissions composées de personnalités indépendantes : la Commission juridique et technique (CJT) prépare les textes juridiques, et formule au Conseil des recommandations sur les demandes de permis d’activités dans les grands fonds marins et en contrôle la bonne exécution ; elle joue aussi un rôle important en organisant de nombreux séminaires scientifiques sur la connaissance des fonds marins, notamment sur les questions de protection de l’environnement. La Commission des finances, pour sa part, examine le budget de l’Autorité et se prononce sur toutes les décisions entraînant des conséquences financières. Mise en place en 1996, l’Autorité a adopté dans les années 2000 trois codes de prospection et d’exploration pour les trois principales ressources minérales des grands fonds marins et a approuvé à ce jour 31 contrats d’exploration pour ces ressources. L’Autorité est donc la gardienne vigilante des grands fonds marins, nulle entreprise ou nul Etat ne peut aller en explorer et a fortiori exploiter les ressources minérales sans son autorisation. Son mandat porte sur la plus vaste zone (avec un petit « z ») terrestre, la Zone (avec un grand « Z »), c’est-à-dire les grands fonds marins au-delà des zones économiques exclusives (ZEE) des Etats côtiers. Sa seule existence a établi un moratoire de fait sur tout projet d’exploitation, qui n’a pas encore démarré.
Pouvez-vous nous rappeler ce que sont ces minéraux, reconnus patrimoine commun de l’humanité depuis 1982, qui attirent tant les Hommes au fond des mers ? Quels sont-ils précisément et pour quelles utilisations les recherche-t-on ?
Revenons d’abord sur le statut juridique des ressources minérales de la Zone, qui sont déclarées par la partie XI de la Convention de Montego Bay « patrimoine commun de l’Humanité ». Ce statut s’applique aux ressources minérales liquides, solides ou gazeuses, et non pas aux ressources biologiques. Il implique d’une part que leur accès n’est pas libre mais doit être autorisé par l’Autorité, et d’autre part que leur exploration et leur exploitation rendues possible par la Convention de Montego Bay doit se faire au bénéfice de l’Humanité toute entière. Ainsi, les revenus qui seront tirés de l’exploitation devront être partagés avec les Etats en développement. C’est donc un statut unique, fondé sur le principe du partage.
Les trois ressources visées sont les nodules polymétalliques, les sulfures polymétalliques et les encroutements cobaltifères. Les nodules ont été découverts dès le milieu du XIXe siècle. Les nodules sont des sortes de boules de pétanque posées sur le fond des grandes plaines abyssales, entre 3 000 et 6 000 mètres de profondeur. Les sulfures polymétalliques sont des cheminées
hydrothermales éteintes qui se sont édifiées en concrétions de plusieurs mètres de hauteur ; les encroûtements cobaltifères sont des concrétions horizontales de 30 à 60 cm d’épaisseur que l’on trouve à moindre profondeur. Toutes ces concrétions, de formation et d’origine différentes, sont extrêmement concentrées en minéraux, notamment ce qu’on appelle les « terres rares » aujourd’hui très recherchées dans l’industrie high tech et la fabrication des batteries. Dans les années 1970, au moment où a été négociée la Convention de Montego Bay, on a considéré que ces ressources présentaient de nombreux avantages : elles sont beaucoup plus concentrées en minéraux que dans les mines terrestres et elles sont posées sur le fond des océans, il n’est pas nécessaire de creuser et de déplacer des volumes considérables de sédiments pour les atteindre. A l’époque on pensait que l’impact environnemental serait très faible comparé aux mines terrestres, tant les plaines abyssales obscures, glacées et écrasées sous des pressions d’eau de plusieurs milliers de fois plus forte qu’à la surface, semblaient des déserts de vie. Enfin, leur exploitation est exempte de tout risque géopolitique puisqu’elle pourrait se déployer en dehors de la juridiction de tout Etat, et sous un strict contrôle international, sur la base de règles internationalement négociées et agréées. En revanche, l’obstacle principal résidait dans la diffi- culté technique à aller collecter ces minéraux et les remonter sur plusieurs km de colonne d’eau.
Aujourd’hui la donne a changé : les techniques pour ramasser au fond les nodules, les remonter et les traiter à la surface arrivent à maturité et plusieurs entreprises ou Etats pourraient demain se lancer dans cette industrie. La société TMC (The Metal Company) en a fait récemment la démonstration. Toutefois, l’exploitation n’a pas encore commencé pour deux raisons principales : tout d’abord, l’Autorité n’a pas encore adopté les codes d’exploitation destinés à encadrer strictement cette activité. Et surtout, les avancées de la science océanographique nous ont fait découvrir une riche et unique biodiversité associée aux ressources minérale, adaptée à des conditions de vie extrême, mais aussi très fragile et peu résiliente aux impacts d’une éventuelle exploitation.

Cette question de l’exploitation des fonds marins s’est, semble-t-il, subitement accélérée avec les exigences d’un petit Etat du Pacifique, Nauru, pressé d’être, si l’on peut dire, le premier à tirer parti des richesses sous-marines… Quels sont les ambitions et les projets de Nauru qui, rappelons-le, s’est développé, jusque dans les années 70-80, grâce l’exploitation du phosphate à terre ?
Tout d’abord Nauru n’a pas « d’exigences », mais entend simple- ment exercer les droits qui lui sont conférés, comme à chaque Etat, par la Convention. En effet, tous les Etats-parties, qu’ils soient développés ou en développement, petits ou grands, insulaires ou enclavés, qu’ils en aient les capacités technologiques et financières ou non, ont le droit directement ou à travers une entreprise privée d’explorer, et à terme d’exploiter les ressources de la Zone. Ces activités ne peuvent se faire que sur la base d’un contrat, conclu avec l’Autorité et dont l’exécution est placée sous son contrôle. En pratique, un explorateur ou un futur exploitant doit déposer une demande de plan de travail qui doit décrire par le menu les activités envisagées. Cette demande est examinée par la Commission juridique et technique qui formule une recommandation au Conseil. Ce n’est qu’après approbation par le Conseil, donc par les Etats, que le demandeur, qui devient alors un contractant, peut signer un contrat et démarrer l’activité. Comme nous sommes dans un système sous contrôle international, le contractant, qu’il soit une entreprise publique ou privée, doit être parrainé par un Etat dont il a la nationalité, lequel endosse la responsabilité internationale de ses activités et en garanti la conformité au droit international établi par l’Autorité. Aujourd’hui, l’Autorité a signé trente et un contrats d’exploration, avec 22 contractants. La Chine, avec 5 contrats, est l’Etat qui en patronne le plus. La France patronne deux contrats de l’Ifremer.
Nauru a déclenché en juin 2021 « la règle des deux ans », une disposition de la Convention qui stipule que tout Etat qui souhaite se lancer dans l’exploitation peut demander à l’Autorité d’achever le code minier dans les deux ans qui suivent cette demande. Cette règle qui tient dans trois courts paragraphes, dispose également que si le code minier n’est pas achevé dans le délai prescrit, alors le demandeur peut demander l’approba- tion provisoire d’un plan de travail par le Conseil. Nauru, l’un des plus petits Etats insulaires au monde et dont toutes les réserves minérales terrestres ont été épuisées comme vous le rappelez, n’a d’autres ressources que celles de l’Océan. Nauru cherche ainsi à assurer sa survie en parrainant un futur contrat d’exploitation des nodules par la société The Metal Company. Cette demande de Nauru a considérablement accéléré le travail d’élaboration du code minier, démarré en 2015, au rythme d’une réunion du Conseil par an. Depuis 2020, hors période de pandémie, le Conseil s’est réuni deux puis trois fois par an, et a mis en place cinq groupes de travail pour élaborer les textes ju- ridiques destinés à encadrer l’exploitation. Mais en juillet 2023, le couperet de la « règle des deux ans » est tombé, alors que le Conseil n’a pas encore achevé ses travaux. En théorie, Nauru, ou tout autre Etat, pourrait parrainer à partir de cette date une demande de plan de travail d’exploitation, et pourrait la voir approuvée provisoirement. Toutefois, les Etats du Conseil sont convenus en juillet 2023 que face à l’incertitude juridique et environnementale, il serait prématuré de le faire, et Nauru a déclaré qu’il acceptait de différer sa demande jusqu’à l’achèvement des travaux sur le code minier.
Quelles étaient les principales problématiques abordées lors de la grande réunion qui s’est tenue à Kingston en juillet dernier ? Quels étaient les enjeux et les principales forces en présence ?
Votre question est amusante, il n’y a pas eu de « grande réunion » de l’AIFM en juillet, mais comme je viens de l’évoquer, se sont tenus en juillet dernier l’une des trois réunions ordinaires du Conseil et la réunion annuelle de l’Assemblée. Le Conseil a poursuivi ses travaux sur le code minier. Nous travaillons article par article, et la France est particulièrement active sur les dispositions relatives à la protection de l’environnement marin, qui sont les plus volumineuses à ce stade (la partie qui y est consacrée fait plus de cent pages). En parallèle, depuis 2022, le Conseil a travaillé sur les implications pratiques de la « règle des deux ans » et a tenté de lever les nombreuses incertitudes juridiques qu’elle suscite. Aujourd’hui, les Etats du Conseil estiment qu’il ne convient pas d’approuver un plan de travail d’exploitation sans un code minier complet et protecteur de l’environnement. La réunion de juillet 2023 a retenu l’attention car elle a permis d’adopter deux décisions permettant de clarifier l’interprétation de la « règle des deux ans ». Une décision a établi qu’il ne convenait pas d’approuver provisoirement un plan de travail d’exploitation sans code minier complet et suffisamment protecteur de l’environnement. En corollaire, par une autre décision, l’Autorité a déclaré son intention d’achever l’élaboration du code minier d’ici 2025, une date qui reste toutefois indicative. Le danger de voir démarrer immédiatement l’exploitation en l’absence d’un code minier solide et protecteur de l’environnement est donc écarté. C’est en cela que cette réunion fut importante. Mais 2025, c’est demain, il nous faut redoubler de vigilance en faveur de la protection de l’environnement.
Pouvez-vous nous expliquer la position de la France en faveur d’une interdiction absolue de l’exploitation quand d’autres pays défendaient son autorisation ou un moratoire ? La France qui n’a pourtant pas toujours été sur cette ligne aussi intransigeante et qui dispose, par ailleurs, de deux permis d’exploration dans les eaux internationales accordés par l’AIFM, dans l’Atlantique et dans le Pacifique…
La France est l’un des Etats qui s’est le plus tôt engagé dans la recherche sur les minéraux de la Zone, dès les années 60, et a signé avec l’AIFM deux contrats d’exploration, l’un pour les nodules polymétalliques dans la très riche zone de fracture de Clarion Clipperton (dans le Pacifique sud), et l’autre pour les sulfures polymétalliques sur la ride médio Atlantique. La France a aussi toujours été élue et réélue au sein du Conseil de l’Autorité, et a eu dès l’origine des experts de sa nationalité au sein de la Commission juridique et technique et de la Commission des finances. Nous sommes donc parmi les Etats qui comptent le plus au sein de l’AIFM, et notre parole est ainsi très écoutée. C’est dans ce contexte que s’est prononcé le Président de la République, lors de la COP 27 de Charm El-Cheikh en novembre 2022, en faveur de l’interdiction de l’exploitation. Le Président de la République a estimé que face à l’effondrement de la biodiversité marine et aux défis posés par l’urgence climatique, il n’était pas raisonnable de lancer un nouveau chantier d’exploitation potentiellement destructeur de l’environnement dans les derniers espaces vierges de notre planète, qui sont aussi les plus mal connus, et où la biodiversité est unique et très fragile.
Cette annonce a fait l’effet d’un coup de tonnerre dans le petit monde de l’AIFM. Si tous les Etats du Conseil avaient déjà pris conscience de la nécessité de poser les règles d’une exploitation durable dans le plus grand respect possible de l’environnement, aucun ne prônait l’interdiction totale. Cette position de la France a bien entendu réjouit les ONG, mais a inquiété les Etats, qui sont attachés à leurs droit à exploiter inscrit dans la Convention, et plus particulièrement les Etats en développement, qui craignent de se voir privés du droit à bénéficier du partage des bénéfices d’une future exploitation. La séance à laquelle a été annoncée cette position forte et assumée en faveur d’une protection absolue de l’environnement a été quelque peu houleuse. Depuis nous sommes parvenus à réu- nir des alliés. La participation de M. Hervé Berville à la réunion de l’Assemblée en juillet 2023 a permis d’expliciter cette position forte et assumée, et de rassurer nos partenaires. Tout d’abord, la France s’interdit toute exploitation dans ses ZEE et encourage les autres Etats côtiers à en faire autant. Elle res- pecte le mandat de l’AIFM et entend travailler à un code minier très protecteur de l’environnement. Elle estime qu’il faut renforcer la recherche scientifique sur les écosystèmes marins, et que l’exploitation ne doit pas démarrer tant que nous n’aurons pas la preuve qu’elle peut se faire sans dommages à l’environnement. Enfin, pour l’heure, l’urgence climatique et l’effondrement de la biodiversité marine doivent nous commander de ne pas lancer cette nouvelle activité potentiellement destructrice. Il s’agit donc avant tout pour la France d’alerter sur la nécessité de procéder avec la plus grande prudence et la plus grande retenue.
Selon François Chartier, chargé de campagne Océan chez Greenpeace, cité par le site actu-environnement. com : « L’intérêt croissant du public, et la mobilisation de la société civile, font naître des dissensions dans ce qui était jusqu’à présent une dynamique très pro industrie au sein de l’AIFM ». Quel est votre sentiment ?
Il n’y a pas de dynamique pro industrie au sein de l’AIFM, mais des Etats qui entendent exercer les droits légitimes qui leurs sont conférés par la Convention, dans un contexte où la demande des métaux rares nécessaires à la transition écologique risque d’exploser. Aujourd’hui aucun Etat n’est prêt à autoriser sous son égide le démarrage de l’exploitation sans code minier solide et protecteur de l’environnement. Une vingtaine d’Etats ont traduit cette position en se déclarant officiellement en faveur d’une « pause de précaution », voire un moratoire. La France a rallié le Vanuatu à l’interdiction, à l’occasion de la visite du Président de la République dans cet Etat insulaire en juillet 2023. Seule une entreprise privée, The Metal Company, se dit prête à se lancer dans l’exploitation. Du côté des Etats, on peut penser que la Chine, la Corée ou l’Inde sont proches d’en avoir les capacités. La Belgique et l’Allemagne, tout en étant très prudentes sur la question de l’environnement, ont développé des démonstrateurs. Nous n’en sommes donc pas encore à la veille d’une « ruée » vers les grands fonds marins, mais le temps presse pour assurer la protection de ces derniers espaces vierges de notre planète.
Avec la demande de Nauru doit-on comprendre que l’on a désormais aujourd’hui les moyens techniques d’aller exploiter les fonds marins, et même les grands fonds marins, avec une perspective de rentabilité économique ? Quels sont, par ailleurs, les projets en attente dans ce domaine dans le monde ?
Effectivement les techniques de ramassage des nodules et de remontée arrivent à maturité et ont été testées en grandeur nature. Leur impact sur l’environnement est soigneusement évalué afin de déterminer quels sont les seuils d’impacts acceptables. La question de la rentabilité est plus complexe. Mais si l’exploitation démarre sous l’égide de l’AIFM, la Convention stipule qu’elle doit être rentable, car il n’est pas question de dilapider le patrimoine commun de l’humanité. Cette condition est encore difficile à évaluer, car le marché des minéraux extraits des grands fonds marins n’existe pas encore. Par ailleurs, certaines grandes entreprises industrielles ont annoncé qu’elles ne les utiliseraient pas. Mais techniquement sera-t-il possible de faire la différence une fois que le minerai aura été traité ? Si les fonds marins produisent des minéraux bon marché, ces promesses vertueuses des entre- prises tiendront elles ?
Exploiter les grands fonds marins est-il une nécessité ?
Aujourd’hui clairement non, et ce serait un danger pour l’environnement, mais la Convention de Montego Bay en offre la possibilité. Imaginons un scénario où la demande de métaux nécessaires à la transition écologique explose, où la Chine qui produit aujourd’hui 90% des terres rares se ferme à l’exportation dans le cadre d’une confrontation avec l’Occident (on voit déjà qu’elle a diminué ses exportations vers les Etats-Unis suite à un embargo décidé par Washington sur les puces de dernière génération), que les capacités de recyclage, comme c’est le cas actuellement, ne soient pas au point, et que des troubles géopolitiques déstabilisent les pays producteurs. Un tel scenario serait une catastrophe pour notre monde, comme pour les océans.
Quelle est l’alternative ?
L’alternative c’est davantage de mines terrestres, ou davantage de recyclage. Ainsi en France il est envisagé d’ouvrir des mines dans le Massif central. La question de l’acceptabilité sociale de ces nouvelles exploitations va alors se poser. Par ailleurs, je ne suis pas spécialiste du recyclage des batteries, mais il semble que des progrès restent à faire pour le rendre réellement efficace. Il faut faire confiance à la science et au progrès pour que la sobriété ou le recyclage permette de rendre l’exploitation des minéraux des fonds marins inutile et non rentable.
Vous êtes l’ambassadeur de France en Jamaïque. Quelle a été la position de ce pays sur le sujet et quel est, plus généralement, sa politique en matière maritime ?
La Jamaïque, où a été signée la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer et qui est l’Etat du siège de l’AIFM est particulièrement attachée au régime juridique des grands fonds marins et aux droits qu’il confère aux Etats, notamment aux petits Etats en développement. Elle est d’ailleurs Etat patronnant d’un contrat d’exploration des nodules.
La France et la Jamaïque développent-elles des projets communs dans le domaine maritime ?
La Jamaïque entend tirer parti de sa situation géographique exceptionnelle, qui peut en faire le Singapour du continent américain, au débouché du canal de Panama, avec le grand marché nord-américain à deux jours de mer, et le 7ème plus important port naturel en eaux profondes au monde. Ainsi, CMA CGM participe à cette ambition en ayant signé en 2015 une importante concession d’exploitation pour le terminal container du port de Kingston. Moi-même passionné par les questions maritimes, j’ai initié il y a un an les discussions pour lancer une coopération entre la Caribbean Maritime University et l’Ecole nationale supérieure maritime (ENSM) du Havre. Le protocole d’accord a été signé par les deux directeurs généraux lors de la visite de M. Hervé Bervillle en juillet dernier. Ces deux établissements d’excellence ont tout intérêt à partager leurs expertises et envisager des échanges d’enseignants et d’élèves. La période post-Covid a aussi permis de reprendre les escales navales, au nombre d’une par an, et la dernière a eu lieu en février, permettant de renouer les échanges sur la sécurité maritime et le lutte contre les trafics en mer. Je souhaite pouvoir développer de nouvelles coopérations dans le domaine des aires marines protégées, dont la Jamaïque est encore trop peu dotée, ainsi que dans la lutte contre les échouements de sargasses, un problème qui touche nos deux pays à l’échelle régionale.